A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O,P, Q, R, S, T, U, V, X, Z
A. Haut de page
A- :
Préfixe privatif : aphylle : sans feuille, apétale : sans pétale, aptère : un dimanche sur deux, acaule : sans tige.
Abiotique [descripteur. écologie]
Concerne des situations qui ne sont pas engagées par le vivant: climat, minéralogie du sol, etc. Voir Ellenberg.
Accidentelle [descripteur. phytosociologie; notion botanique] :
En phytosociologie (étude des communautés de plantes : la manière dont elles se rassemblent fonction des limites et faveurs écologiques) : plante dont la présence n’est pas significative. Car arrivée là par hasard.
En botanique, plante qui n’est pas indigène, qui a un comportement spontané, et qui a été introduite par accident, mais non échappée d’une culture.
Accrescent [descripteur botanique]:
Qualifie n’importe quel organe floral qui continue à grandir en post-floraison.
Achène [descripteur botanique. type de fruit]
voir akène
Aciculé.e [descripteur botanique]:
En forme d’aiguillon souvent droit très mince/étroit.
Acuminé [descripteur botanique]
Se dit d’un organe se terminant par une pointe fine, effilée, plus longue qu’un apicule. Un acumen.
Adaptation/ évolution [Sciences de l’évolution]
On est dans le champ darwinien. En général, le terme évolution est utilisé. Lorsqu’une solution s’est fait jour et qu’elle est pertinente, elle a vocation à se répandre. L’exemple darwinien le plus célèbre concernant ce sujet est l’étude des becs chez les pinsons. Le terme d’évolution risque de sous entendre la disparition de solutions apparues plus anciennement. Mais il reste utilisé justement car il permet de montrer qu’une innovation est supposée plus récente qu’une autre. Cela simplifie les raisonnements et la mémorisation. Le terme d’adaptation permet au contraire d’indiquer que les innovations plus anciennes et les innovations considérées comme plus récentes cohabitent.
La version ultra simplifiée présume de la disparition des innovations plus anciennes du fait des phénomènes de concurrences, mais sans prendre en compte la commensalité, les parasitismes, la coopération … Ainsi que toutes autres formes d’interactions ou d’absences d’interactions, et la manière dont se modèle le vivant à travers le temps.
Réfléchir cet axiome à l’intérieur d’une seule espèce est une grave erreur de raisonnement. Les différentes versions du darwinisme social sont ineptes par nature et ont également plutôt souvent (bien moins chez l’ami Kropotkine) une dimension insultante. Et cela d’autant plus que cela concerne en premier lieu la morphologie: la tronche que peuvent avoir des corps.
L’adaption est considérée comme une résultante de la fitness darwinienne. La fitness indique l’avantage quant à la reproduction des espèces les mieux adaptées à leurs environnement. Cela renvoie également à la question de l’énergie.
L’expression de l’adaptation et de la fitness, si on veut la prendre en compte, est un peu particulière en ce qui concerne les plantes. Cela se réfère à la stratégie CSR et à la typologie de Raunkaier, ainsi qu’à l’échelle d’Ellenberg et à la trophie. La typologie de Raunkaier définit différent profils écologiques correspondant à différent périmètres stratégiques (CSR). Ainsi classiquement les annuelles (thérophytes) ont pour stratégies de produire de très grandes quantités de graines, et de mourir suite à la fructification. Alors que les chaméphytes sont arrachées par des manipulations aux sols tels des sarclages, les graines des annuelles restent et s’exprimeront à la prochaine saison favorable. Il s’agit d’une modalité d’adaptation. Il s’agit des plantes rudérales. Ces plantes ont une grande descendance mais … pour ainsi dire sont les plus « faibles ».
Les chaméphytes quant à elles sont résistantes à des situations particulières: un peu trop froide ou un peu trop sèches. L’échelle d’Ellenberg présente des caractéristiques écologiques, et trophiques.
Voir à Energie.
Adventice :
Terme un peu chic pour dire « mauvaise herbe ». Plantes profitant des conditions de cultures, pour s’y installer. Elles préfèrent ces situations. Soit généralement en raison de la trophie, soit en raison de la rudéralité. Soit encore parce qu’elles n’ont pas le choix. Elle s’y réfugient d’une concurrence trop importante ailleurs. Ce terme n’est plus utilisé que dans le contexte agricole ou jardin.
Agriculture (points de repères)
Concernant l’agriculture, il faut d’abord remarquer que les San et les Sentinelles forment sans doute les seuls contre-modèles ne pratiquant aucune forme d’élevage ni de cultures.
Quelques repères temporels :
Les faveurs aux engrais n’ont pas forcément de début d’histoire (?) La mise en culture du blé n’implique pas automatiquement le sarclage. Mais il y a tout de même possiblement la question du désherbage. Sa domestication il y a un peu moins de 10 000 ans en Asie occidentale, je serais vraiment surpris que cela n’implique pas le sarclage. Idem du Maïs (a priori domestiqué il y a environ 9000 ans dans le sud ouest du Mexique), Soja (domestiqué il y a environ 5000 ans, probablement au sud de la Chine) et du riz. L’ensemble de ces aliments implique la cuisson ou la fermentation. Le manioc (Manihot) été domestiqué dans une aire partagée entre le Brésil et la Bolivie entre 5050 et 4050 BP. Le sarrasin est à peu près deux fois moins nutritif que le blé (il m’intéresse car c’est un aliment plutôt pauvre, et supportant les sols maigres). Sa domestication est des confins de l’Himalaya (sud-ouest de la chine), il y a environ 3000 ou 4000 ans. Les Yi semblent suspectés de l’avoir répandu au Sichuan, ainsi que de l’avoir plus tardivement répandu vers le nord de la Chine. D’où il nous serait venu. Les sociétés néolithiques qui ont domestiqués la banane pratiquaient certainement le sarclage ou des manipulations sur le sol (cultures sur buttes au niveau des marais de hauts plateaux de Papouasie-Nouvelle Guinée, il y a un peu plus de 6000 ans).
Concernant l’élevage, ce qui m’intéresse un peu plus au départ: à savoir les parcours, les landes, les prés et les prairies … J’avoue ne pas avoir pour l’instant d’idée très convaincante pour chercher comment trouver un historique un peu « fiable ». En effet, aux problématiques propres à la paléontologie et à l’archéologie (un endroit intouché depuis telle date), s’applique une typologie: parcours donnés ou libres, zones closes. Et continuités entre les différents types. Trouvable mais avec un peu de patience.
Les manipulations de sols en surface … Donc concernant en priorité le sarclage. Les raisonnements impliquent pas mal de petits aspects. On peut aller beaucoup plus profond dans le sol avec une houe qu’avec une charrue contemporaine. On ne peut pas seulement de mon point de vue, ou en tous cas à échelle un peu mondiale, considérer l’outil comme avancée technologique. Il est là aussi intéressant d’estimer à quoi il sert. Donc déjà ce qu’il produit. Or il va produire des changements dans le sol qui dépasse la question de l’ameublissement. Mais selon les types de sols, c’est à dire selon la pédogénèse concernée (qui ne sera pas la même en climat tempéré atlantique et sous les tropiques). Peut-être aura t’on bientôt des informations complémentaires sur la période durant laquelle le soc a pu être ajoutée à la charrue. Cet aspect technique, d’assez belle importance je pense, implique l’efficacité ou confort du geste (toujours plus facile et rapide qu’avec une houe), mais également des coûts comme par exemple nourrir un cheval … (le moins cher c’est toujours de le faire à la main, donc la houe). D’autres outils, très étonnant, dont je me souviens pas le nom, sortes de bâtons à fouir … ont également existés.
Les premières manipulations de pentes, donc les terrasses agricoles ne sont pas très faciles à dater. On ne peut trop y appliquer un point de départ. La fonction reconnue est la maîtrise des flux, en général l’eau mais parfois des flux aériens (vent). Sur l’île du Cap-Vert, il a été remarqué des terrasses qui ne soutenaient pas longtemps les flux d’eaux sur la pente (Mollard, Walter, 2008). Se transformant en bourrelets. Et répondant donc mal à la fonction attendue. Il semble difficile de retrouver archéologiquement ou géomorphologiquement la trace de telles terrasses molles si elles ont existés auparavant. Je crois qu’il est d’usage de considérer les dates de -4000 à -3000 avant 0 pour les premières terrasses.
Le bocage dans l’absolu n’a pas vraiment d’âge mais son point de départ doit être situé à l’époque moderne (Europe).
Au xviii (Europe), avec les physiocrates, un changement de modèle accompagne l’idée d’un abandon de l’État. Les matières sont plus facilement échangeables. Et si en une région une production est mauvaise, elle peut en théorie par la « loi du marché » être trouvée en provenance d’une autre région.
Au XIX, des « agronomes » (il ne portaient pas ce nom là) parcourent la France et incitent au bocage.
L’agriculture industrielle a une histoire plus longue dans l’ancienne URSS et aux USA. Cependant l’économie libérale depuis donc le xviii implique nécessairement une interaction (ou même une interdépendance –cas actuel) des différentes régions dans le monde. L’agriculture industrielle implique plusieurs aspects, particulièrement liés à la société de consommation. Il peut s’agir des pratiques agricoles et on remonte a la première partie du XX pour l’URSS et les USA (la France en ce domaine n’apparaît comme un exemple particulièrement convaincant), on peut aussi remarquer la nécessité d’acheminer la production vers le consommateurs (la question des autoroutes nous mène peu avant Mussolini, en Italie). Mais globalement l’interaction entre les différentes régions du monde a dans ce contexte son importance aussi. Donc plutôt peu avant 1950. Notamment dans l’hexagone, où l’auto consommation, les produits locaux … etc (souvenir de lecture de Jean-Loup Trassard). L’abandon de cette dernière dimension est extrêmement récente. Autrement dit, le poids de la production locale a une importance au moins jusque dans les années 1950.
Fin de la seconde guerre mondiale : début de la révolution verte. Industrialisation de l’agriculture avec des parcours techniques se rapprochant de ce qui existe aux USA et en URSS, nouveaux produits intrants (lié aux industries pétrolières et pharmaceutiques/ d’origine parfois militaires). Agrandissement des parcelles par la suppression du bocage. Création des coopératives agricoles pour aider les agriculteurs. Cela permet de centraliser en chaque point, les produits nécessaires aux parcours techniques agricoles, mais aussi les produits destinés à la vente. Et donc une dépendance au système routier accrue. Ces coopératives s’inscriront par la suite dans le modèle mondialisé de l’agriculture.
L’histoire de l’agriculture n’est pas uniquement limitée à son volet d’industrie lourde. Sont étudiés par l’ORSTOM/IRD et par le René Dumont à partir de la fin des années 1950 d’autres solutions. Sur le plan des parcours techniques traditionnels et sur l’innovation. Dans le cadre de la permaculture laquelle prend un envol dans les années 1970, la date d’apparition du système VAC viêtnamien n’est pas connue mais remonte avant les années 1970 (bien avant, hypothèse : durant la période où le pays était fermé ou encore possiblement avant). C’est au tout début des années 1970 que le bois raméal fragmenté est expérimenté au Canada. Par ailleurs les progrès en Paléo écologie et en Archéologie permettent désormais de comprendre avec assez de finesse les parcours techniques agricoles de sociétés totalement disparues. Il y a une différence entre l’étude de parcours traditionnels, et les mêmes études dans un contexte agronomique (permaculture incluse – je n’aime pas qu’on qualifie la permaculture de simple pratique car Mollison comme Fukuoka lequel commence à s’interroger à partir de 1938 sont agronome et physiopatholgiste, Mark Shepard ne l’est pas je crois par diplôme mais ses essais et réflexions sont un travail d’agronomie), c’est qu’il s’agit bien, malgré l’absence d’invention ou de recours à des produits nouveaux sur la terre et malgré l’absence parfois de machines formidables, de progrès techniques et scientifiques où sont particulièrement étudiés l’eau et la pente, la sédimentologie, la pédologie, le milieu (écologie) … Ce mouvement de connaissances, aujourd’hui reconnu (le e écologique de l’Inrae a été ajouté), prend une certaine force à partir donc des années 1960-1970.
Agriculture naturelle/agriculture de conservation [typologie des traitements agricoles]
Bien avant la permaculture, l’initiant en partie, mais aussi bien après avec l’agriculture de conservation, le XX ème a remarqué avec intérêt les cycles naturels, biogéochimique, permettant la fertilité. La « forêt », la forêt senso lato, devient un modèle de réflexion agronomique.
L’agronome et agriculteur Masanobu Fukuoka a mis au point ce qu’il a appelé l’agriculture naturelle. Je veux simplement souligner de sa proposition l’absence totale de travail du sol par l’humain.
C’est la pédosphère qui est convoquée pour l’ameublissement des sols. Notamment les mycètes. Cela passe par des rotations variées, un important travail de couverture des sols, de mulchage: une technique possible de lutte contre les adventices. En ce qui concerne le riz, il propose pour cette lutte un noyage périodique des cultures.
L’agriculture de conservation est en tous cas censée reprendre des principes du même type. En remarquant le coût potentiel du mulchage, des problèmes de conceptions peuvent évidemment survenir. Malheureusement, en tous cas pour l’Hexagone, une dérive a fait jour. Et la lutte contre les adventices n’est plus organisée autour de la question du paillage mais avec le glyphosate. Ce raccourci éloigne l’agriculture de conservation française des principes qui la gouverne en général.
Ces parcours techniques ont pour conséquences de pouvoir augmenter la CEC, avec comme limite le risque d’un C/N élevé.
Les adventices n’appartiennent pas au Stellarietea mediae, mais si présentes, tiennent a priori plutôt des ourlets.
(Permaculture: ce que l’on peut synthétiser de la permaculture est qu’il s’agit d’une pratique agronomique qui cherche à synthétiser des parcours techniques de toutes origines possibles, qui autrement sont conçus séparément. Elle prend souvent la forme agricole d’une solution extrêmement intensive, avec une protection des cultures d’origine biotique extrêmement variée et forte, sous l’influence notamment des agronomes australiens Molisson et Holmgren)
Aigrette [descripteur botanique]
voir Pappus
Akène [descripteur botanique. Typologie des fructifications]
Un akène. Normalement je dis une, mais c’est pour mieux me tromper. Un akène est un fruit sec (dur ou sclérifié) et qui ne s’ouvre pas (c’est donc marqué dans le nom mais en grec). Fruit sec (dur ou sclérifié) et indéhiscent, donc. Il n’y a qu’une seule graine. Et celle-ci n’est pas soudée à l’enveloppe de la fructification.
Souvent: des diakènes, deux akènes liées l’une à l’autre.
Dans la cuisine, le cumin, l’anis, le fenouil sont des akènes (des diakènes quand ils sont sur la plante).
Aire minimale (pour relevés phytosociologiques)[méthode]:
L’aire minimale correspond à la surface minimale pour chaque type de relevé concernant des taxons phytosociologiques (associations, alliances, etc.) En deçà d’une certaine surface, la communauté de plantes visée ne trouvera pas une expression pertinente. L’aire minimale est la surface minimale pour laquelle on estime que toutes les espèces caractéristiques seront là. Si l’aire minimale n’est pas respectée, il s’agit alors d’une communauté fragmentaire.
L’aire minimale se calcule. A partir d’un mètre carré de relevé, compter la divers!té floristique. Doubler le carré, compter la divers!té floristique. Recommencer jusqu’à saturation de la divers!té. La divers!té n’augmente plus.
Indicativement, selon de grands types de végétations, des ordres de grandeurs empiriques (en gros, il faut s’attendre à) :
- Pelousaires. De 1 ou 2 jusqu’à 10 mètres carrés doivent faire l’objet d’un relevé sur un espace homogène
- Bas marais ou tourbières: entre 5 et 20 mètres carrés.
- Prairial: de 16 à 25 mètres carrés. 50 mètres carrés si nécessaire.
- Mégaphorbiaies. Au moins de 16 à 25 mètres carrés et jusqu’à 50 mètres carrés.
- Roselières et cariçaies: au moins de 30 à 50 mètres carrés.
- Les ourlets linéaires: de 10 à 20 mètres carrés
- Les landes: de 50 à 200 mètres carrés.
- Les fourrés, de 50 à 100, ou 200 mètres carrés
- La forêt: de 200 à 800 mètres carrés.
Les jardins comportent des cultures sarclées à rapporter au chenopodetalia, et du prairial: en toute logique, sauf exception, les communautés sarclées en tout cas de l’ornemental qui s’y trouvent sont fragmentaires. Les pelouses sont concernées par le festuco-crepidetum capillaris (voir Fiche 06-88) .
Allogame [descripteur écologie, botanique]
Espèce dont les individus sont soumis à pollinisation par un individu différent. L’allogamie est le plus souvent obligatoire, pour les plantes qui le sont. S’oppose à autogame.
Androcée [Organe, pour description botanique]:
Partie mâle de la fleur.
Annuelle [concept: botanique]
Désolé.e. Merci d’aller voir à thérophyte (également à monocarpique).
Anthèle [Organe. Type d’inflorescence. descripteur botanique].
Inflorescence (ou fleur composée) en cyme dont les rameaux de premier ordre ont des longueurs décroissantes de l’extérieur vers l’intérieur. Typiquement présent dans le genre Juncus.
Anthère [Partie d’un organe. Pour description botanique]:
Partie terminale d’une étamine. Produisant, réservant et libérant le pollen généralement par déhiscence. Distinguée par son mode de fixation. Médifixe : l’anthère est fixée par le milieu ; basifixe : l’anthère est fixée par la base …
Anthropocène [Géologie, climatologie. Concept (?) Notion temporelle(?)]:
L’Anthropocène est une époque géologique (ou évènement d’un rang inférieur) commençant dans les années 1950. Le concept a été refusé par la commission internationale de stratigraphie en tant qu’époque, notamment en raison d’un manque de recul, et notamment d’un doute sur la durée possible. J’admet ce terme sans juger de son rang. La notion est utile. Et elle reste discutée. Les datations correspondent à ce qui était nommé « grande accélération », ou exprimé par ailleurs par la terminologie « société de consommation » comme effet poussoir. Le marqueur choisi est le plutonium (d’origine anthropique: industrie militaire nucléaire). Des éléments indicatifs d’un changement dû à l’humain sont représentés par ailleurs avec le concept de limites planétaires.
Anthropophile [Notion, écologie]:
Espèce qui suit l’humain, sans précision de facteurs explicatifs.
Apex [descripteur botanique]:
Extrémité terminale
Apiculé [descripteur botanique]
Se dit d’un organe terminé par une pointe courte.
Apprimé [descripteur botanique]:
Appliqué et couché contre l’organe qui le porte sans qu’il y ait adhérence.
Archée [Règne. sciences dites de l’évolution]:
Règne d’organismes procaryotes unicellulaires sans doute un peu mystérieux et dans lequel on trouve Plasmodium falciparum. Lequel cause le plus grave et le plus létal des paludismes.
Archéophyte [concept (temporel) botanique]:
Les archéophytes sont les plantes non très strictement indigènes qui sont parvenues à tel ou tel endroit de la planète avant la régularité des traversées notamment transatlantiques : avant 1500 après J.C. Et depuis le néolithique : désigne donc plus souvent les cortèges de plantes en lien avec l’invention de l’agriculture au Moyen Orient, pour les européens : messicoles et linicoles, etc.
Concernant l’aspect temporel, voir également néophyte
Ce dernier groupe mérite un petit stationnement. Les communautés de plantes des sols sarclés sont distinguées dans le groupe du Stellarietea. Celui-ci partage de nombreuses plantes avec le groupe des friches du Sysimbrietea. Mais il regroupe en outre des archéophytes. Fonctionnellement, les herbes spontanées dans les champs répondent à la logique de reconquête de la friche. J’utilise abusivement ce mot pour les désigner en langage vernaculaire. Mais ce n’est pas précis. D’autant que le raisonnement par la fonctionnalité est secondaire vis à vis de la floristique (les espèces rencontrées et leurs recouvrements du sol respectifs). En ce qui concerne les archéophytes, certaines se retrouvent dans les friches, mais pas dans toutes les régions. C’est le cas du grand coquelicot. Il semble qu’en Normandie (autour de Caen), ce coquelicot ne daigne pas forcément sortir des champs.
Ce que le groupe des archéophytes indique des champs cultivés, c’est que ceux-ci conditionnent la présence de ce genre de plantes en supprimant tout effet de concurrence (par le désherbage: ombrothermie, recours aux nutriments, etc.) Les champs cultivés forment donc une niche écologique ouverte pour ces plantes. Elles y sont en position de refuge (sauf celles qui parvenant à manifestement vivre en dehors de cette niche et qui prennent alors le statut propre à celui des friche: celui de rudérales.). Aussi le Stelleriatea se présente comme une évolution ou quelque chose d’analogue à une spécialisation du Sisymbrietea.
Les archéophytes sont à distinguer des paléophytes.
Architecture végétale.
En principe, je l’indique de temps en temps dans chaque fiche.
Cette discipline qui désormais fait appel à la modélisation informatique ou à la génétique a tout d’abord, et c’est l’intérêt en tous cas sur le terrain, été synthétisés par les botanistes Oldemann et Hallé.
Les noms des modèles font références à des botanistes s’intéressant à ce sujet (la morphogénèse).
(je compléterai au fur et à mesure car je trouve çà un peu long)
Le modèle le plus classique, et le plus courant en tous cas sous nos latitudes est en Rauh.
C’est le modèle le plus efficient (le plus efficace avec le moins de coût).
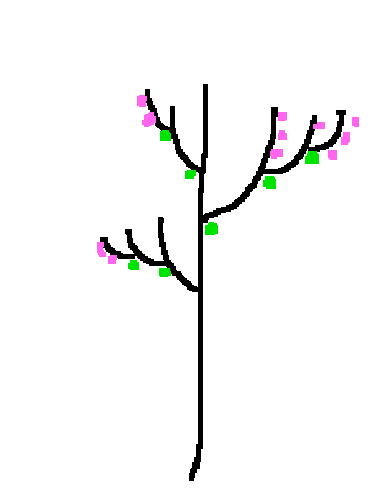
Ce modèle présente un tronc (monopode) d’où s’expriment des branches. toutes les branches s’élèvent vers le haut. La floraison a lieu sur le côté des branches et non au sommet de celles-ci (et donc n’interrompt pas la croissance. Cela permet en outre plusieurs fleurs ou plusieurs groupes de fleurs). Le développement est rythmique. C’est à dire qu’il s’interrompt (programmatiquement). Il produit ce qu’on appelle des phytomères. C’est à dire des unités de croissance qui se trouvent être toutes identiques (repérable sur l’image au points verts représentant la feuille ou la cicatrice foliaire axillant le bourgeon devenu branche).
Le modèle en Attims est pratiquement identique mais sa croissance est continue. L’Aulne est en Attims, pourtant sous nos climats. Comme sa croissance est continue les branches se présentent de manière plus diffuses, moins régulières le long des axes.
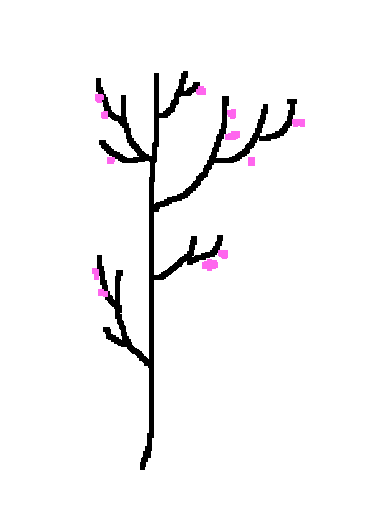
Les modèles à croissances rythmiques sont plus typiques des climats à saisons contrastées. Il présentent donc par principe des cernes de croissance (mais heureusement ce n’est pas si simple). Les modèles à croissances continues sont plus typiques des climats pas ou peu contrastés dans lesquels les arbres ne présentent pas de cernes de croissance. L’aulne glutineux est en Attims, comme il subit la saison froide. Il s’arrête néanmoins de croître et reprend aux beaux jours: il présente donc des cernes de croissances (couper l’arbre permet donc de déterminer précisément son âge. technique simple mais interprétation pas toujours évidente).
Le modèle en Holttum concerne essentiellement les thérophytes. Une tige est terminée par une fleur ou une inflorescence (cas le plus courant). La plante meurent après la fructification.
Le modèle en Tomlinsonn concerne les plantes cespiteuses.
Le modèle en Bell concerne les plantes à axe principal (tronc/tige) souterrain tel des plantes à rhizomes. De cet axe souterrain émergent des tiges.
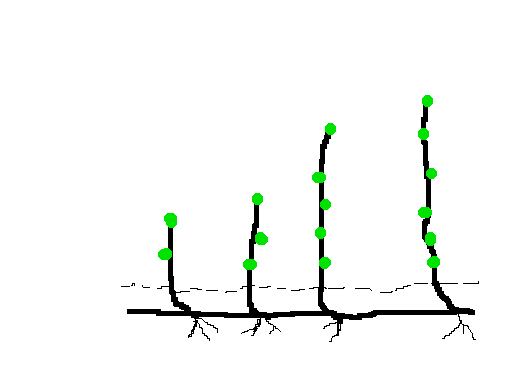
Le comptage absolu des individus de plantes présentant cette architecture est problématique.
Ardoise [lithologie. géologie, pédologie]:
L’ardoise est une argile métamorphique friable, se présentant en feuillets, un schiste donc. Elle contient beaucoup de silice et tout comme le granite, elle favorise un pH bas du sol.
Argile [lithologie, géologie, pédologie]:
Elément minéral du sol à granulométrie très fine. Souvent (argiles à feuillets) : très forte capacité de rétention en eau, et en nutriments.
Argilite [lithologie, géologie, lithologie]
Argile sous forme de bloc rocheux. A mettre en rapport avec la siltite et avec le grès.
Autogame [Biologie. utilisé conceptuellement en botanique: sciences dites de l’évolution]
La pollinisation peut se faire sur un même individu. Même individu, ou même fleur. S’oppose à allogame
B. Haut de page
Banalisation [notion, écologie]
Appauvrissement de la biodivers!té. Remplacement d’espèces ou de formations végétales par des espèces à plus larges spectres écologiques, ou moins rares. Ou par des formations toujours moins diverses. Que les causes soit dues à des raisons de montées trophiques des sols, ou encore à l’abandon des pratiques ou de certaines pratiques agricoles, etc.
Basalte [lithologie, géologie, pédologie]:
Roche magmatique volcanique de pH basique.
Bioindication [notion; écologie]
La bioindication a quelque chose de délicat. Notamment au jardin où la renoncule rampante est souvent prise comme indicatrice d’hydromorphose. Je n’ai jamais vu dans un jardin des situations aussi humides que celles où cette renoncule se trouvent parfois mais non systématiquement. Cette renoncule n’est pas pour moi une bio indicatrice.
Jean-Claude Rameau avait tenté de circonscrire quelques plantes bioindicatrices …
L’habitat, qu’il soit appauvri en code EUNIS ou sur la base d’un référentiel phytosociologique, est par contre plus parlant. Voir Ellenberg
Cependant que des espèces en particuliers (ou l’absence de certaines espèces dans une zone donnée: le cas de la lichenologie) sont effectivement bien bio-indicatrices. Certains odonates par exemple. A l’échelle mondiale, un pourcentage non négligeable de Carex mais avec peut-être un reste à vérifier (combien, est-ce vraiment certain?? A quelle période dans le temps les laîches d’écologies moins humides ont dérivées?) sont inféodés aux zones humides. Le Frêne est plutôt des zones fraîches (et ombragées. Il y domine). Le Lycope est des zones humides …
Biome [concept. Phytogéographie]
Un biome est une très grande aire, un très grande éco-région phyto-climatique: les caractéristiques climatiques donnent lieux à de très grands types d’habitats.
Biotique [concept. écologie]
Concerne des situations qui sont engagées par le vivant. Plutôt à l’exception de Sapiens sapiens, eu égard à son exceptionnelle capacité de déploiement d’énergie, notamment.
Le vivant peut commencer avec les archées ou les bactéries … En tous cas un procaryote ou quelque chose d’assez proche, tel qu’on peut se l’imaginer et qui s’appelle LUCA pour Last universal common ancestor (noter que présupposer LUCA indique un peu une vision évolutive de la vie, ou encore théique)
Dans ce contexte, il peut être indiqué qu’on ne sait pas si les virus font partie du vivant.
Bractée [Organe. Pour description botanique]:
Feuille axillante généralement la « fleur », l’inflorescence. Généralement au niveau du pédoncule. Les bractées forment aussi la partie feuillée sous le réceptacle d’un capitule
Bractéole [Organe. descripteur ou pour description botanique]:
J’utilise ce terme de manière extensive (voir donc, écaille). Petite bractée se trouvant à la base des pédicelles des « fleurs complexes », des inflorescences composées.
Brachyblaste [Organe non développé, modifié. Descripteur botanique]
Les brachyblastes sont des rameaux qui restent courts, prenant parfois la forme d’épines.
Bryophyte [Botanique; sciences dites de l’évolution]
Groupe des mousses
C. Haut de page
Caduc [descripteur botanique]:
S’oppose à souvent à sempervirent. Qualifie la perte d’un organe en raison de la saison défavorable (par exemples : saison froide chez nous, saison sèche en climat tropical sec), ou en raison de la transformation, le grossissement d’un organe sus-jacent. Les plantes sempervirentes perdent également leurs feuilles mais les renouvelles régulièrement.
Calcaire (on dit parfois « calcium, calcique ») [lithologie, géologie, pédologie]:
Roche sédimentaire riche en carbonate de calcium, en carbonate de magnésium. Le calcaire peut être dit « insoluble » et n’avoir alors que peu d’incidence sur la végétation. Sinon, basique, il influence la montée du pH. Les sols calcaires sont susceptibles d’être appréciés par les agriculteurs (cas de sol calacaires dits actifs), car les liaisons entre le calcaire et les nutriments minéraux sont très fortes. Calcaire n’est cependant pas synonyme de trophie. Il exite par exemple des pelouses calcaires oligotrophes, qui sont souvent dans un état précaire et qui si elles ne sont pas protégées mériteraient de l’être.
Existe sous forme de bloc rocheux:

Alt text: la photo montre un morceau de calcaire (roche calcaire) de la taille d’un gros gravier. La pierre est claire. Pas tout à fait blanche, un peu de terre dessus qui doit rester.
Calice [Groupe d’organes, pour description botanique]:
Le calice est formé de l’ensemble des sépales.
Capacité d’échange cationique (CEC) [pédologie, mesure]:
La CEC est une mesure de fertilité du complexe argilo-humique (de la couche de sol fertile et colonisable par les plantes). Les cations visés sont donc le plus souvent ce que l’on désigne comme nutriments: azote, phosphore, potassium, etc. à l’état assimilable par les plantes. Mais il s’agit d’une mesure, d’un comptage cationique.
La CEC correspond à la quantité (potentielle) de cations fixables par le sol.
Elle est fortement dépendante du rapport carbone azote d’une part (la quantité de carbone par rapport à la quantité d’azote), et du pH d’autre part.
La CEC diffère du taux de saturation. Le taux de saturation correspond à la somme des cations échangeables dans la CEC. On la calcule par la somme des cations basiques (ce qu’on appelle souvent les bases) sur la somme des cations totaux.
Noter que les bases sont: Ca++, Mg++, K+, Na+
Capitule [descripteur botanique. Typologie des inflorescences]:
Le capitule est un ensemble de fleurs sessiles souvent petites, regroupées sur un réceptacle ou disque, et donnant l’impression d’une unique fleur. Exemple : la pâquerette.
Carbone-Azote [pédologie, géologie, écologie]
Le carbone, qui est issu des plantes (feuilles mortes, etc.) n’est pas fertile (pour le règne des plantes). L’azote est un constituant de l’air.
Le carbone que l’on trouve au sol est transformé en azote grâce à des enzymes produites par des bactéries ou des champignons.
Cela permet de transformer le carbone en azote. Pour transformer l’azote en carbone, les plantes sont utiles.
Selon la vitesse de cette transformation, laquelle dépend du pH et de la quantité d’oxygène dans l’atmosphère du sol (dans la couche de sol superficielle), on a différents types d’humus.
Carpelles [Partie d’organe, pour description botanique] :
Parties feuillées, enveloppe du gynécée.
Catena [concept et descripteur, phytosociologie]
Groupement en mosaïque ou zonation de plusieurs tesela au sein d’une grande et même unité géomorphologique, et dérivant par succession primaire. Le domaine phytosociologique est celui de la synusiale. Analyse de grandes échelles, mais moins gigantesques que celles de la phytogéographie.
Caulinaire [descripteur botanique].
En rapport à la tige.
Centre de diversification (centre de divers!té) [notion. sciences dites de l’évolution. écologie] :
Ce phénomène a été remarqué par le proto-généticien Nikolaï Vavilov (1887-1943), notamment spécialisé dans le phénomène de sélections, et par extension sur les céréales. Là où un genre apparaît, il y a plus d’espèces. Les espèces se forment dans la même zone géographique. Avant éventuellement de se déplacer. Ce phénomène est toujours susceptible d’être étudié pour cerner l’origine d’une espèce, mais sous un jour plus purement génétique. Ce qui permet de mieux évacuer les erreurs interprétatives. On utilise parfois aujourd’hui la notion de polytomie: éclatement apparemment simultané d’un taxon en plusieurs espèces (plus de deux). Soit, beaucoup de dichotomies sur une échelle de temps rapprochée, mais pas ou peu distinctes (manque d’informations).
Pour des exemples, sur ce site voir: Ceiba pentendra ou Adansonia digitata
Centre de domestication [notion. agriculture. sciences dites de l’évolution]:
Un centre de domestication considère l’aire où une espèce a été domestiquée.
Cespiteux [descripteur botanique]
En touffe. Se dit des espèces qui forment des touffes.
Changement global [termes présentant cette situation. Valeur temporelle]
Le changement global désigne la modification du système-Terre, suite à l’accélération de la production depuis le XIX ème siècle et des échanges internationaux depuis la mi-temps du XX ème siècle. Il fait finalement référence à l’anthropocène. Et il est décrit par les limites planétaire.
Chasmophyte [Concept. Botanique]:
Se réfère à « parois ». Plante poussant sur des parois. Pour beaucoup l’appareil racinaire a pour adaptation la possibilité de s’insérer dans les fissures des parois. Il existe des communautés de plantes chasmo-chomophytiques.
Chélation [chimie. pédologie]
Un composant chimique est lié à ses voisins par au moins 2 liaisons (« pris en pince »)
Chiono- [descripteur. sciences et pratiques dites de la nature]
Relatif à la neige
Chomophyte [concept. Botanique]:
Pas franchement le cas le plus courant. Ce terme qualifie des plantes vivant dans des débris végétaux. Les racines étant superficielles. A distinguer de chasmophyte.
Complexe argilo-humique (CAH)[concept. Pédologie et agriculture]:
Ce qu’il faut retenir c’est ce que les différents éléments de ce qu’on appelle habituellement le sol sont liés entre eux par des liaisons chargées négativement et positivement (exactement comme des aimants), et permettant de lier les éléments minéraux et les éléments organiques. Les nutriments cationiques (chargés positivement) lient l’humus et l’argile qui sont anioniques (chargés négativement).
Si un nutriment est sous forme anionique (-), il aura tendance à filer à la rivière, ou encore à « s’aimanter » à un cation (+), lui même « aimanté » à une particule d’humus ou à une particule d’argile.
Les ions qui sont fixés en premiers (donc sur argile+humus) sont beaucoup plus fortement fixés que les ions fixés sur eux.
Les cations se fixent au sol en fonction de leurs valences et de leurs hydratations, les plus « sec » étant « aimantés » en priorité. Cela dépend de leurs natures. Sous notre climat, dans les climats à saison humide, on obtient:
(Al 3+ selon la nature du sol, ou encore l’absence trop importante de matière organique)> Ca2+>Mg2+>K+>Na+
Dans les climats plus arides, le sodium (Na+) est susceptible de prendre la place du calcium et/ou du magnésium chez nous.
Aussi les formules minérales concernant les éléments fertilisants sont celles ci: Mg2+, Ca2+, K+, H+, Na+, etc. Il est plus couramment choisi de mettre des engrais sous forme cationique alors que les plantes assimilent préférablement des anions, car dans le CAH, les cations se trouvent être moins rapidement lessivés. Un agriculteur qui introduit de l’engrais désire que celui-ci puisse rester au sol d’une part, et d’autre part qu’il puisse passer aisément dans la solution du sol à laquelle les plantes ont recours. Enfin que cet engrais soit converti par les vivants du sol en molécules assimilables par les plantes.
La capacité d’échange cationique mesure la quantité de ces éléments cationiques fixés dans le complexe argilo-humique.
De manière générale, la pédogénèse décrite sur cette page est celle du climat tempéré atlantique qui domine dans l’Hexagone. La pédogénèse excède en horizons pédologiques l’Horizon A (+ horizon humifère) impliqué dans le complexe argilo-humique.
Les sols fersiallitiques du climat (subtropical) méditerranéen présentent des caractéristiques pédogénétiques différentes de celles en cours dans le domaine atlantique.
Chorologie [concept. Ecologie. et toutes sciences dites de la nature]:
Cà peut surprendre. Mais là c’est marrant. Il s’agit de l’étude de la dispersion d’un taxon. Permet également d’orienter la pensée pour situer l’origine d’une espèce, en regardant la cartographie d’un genre. Voir: centre de diversification.
Climax (climacique) [concept. Phytosociologie]
Voir paraclimax
Communauté basale [concept. phytosociologie]:
Une communauté basale est une communauté de plantes souvent pionnière et immature ou encore très fortement perturbée comme c’est le cas en zones urbaines. Et ne présentant alors qu’un petit nombre de taxons à larges amplitudes écologiques, à larges amplitudes phytosociologiques. Nombre trop court pour une identification, et alors rapporté au rang supérieur de la classification phytosociologique le plus pertinent.
Communautés de plantes [phytosociologie]
Terme pouvant être utilisé pour éviter le flonflon du terme phytosociologie
Communauté dérivée [concept. phytosociologie].
Une communauté dérivée est une communauté dont le cortège floristique, sa divers!té/richesse floristique est impactée par la domination d’une espèce. Il y a un appauvrissement de la divers!té floristique. Le cas le plus typique, est celui du à la présence d’une plante invasive dans cette communauté. Les plantes envahissantes ayant tendance à transformer les phytocénoses où elles s’installent en espace paucispécifique, ou même tout simplement monospécifique: elle-même, c’est tout.
Cette communauté est alors rapporté au rang supérieur de la classification phytosociologique le plus pertinent.
Communauté fragmentaire [descripteur. phytosociologie]:
La station est de surface insuffisante et ne permet l’expression correcte de la communauté. Egalement rapporté au rang supérieur de la classification phytosociologique le plus pertinent.
Voir: Aire minimale.
Complexe (organe):
Parfois utilisé sur ce site pour indiquer qu’un organe est composé
Composé(e) [descripteur. Botanique]
Se dit d’un organe complexe, composé en plusieurs parties de même nature: feuille ou fleur.
Cordé [descripteur. Botanique]:
se dit d’un organe qui a la forme d’un cœur, la pointe étant à l’extrémité terminale. Une feuille obcordée à la forme d’un cœur mais la pointe est à l’extrémité basale.
Corolle [groupe d’organe, pour description. Botanique].
La corolle est formée de l’ensemble des pétales.
Corymbe [descripteur. Botanique. Typologie des inflorescences]
Inflorescence (ou fleur composée) dont les pédicelles, de longueurs inégales, partent de niveaux différents, et situant les périanthes plutôt sur un même plan.
Coumarine (odeur de) [descripteur. Botanique]
La coumarine, parfum naturel présent dans certaines plantes et liée au sucre, dégage une odeur très caractéristique que je ne sais pas qualifier. Elle est souvent comparée à celle du foin, de la vanille. Cette odeur parfumée est tout particulièrement connue des amateurs d’une vodka polonaise parfumée à l’Erochloe odorata.
Egalement utilisée en parfumerie et pour améliorer le goût des aliments (Fève Tonka).
Il semblerait que le mot Coumarine provienne soit du Kali’na (Galibi) soit du Tupi. Mais les Tupi ne sont pas Karib.
Croissance:
çà grandit. Différent de développement. Le développement est traité par la phénologie.
Cryptogène [concept. botanique. écologie]:
Plante dont la présence, l’arrivée sur le territoire concerné n’est pas explicite, n’est pas bien connu.
Cultigène [concept. botanique] :
Plante n’existant pas à l’état spontané, provenant d’un acte de sélection par les humains.
Cultivar [Botanique]:
Variété au sens large ou au sens strict d’un cultigène. N’est jamais considéré comme indigène : plante non spontanée.
Cunéiforme, cunné(-e) [descripteur. Botanique]:
En forme de triangle, de coin.
Cyathe [descripteur. Botanique. Typologie des inflorescence]
Fleur étonnante dans le genre Euphorbia. L’involucre formé de 5 bractées est soudé en urne. Chaque bractée est séparée par une glande ( il s’agit d’un stipule transformé), et axile une petite cyme de fleurs mâles. Au centre de l’urne, la fleur femelle réduite à ses carpelles. Se remarque à l’urne et aux glandes.
Cycle de l’azote [géologie. climatologie. pédologie]
Un point auquel on pense moins spontanément concerne les gaz à effets de serres.
L’un deux, le dioxyde d’azote, émane des moteurs thermiques (par exemple les voitures). Il participe à maintenir en ville, la communauté du Xanthorion parietinea. Il s’agit d’une communauté de Lichens qui supporte des doses d’azote, et qui rend cette pollution atmosphérique repérable.
Un autre gaz à effet de serre est plus particulièrement surveillé dans les cultures. Lorsque le sol est gorgé d’eau, il est pauvre en oxygène. Cela favorise les bactéries dénitrifiantes qui sont facultativement anaérobies, alors que les bactéries nitrifiantes de nitratation et de nitritation sont aérobies. La dénitrification entraîne la pollution en protoxyde d’azote (N2O) qui présente un effet négatif sur le climat.
Lorsque ces sols ne sont pas laissés nus, les plantes ont recours à l’eau du sol, ainsi qu’au nutriments minéraux. Le sol sèche plus vite. Les cycles de l’azote au sol restent en cours. Noter par ailleurs que lorsque l’on voit un champs labouré nu en hiver, c’est souvent en raison d’une argile trop lourde pour laquelle l’alternance de gel et de dégel est importante pour la décompaction.
Les plus importantes émissions de N2O semblent avoir lieux après de gros épisodes pluvieux, en suite de la fertilisation des sols. La fertilisation des sols, en tous cas mal guidée, et jamais compensée par une culture CIPAN (culture ayant pour fonction de maintenir les cycles de l’azote au sol) est la cause la plus importante d’émissions de N2O en agriculture.
Les grandes pluies que l’on connaît l’hiver sont favorables aux lessivages des sols. Ces pluies ont tendance à emporter les nutriments en direction de la rivière. Dans ces lessivats, une faible part semble pouvoir se transformer en N2O. Il se pourrait cependant que l’hiver soit favorable à ce que les sols sous nos climats se comportent comme puits plutôt que comme source de N2O.
Les sols ayant un humus de type mull, c’est notamment le cas des sols de cultures, voient les processus de transformation impliqués majoritairement par des bactéries (mais, voir cycle du phosphore).
Les sols ayant un humus de type moder voient plus de mycètes dans les processus impliqués. Ces sols sont plus acides. Le voisinage des racines est aussi acidifié par l’absorption d’azote qui n’existe dans ces sols pratiquement que sous forme ammoniacale.
De la même manière, on voit que le comportement de l’azote en prairie permanente est différent que dans un sol nu de culture. En sous bois, la litière va faire intervenir les mycètes …
Dans les sols,
la plus grande pauvreté en oxygène, c’est à dire la plus grande quantité en CO2 dans les sols, cela semble provenir de l’activité transformatrice des processus pédologiques. Oxygène nécessaire aux bactéries nitrifiantes comme à la fonge, et qui donc le consomme pour transformer l’azote en azotes assimilables pour les plantes. Cela appauvrit l’atmosphère du sol en oxygène, et le renchérit en CO2, ce qui peut très bien convenir aux bactéries dénitrifiantes. Ces dernières participant à l’abaissement du taux d’azote au sol. Ce qui n’est pas forcément partout toujours une mauvaise chose.
Des bactéries participent à la production, à la fixation d’azote au sol:
Pour commencer, les bactéries à respiration anaérobies obligatoires (dans des zones anoxiques), tel des Chlorobium, des Clostridium (dont le botulisme) …
Des bactéries à respiration aérobies facultatives tel Pseudomonas, des bactéries totalement aérobies comme des cyanoboactéries (le Nostoc)
Et les très appréciées bactéries symbiotiques. Les symbioses se voient par des nodulations au niveau du racinaire. Les bactéries du genre Frankia pour les Aulnes, le Myrica gale, etc. Plus connues les bactéries du groupe Rhizobia concernent essentiellement les Fabaceae. En échange de produits carbonés (du sucre au sens large), la bactérie bien protégée par la plante lui fournit de l’azote.
Contrairement au phosphore, l’azote est extrêmement labile et prend diverses formes: ammonium, nitrates et nitrites, protoxide d’azote … L’azote est très sensible au lessivage.
Il y a une sorte d’équilibre du pH au niveau de la rhizosphère des racines qui se produit. Ne serait-ce que dans le contexte de la rhizodéposition. L’azote est donné comme acidifiant. C’est à dire que des quantités trop importantes d’azote sont acidifiantes. Les lessivats azotés sont susceptibles d’acidifier les milieux, ou plutôt de participer à l’acidification des milieux, notamment aquatiques.
L’azote quitte le sol par lessivage (lixivation est le terme élégant et technique), et sous forme gazeuse.
Cycle de l’eau [géologie. climatologie. pédologie]
Très peu de surfaces agricoles connaissent un système d’irrigation, lequel entraîne un investissement. Système d’irrigation compris au sens contemporain du terme. Les fossés qui bordaient les talus des bocages formaient un système de gestion de l’eau, par exemple, mais depuis longtemps bouchés par le passage des machines.
Ne serait-ce que sur le plan agricole, le cycle de l’eau est important à se remémorer. L’eau des glaciers, l’eau des cours d’eau … L’évaporation et l’évapotranspiration … Contre les idées reçues, l’évapotranspiration a une grande importance dans les quantités de précipitations. Sous notre climat, la moyenne de consommation d’eau d’un arbre adulte est de 200 litres d’eau par jour. Une large partie étant renvoyée dans l’atmosphère.
Ce rapport entre évapo-transpiration et précipitations va dépendre du type de plantes, de la température, et in fine du climat concerné. Les plantes grasses ne transpirent que très peu, par exemple.
Sous notre climat c’est pour s’en faire une idée indicative: parfois un peu à partir de 25°C, et plus souvent à partir de 30°C que nos plantes en C3 ferment leurs stomates. On dit qu’elles entrent en pseudo-dormance, ou dormance estivale. La respiration est également ralentie. Mais il semble qu’il y ait adaptabilité. Les indicateurs de températures supérieures sont plus stressants.
Cycle du phosphore [géologie. climatologie. pédologie].
Le phosphore n’a pas de cycle aérien. Qu’il soit au sol ou dans l’eau, il se trouve très rapidement sous une forme non assimilable par les plantes. Il s’en suit que les quantités de phosphore dans les parcelles cultivées sont gigantesques mais inutilisables. On a pendant des décennies introduit du phosphore aux parcelles. Plutôt en vain.
Les plantes pour avoir recours au phosphore dépendent du pH 5,5-6 mais aussi beaucoup de la fonge: la rhizosphère. Par ailleurs, les sidérophores: des bactéries peuvent également permettre la biodisponibilité du phosphore, et les Poaceae en situation de carence en fer produisent des phytosidérophores. Les vers de terres semblent aussi cités.
Noter que le labour dérange les mycètes.
Le phosphore est plutôt très fixé aux particules. Aussi, lorsqu’il quitte le sol, c’est beaucoup par érosion (eau, vent).
Cyme [descripteur. Botanique] :
Inflorescence où tous les axes sont terminées par une fleur, notamment l’axe principal possède une fleur qui bloque la croissance de cet axe, renvoyant à la production d’axes floraux sous-jacents. Si bractées, elles apparaissent comme opposées à la fleur.
D. Haut de page
Décurrent [descripteur. Botanique]:
Prolongation d’un organe sur un autre. Le limbe d’une feuille peut être décurrent sur la tige et forme alors des ailes.
Denté, denticulé [descripteur. Botanique]:
Marge d’une feuille. les échancrures donnent lieu à des dents: comme des lobes mais triangulaires aigus.
Denticulé: marge bordée de petites dents.
Dérive [en rapport à un concept. Sciences dites de l’évolution et afférentes]
J’ai du utiliser ce terme dans le contexte de spéciation. Voir endémovicariance à vicariance.
Dicotylédone, ou extensivement dicot [Ancien groupe de la systématique en botanique, dite de l’évolution. Botanique pratique.] :
Qualifie une plante dont la semence est formée de deux cotylédons. Ces cotylédons s’expriment de manière foliaire sur les plantules. Et chez de nombreuses espèces, les plantules montrent deux petites feuilles : les cotylédons. Les feuilles des dicots montrent souvent des nervures ramifiées.
Digité.e [descripteur. Botanique]
voir: palmatiséquée.
Dioïque [concept. Botanique. Biologie]:
Espèce présentant de manière séparée des individus à fleurs mâles et des individus à fleurs femelles.
Diorite [Géologie. Lithologie]
Roche plutonique grenue. Roche intermédiaire. Plus pauvre en quartz que le granite, ou dépourvue de quartz. Se différencie du gabbro par l’absence d’olivine.
Distal [descripteur. Botanique]:
Contraire de proximal. L’apex est distal. Partie la plus éloignée de la fixation d’un organe.
Distique [descripteur. Botanique]
Qualifie la disposition d’organes le long d’un axe: sur deux rangs, et dans un même plan.
tristique: sur trois rangs.
Dynamique [Concept botanique. Concept phytosociologique]:
La dynamique d’une population, d’un taxon désigne sa capacité d’expansion, de colonisation.
En phytosociologie, par contre, la dynamique correspond à la rapidité de la succession (+-) « naturelle » d’une communauté végétale vers une nouvelle communauté végétale: par exemple de la prairie vers la forêt. Exemple la dynamique d’une prairie est bloquée par la régularité de la fauche.
E. Haut de page
Ecaille [descripteur. Botanique. organes]:
Sorte de petit organe plat accompagnant et/ou protégeant certains organes. Notamment parties des cônes de gymnosperme (pomme de pin au sens large : ses différentes petites pièces directement visibles). Extensivement, écaille est utilisée pour décrire des feuilles axillantes des fleurs tubulées au centre d’inflorescences en capitules. Dans ce cas, j’ai tendance à utiliser le terme de bractéole (si elle n’est pas translucide, et si elle est axillante).
Ecologie (Auto-écologie)
Situation préférentielle d’une espèce ou d’un groupe d’espèce. Voir: Ellenberg (échelle); Voir également: Raunkaier (échelle)
Ecologie (climat):
Sur ce site, le climat concerné est franchement océanique et subocéanique (océanique altéré). L’hexagone connaît également une bande de climat continentalisé à l’est (subcontinental ou semi continental), de climats méditerranéen et « subméditerranéen », ainsi qu’un climat montagnard. Les flores et guides expriment en général: les climats méditerranéen, sub méditerranéen, (sub-) continental, océanique, montagnard.
Noter cependant que biogéographiquement: le limousin, et plus généralement le massif central est (parfois) raccroché à l’aire d’Europe centrale, et est considéré comme continental (i.e: colinéen et moyenne montagne non atlantique), avec présence notamment de Chênaies-Hêtraies (le Hêtre étant tout de même peu courant dans mes pérégrinations en tous cas, sur la frontière nord du parc de Millevaches.). L’influence collinéenne est perceptible sur les températures.
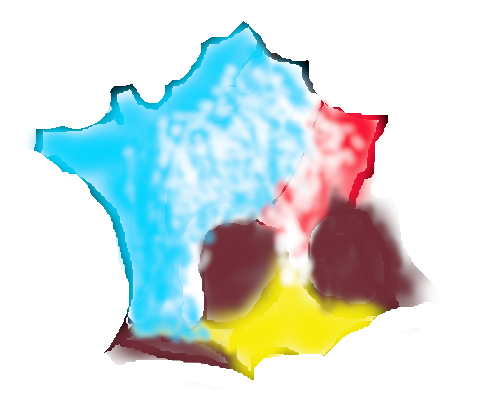
S’articule avec la température (altitude) dans l’échelle d’Ellenberg. Correspond à continentalité dans cette même échelle.
Le climat a une incidence sur les plantes (adaptation de celles-ci), sur les communautés de plantes que l’on peut trouver mais aussi sur les processus biogéochimiques du sol.
Concernant les vastes échelles de temps, et au niveau planétaire (sachant que l’optimum climatique médiéval comme le petit âge glaciaire étaient disposés sur l’Atlantique Nord)

RCraig09, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons
Ecologie (géologie)
La géologie peut avoir une incidence sur la partie du sol qui concerne les plantes. La géologie de l’Hexagone est consultable sur le BRGM. Cela demande quelques connaissances.
La carte géologique, la carte hydrogéologique et la carte des grandes végétations sont dans une totale correspondance. Sans surprise.
Les roches de surface peuvent être différentes des roches géologiques (lesquelles sont présentées sur les cartes du BRGM).
Aussi une carte lithologique (bien que témoignant de roches très affleurantes) est peut-être d’appréhension plus aisée …
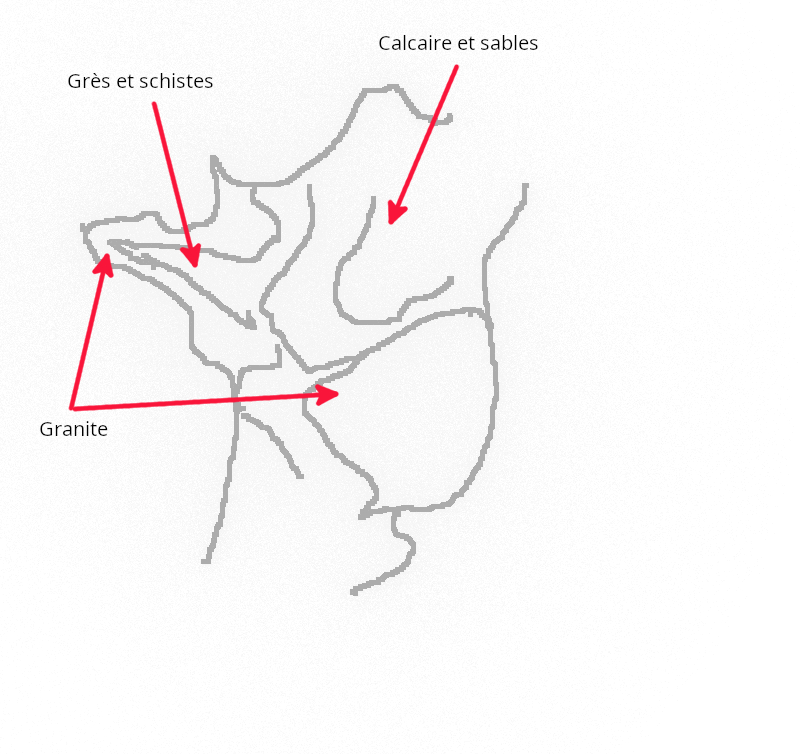
L’écueil de certaines cartes géologiques est l’expression en nom de datations de morphogénèses des roches, et l’obligation alors de consulter le livret d’accompagnement. La nouvelle version BRGM d’infoterre est par contre vraiment très pratique. Le nom des roches est demandé dans les relevés de plantes.
Noter qu’en dehors du climat, et de la géologie, un relevé de plantes réclame le plus souvent les données phytosociologiques correspondantes, parfois simplifié avec un code EUNIS (code que j’aime moins)
Le recours aux fondamentaux de la pédologie aide certainement à comprendre bien des petites situations.
Quelques roches:
Selon la taille des grains: argile, limon, sable
Selon la nature: ardoise, argilite, basalte, diorite, calcaire, gabbro, gneiss, granite, granodiorite, grauwacke, grès, micaschiste (mica), olivine, péridotite, plagioclases, quartzite (quartz), serpentinite, siltite
Ecologie (Incidence humaine, historique des parcelles)
Les humains ont une grosse influence sur le paysage. Il peut éventuellement et parfois arriver le besoin de connaître l’historique du « paysage », de sa partie étudiée. Dans ce cas, il y a d’abord la possibilité de demander aux habitants.
Le site géoportail présente la topographie, les grandes missions de photographies aériennes, les parcelles cadastrales. Assez riche en enseignements.
L’observation des artefacts, et éventuellement du grand type d’habitat peut occasionnellement orienter la réflexion. Cela demande une certaine attention. Talus (haies), murets, terrasses, etc. Habitat concentré ou dispersé.
Voir Pratiques agricoles (3 grands traitements). Et voir également Feu
Ecotone [Concept. Ecologie]
Zone de transition entre types de formations végétales distinctes et écologiquement homogènes. Les lisières sont des écotones.
Ecotype [notion. Botanique]:
Groupe d’individus au sein d’une même espèce adaptés à des conditions écologiques particulières, avec le plus souvent une morphologie ayant des traits distincts. A distinguer de variété dont il peut sembler analogue, car ne rentre pas dans la nomenclature. Moins bien défini que cette dernière, il est à considérer comme un accommodat.
EEE
Pour désigner ce qui est catégorisé comme les Espèces Envahissantes Exotiques. Voir: Envahissant
Ellenberg (échelles d’)[notion car doit être adaptée pour chaque région climatique. Ecologie. Phytosociologie]:
L’échelle d’Ellenberg sert à classer les contraintes écologiques propres à la satisfaction des différentes espèces. Cette échelle concerne l’auto-écologie des espèces: les optima. Il y a plusieurs aspects qui viennent contrarier l’appréhension de l’écologie d’une espèce ou d’un groupe d’espèces par l’amplitude.
Par exemple, si dans une communautés d’espèces, il y a de la place. Cette communautés va pouvoir laisser du « mou » à l’apparition d’espèces moins strictement caractérisées par les valeurs écologiques que propose le type d’écologie de cette communauté; niche « ouverte », donc. Cette question de niche ouverte devant parfois être mise en rapport avec un phénomène s’exprimant sur un autre plan (en pédologie). Si l’on trouve une plante basiphile sur un sol acide (ou une plante basiphile parmi une communauté acidophile), des conditions sont probablement présentes: à savoir un phénomène tel la formation de l’humus qui sera à même de tamponner l’acidité du sol, acidité qui serait autrement toxique pour la plante basiphile.
Autre exemple, il y a une sorte d’interpolation entre la présence de plantes nitrophiles selon le degré d’humidité du sol et selon la latitude.
L’échelle d’Ellenberg utilise ces critères. Les « notes » ont été adaptées à nos régions par le phytosociologue Philippe Julve:
- lumière indiquée de 1 à 9 (la médiane étant 5)
- température indiquée de 1 à 9 (la médiane étant 5)
- continentalité indiquée de 1 à 9 (la médiane étant 5)
- Humidité atmosphérique indiquée de 1 à 9 (la médiane étant 4)
- Humidité du sol indiquée de 1 à 12 (la médiane se situant entre 5 et 6, ou: 5 et 6)
- Potentiel hydrogène indiqué de 1 à 9 ( la médiane étant 5)
- Nutriments présents aux sols indiqués de 1 à 9 (la médiane étant 5)
- Salinité (sel et chlorures) indiquée de 1 à 9
Elliptique [descripteur. Botanique]
En forme d’ellipse. De forme ovale, mais dont la plus grande largeur est vers le milieu du limbe
Emarginé [descripteur. Botanique]:
Qualifie un organe légèrement échancré au sommet.
Embrassant [descripteur. Botanique]:
Qualifie une feuille sessile dont l’extrémité basale enveloppe partiellement ou totalement la tige.
Endémisme [concept. écologie]
L’endémisme concerne le zonage géographique d’une espèce. En fait. Urtica atrovirens est présente seulement en Corse (un tout petit peu en région PACA également il me semble): elle est donc endémique de la Corse. Le lion, la girafe sont endémiques des biomes de savanes africaines. Le jaguar est endémique des forêts méso et sud américaines (plusieurs biomes).
L’endémisme strict concerne des zonages géographiques très limités: pays, régions départements, îles.
Le mot « endémique » tel qu’utilisé vernaculairement provient de la médecine. Le sens est le même. La malaria est endémique des régions intertropicales notamment d’Afrique. Il s’agit là de Plasmodium falciparum. Mais en médecine, l’endémie s’articule avec les notions d’épidémie (ou même de pandémie): il s’articule donc avec la notion de conquête territoriale d’un pathogène.
En ce sens, l’endémisme écologique ne connaît pas une telle articulation. Une espèce cosmopolite est une espèce très largement répartie dans le monde, sans que la notion de conquête plus ou moins soudaine intervienne. Et le cosmopolitisme s’oppose à l’endémisme.
Energie [Angle de lecture]
L’énergie semble avoir un lien assez intéressant avec la fitness. Cela s’exprime de manière un peu particulière en ce qui concerne la botanique. Les plantes compétitives comme des arbres, le sont parce qu’elles bénéficient d’une situation favorable: plus grande étendue des racines, ombre portée de leurs ramifications limitant la concurrence. I.e: cette limitation de concurrence se traduit par une limitation trophique pour les autres plantes. Ces plantes compétitives produisent potentiellement peu de fruits. Beaucoup moins que les annuelles, qui sont les moins concurrentielles, les plus « faibles ». Aussi, ce n’est pas tant la descendance que l’on observe vis à vis de la trophie que les espèces en présence (communauté de plantes eutrophes ou oligotrophes), ou bien leurs vigueurs (si elles sont individuellement plutôt plus grandes, plus robustes ou plutôt plus petites qu’habituellement). Il y a aussi plus d’énergie passée dans une plante robuste comme arbre que dans une petite annuelle (visible à la quantité de carbone par plante).
L’aspect trophique, l’énergie, est en général est un bon angle d’approche selon moi.
Par ailleurs considérer des phénomènes distingués non seulement par leurs qualités particulières, mais aussi comme des équivalents énergie m’est particulièrement pratique pour entreprendre Homo sapiens et son emprise sur l’environnement. Un lieu rudéral par exemple ne l’est que parce qu’il s’est passé quelque chose, et donc qu’une énergie a été injectée dans l’environnement. Les cultures nécessitent l’injection d’énergie. C’est de cette manière que les limites planétaires m’apparaissent comme le reflet de l’énergie utilisée essentiellement par Homo sapiens. Pour le dire autrement, à part Homo sapiens, et exclusivement sous la responsabilité des sociétés que Descola qualifie de naturalistes, seuls des volcans ont la possibilité de franchir certaines de ces limites.
Ensiforme [descripteur. Botanique]
Ensi- en forme d’épée. Plus précisément, feuilles longues en formes d’épées, aplaties latéralement et imbriquées en faisceaux, comme face contre face. Voir les feuilles d’Iris. Ou voir le Serment des Horaces de Jacques Louis David.
Entier [descripteur. Botanique] :
Qualifie le limbe d’une feuille, d’un pétale, d’un sépale, d’une bractée qui n’est ni denté ni lobé ni crénelé.
Envahissant [notion car concept en cours de détermination]:
Notion un peu difficile. Depuis mars 2024 (parution du la revue Naturae numéro 4), le terme Invasive désigne strictement la dynamique d’une plante exogène. Or la problématique liée aux plantes envahissantes se situe au dernier degré du type d’invasion, tel que désormais admis. A savoir si la plante est: transformatrice. Sur ce site, je conserve en tous cas pour l’instant la notions d’invasive (sous les termes EEE et Envahissant) pour les espèces que l’on doit en principe décrire maintenant comme transformatrices. Ce qui correspond du reste à la terminologie de l’Union Européenne.
En effet, il y a deux aspects. 1) La dynamique d’une espèce. Des espèces indigènes ou naturalisées peuvent avoir une forte dynamique sans impact, sans produire de transformation sur le milieu. 2) L’impact: lorsque des espèces transforment le milieu en zone paucispécifique (ici, encore si on prends des bambous à chaque fois indigènes que ce soit en Chine ou en Amazonie, leurs colonisations post rudéralisation produisent des communautés plus ou moins grandes mais à chaque fois pratiquement monospécifiques. Il peut donc y avoir des espèces indigènes ayant un trait de transformatrice. Je n’aperçois pas ce cas a priori dans l’hexagone.)
Ce qui peut me déranger dans la terminologie d’invasive=exogène dynamique s’explique par la notion de post-invasive.
Post invasive. Une post invasive est une espèce que l’on ne considère plus comme invasive du fait d’un ralentissement ou d’un arrêt de sa dynamique populationnelle. Or cela peut induire plusieurs hypothèses, dont l’une pourrait être que cette dynamique est en fait une dynamique normale. Or si la dynamique est normale, cela sans impacter l’environnement, et que malgré cela elle a auparavant été classée spécialement comme invasive, cela appuie alors sur la dynamique populationnelle des plantes envahissantes. En tirant un peu, si l’on s’attarde beaucoup sous cet angle. Cela ne décrit plus un phénomène particulièrement botanique (comme l’expansion), mais un phénomène psychologique dans des cultures ou des sous cultures de certaines sociétés humaines: l’inquiétude, en l’occurrence … De voir des espèces montrer une telle puissance de conquêtes. Bien entendu, ce type d’interprétation se révèle alors à côté des clous. Mais néanmoins, je préfère suivre les « tablatures » de Jauzein en tous cas pour l’instant, puisqu’elles dissocient déjà la dynamique de populations et l’éventuelle capacité de nuisance de telle ou telle espèces (en tel ou tel lieu)
Si, ces nouvelles définitions semble pouvoir vider peut-être et sur la marge un peu de son sens le terme d’invasive, cela met surtout en valeur les 2 aspects en les séparant clairement. Et du côté de la dynamique, pouvoir peut-être mieux questionner les blooms, les accélérations un peu soudaines quand il y en a.
Facteurs: Les facteurs permettant à cette problématique de surgir sont à la fois des facteurs internes à la plante (amplitude écologique, allélopathie, etc.) et des facteurs externes (la niche écologique présente suffisamment de place, rudéralité, ombrothermie, nutriments).
Pour le cas général, sont considérées envahissantes les espèces (quelque soit leur règne) ayant un impact significatif et négatif (notamment en termes de diversité) sur l’environnement.
Epi [descripteur. Botanique. Typologie des inflorescences] :
Inflorescence (fleur complexe) allongée dont toutes les fleurs sont sessiles et insérées sur un axe central. Si fleurs non sessiles, il s’agit d’un racème.
Epillet [descripteur. Botanique]:
Partie élémentaire d’un épi, d’une grappe de Poaceae. Voir: Fleur (structure; Poacae)
Equipement
Sortir couvert. Manches fermées. Vêtements tout aussi que fermés que possibles (tiques). Une casquette, un chapeau et de l’eau par temps chaud. Si temps vraiment chaud, préférer de l’eau faiblement ou microsalée.
Bonnes chaussures ou bottes selon les endroits.
Eventuellement papier. Crayon: de quoi prendre des notes. Ou en tous cas les fiches de relevés. Surtout si on veut faire le truc.
Quelque chose de précis pour mesurer. mesures millimétriques (normalement inséré dans les flores et guides).
De quoi faire un point GPS (cf: logiciel de cartographie).
Optique: loupe X30 pour les végétaux, mais loupe x10 pour les pierres. Appareil photo (macro pour les détails les plus fins, et dans ce cas un pied peut être utile). Un petit microscope. Une loupe binoculaire si possible (je n’en ai pas)
(Drone?)
Cadre 1×1 m (quadrat) si c’est le programme diversité, normalement confié par l’organisateur qui vous convie.
Flores et guides. Voir biblio.
Sa mémoire!
Logiciel Qgis pour la cartographie.
Espèce [Concept fondamental. Toutes sciences afférentes à celles dite de l’évolution]:
L’espèce outre le fait d’être un rang taxonomique, est déterminée biologiquement (elle a une descendance durablement féconde), génétiquement, et est plutôt morphologiquement bien distincte. Elle est constante, morphologiquement, génétiquement. Sa valeur statistique est donc : « toujours ». Soit, plus forte que pour une variété, et plus forte encore que pour une forme.
La labilité de ce rang d’espèce existe parfois … Elle me semble assez souvent à mettre en lien avec les différents types de spéciations existants: spéciation par vicariance (allopatrique), spéciation par hybridation, par migration (voir à ploïdie), par colonisations de niches. Mais parfois également, voir ci-dessous la continuité des espèces.
Des variations dans le rang d’espèce peuvent dépendre en outre de la méthode de définition d’une espèce. Méthode classique morphologique, méthode génétique … La méthode morphologique peut poser des problèmes (voir le genre Festuca ou Brassica). La méthode génétique est susceptible de donner parfois des résultats qui ne sont pas traduits morphologiquement. On ne voit rien. Ce qui rend l’identification beaucoup moins pratique ou même tout à fait impossible, en fait (sauf à posséder le bon gros laboratoire).
Jauzein préconise donc la méthode cytologique qui permet de reconnaître visuellement les différentes espèces tout en étant beaucoup plus pertinente que la méthode classique morphologique. Mais il s’en suit que les rangs choisis (espèce, sous-espèce …) ne sont pas toujours identiques à ceux de la méthode génétique.
En outre le nombre d’études permettant d’accorder le rang de genre, d’espèce, de sous espèce n’est pas toujours communiqué.
CONTINUITE DES ESPECES
Déterminer une espèce implique une sorte de cadre homogène, qui peut paraître a posteriori comme établi d’autorité. Mais si cela fonctionne, on peut se dire que ce n’est pas trop mauvais.
Ainsi il existe des continuités sans intérêt particulier qui sautent les éléments de la classification tels que répertoriés. L’ornithorynque possède un bec, mais qui plus est un bec qui conviendrait à un canard (anatidé), simplement il n’a pas de plumes mais surtout il a des poils. Les poils étant une caractéristique majeure des mammifères. L’exception ne fait pas la règle, et on aime avoir une classification la plus homogène possible.
Le plus souvent, ou assez souvent, les groupes sont beaucoup plus dans une continuité, plus difficile à appréhender. Dans ce contexte, les botanistes essaient d’établir ce qui appartient plutôt à cette espèce, ce genre qu’à une autre espèces, un autre genre. Ce qui est recherché c’est un groupe homogène.
Il peut parfois en ressortir un aspect un peu autoritaire. Ainsi pour déterminer si deux « types » de Carex leporina sont des sous-espèces ou des variétés, la génétique (la chorologie laissant sans doute une part de doute) a répondu qu’à moins de 1% de différence, il s’agit d’une variété.
HOLO-ESPECE?
Le concept d’holo-espèce, parfois présenté de manière à interroger le concept d’espèce, n’épuise en fait pas la pertinence du concept d’espèce, puisque le caractère symbiotique (notamment avec des bactéries) de toutes les espèces, l’est aussi en fait pour chaque espèce, exceptions faites des procaryotes (mais ici c’est de la plante, pour l’instant on s’en fout).
ESPECE BINOMIALE.
L’espèce est indiquée par un binôme du nom du genre et de son épithète.
Geranium dissectum présente le nom du genre Geranium accompagné de l’épithète dissectum, en référence à ses feuilles découpées.
Adansonia digitata. Le nom du genre est donné en hommage au botaniste Michel Adanson, et l’épithète souligne que les feuilles sont digitées. Ce qui est le cas aussi des autres Guye (Baobab).
Etamine [descripteur. Organe. Botanique]:
L’étamine est donnée comme la pièce mâle de la fleur. Elle produit du pollen, des gamètes dites mâles qui iront féconder la partie femelle de la fleur (le gynécée ou pistil). L ‘étamine est constituée du filet, et tout en haut des anthères. En tous cas des anthères, le filet étant facultatif (anthères sessiles).
Etats alternatifs stables [Loi. Concept. Ecologie]
Voir Hysteresis
Ethologie (une discipline)
L’éthologie concerne l’étude du comportement (en principe animal. Et n’existe pas pour les plantes). Des données d’éthologie peuvent permettre l’aide à la spéciation des espèces animales. Pour comprendre par des activités de quoi il s’agit, je renvoie à Physarum polycephalum et cie, puisque l’éthologue Audrey Dussutour, ayant eu besoin de données à grande échelle a organisé une popularisation pédagogique du « Blob ». C’est vraiment très drôle. Cela peut faire un très bon cadeau.
Sous l’angle de l’éthologie, l’intelligence, la pratique des outils, etc. Le rapport inné/acquis, lequel a depuis longtemps été remis en question, n’apparaissent pas comme des spécificités de l’espèce Homo sapiens.
Eu- :
Vrai. Ou par adjectivation : véritablement, vraiment. Très, beaucoup par extension. Eutrophe : satiété assurée. Eudicotylédones : groupe des vraies dicotylédones (une sorte de subtilité de la classification).
EUNIS [(nouvelle) organisation des communautés de plantes. Plus pratique]
Le code EUNIS est un référentiel permettant la qualification des végétations de manière simple, précise et intuitive.
Il s’agit cependant d’un référentiel très simplifié vis à vis de la phytosociologie, et je ne l’aime pas beaucoup.
D’une part, parce que d’autres disciplines s’appuient déjà sur la phytosociologie (éco paléontologie), d’autres part parce qu’il m’apparait trop peu précis pour mettre en valeur comment s’articulent les différentes caractéristiques qui témoignent d’un « phytopaysage » … Comment s’articulent les influences du climat, de la géologie (on est sur du très large), mais aussi de la lithosphère, de la pédologie, des influences biotiques, et notamment des influences humaines …
Cependant des caractéristiques phytosociologiques demandent plus de temps, et selon les situations, il n’est pas garanti d’obtenir un niveau de précisions supérieur au code Eunis.
Exogène [concept. Botanique]
Contraire d’indigène. La plupart des exogènes sont des occasionnelles. Autrement dit, elles disparaissent 🖖🏾🖖🏾. Certaines peuvent encore être subspontanées et pour les plus veinardes, elle peuvent même parfois se naturaliser.
F. Haut de page
Falciforme, falquée [descripteur. Botanique]:
En forme de faux. le limbe d’une feuille est courbé d’un côté, il est arqué.
Feu [écologie et sciences de l’humain; agriculture: typologie]:
Le feu est un traitement particulier que l’humain applique à son environnement. Très rare dans l’hexagone, il est interdit. Il se distingue en trois types:
- l’espace est débroussaillé, et ce qui est exporté est brûlé à part
- Le feu n’est mis qu’au parties aériennes des végétaux.
- Le feu est mis au sol.
Ce dernier cas est le plus particulier. Car il brûle la partie superficielle du sol et la vie qui en est constituante. Ce type de feu pour ne pas avoir d’impacts à long terme sur le sol doit être écarté par des périodes d’environ 10 ans. Mais cela dépend aussi du climat.
C’est ce dernier type de feu qui est utilisé dans les essartages amazoniens. Or l’impact sur le sol est probable. Impliquant l’hypothèse d’une modification écologique mais ne brisant pas le fait de successions vers la forêt arborescente (a savoir quelles incidences sur la particularités des groupements végétaux en post-abandon?). A cet aspect s’ajoute tant chez William Ballée que chez Glenn H. Shepard Jr l’observation d’une plus grande biodiversité à proximité d’anciens hameaux. Et donc la nécessité d’une certaine délicatesse peut-être dans la circonscription des groupements végétaux amazoniens.
L’avantage du feu pour les plantes: restitution d’une grande quantité de K, P à travers les cendres. Et éventuellement compenser l’acidité de certains sols.
Le feu n’est pas le seul moyen d’obtenir des essarts. Ce type de feu peut connaître une autre fonction. Les plantes fleurissent globalement mieux à la lumière. Des fruitiers ou d’autres plantes utiles d’ourlets peuvent être recherchés. Le feu permet d’agrandir la lisière.
Le feu est connu par plusieurs espèces d’Homo, dont la nôtre qui continuons à l’utiliser. Le feu correspond à une utilisation d’énergie. En Australie, 2 milans et un faucon ont été signalés comme utilisant le feu (Milvius migrans, Haliastus sphenurus, Falco berigora). Il s’agirait en ce qui concerne ces rapaces d’une technique de chasse.
Fersiallitique [pédologie]
Les sols fersiallitiques sont des sols que l’on trouve essentiellement en climat subtropical. Dans l’Hexagone, en climat méditerranéen. Surtout Bouche du Rhône (et ponctuations du Causse du Méjean, et de l’arrière pays niçois). La pédogénèse diffère de ce que l’on trouve ailleurs de manière dominante dans l’Hexagone. Ces sols sont très riches en argile fine, stables. Ils sont rubéfiés. Le fer de la roche mère s’est oxydé. Ils sont donc riches en oxyde de fer (Fe2O3), mais aussi en Silice et en Aluminium. Ils sont plutôt de pH neutres, et présentent une saturation importante (cations). La disponibilité en Fer favorise l’échange pour le phosphore.
Le climat tropical, connait quant à lui des sols ferralsoliques, ferrugineux, ferralitiques. Ces trois types de sols sont susceptibles donner lieu à un horizon latéritique (durcissement très prononcé en surface du sol, cuirasse)
Filet [descripteur. Partie d’organe. Botanique].
Pièce des étamines soutenant les anthères. Les étamines n’ont pas toujours de filet. L’anthère pouvant être sessile.
Fitness
Voir adaptation
Fleur [descripteur. agrégat d’organes. Botanique] :
La fleur au sens strict est composée du gynécée et de l’androcée. Sur ce site, le terme fleur est utilisé au sens habituel ou vernaculaire, et parfois au sens le plus strict, mais alors c’est indiqué.
Fleur en languette [descripteur. Botanique. typologie des fleurs] :
Chez les Asteraceae (pâquerette), concerne les fleurs extérieures ressemblant à des pétales. Voir ligule pour plus de précisions.
Fleuron [descripteur. Botanique. Typologie des fleurs]:
Fleurs de petites taille. Chez les Poaceae, la fleur au sens strict, et parfois lemme et paléole. Voir structure de la fleur chez les Poaceae
Fleur, structure (Poaceae):
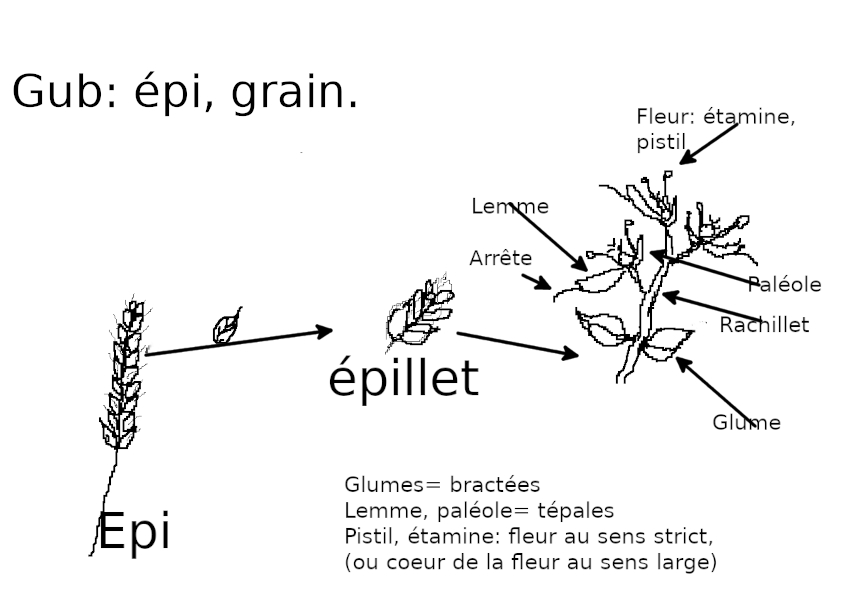
Fleur tubulée [descripteur. Botanique. Typologie des fleurs].
Chez les Asteraceae, concerne les fleurs souvent très petites se trouvant au moins au cœur de l’inflorescence. Elles ont en effet des pétales dont la base soudée forme un tube.
Foliole [descripteur. Botanique]:
Les folioles sont les parties du limbe d’une feuille composée. Elle ressemble à de petites feuilles mais n’ont pas de bourgeons à la naissance de leurs axes. L’axe principal ou s’insèrent les folioles est un rachis.
Forma; forme [Concept. Botanique]:
S’écrit: fo ou f. Catégorie taxonomique très mineure. Rang presque le plus bas juste avant subforma. Rang sans pertinence particulière. Morphologie divergente vis à vis de l’espèce ou de la variété, mais cela étant plutôt considéré comme une sorte d’accident. La différence morphologique est attribuable à une mutation sporadique. Sa valeur statistique est considérée conséquemment comme faible, plus faible que celle de la variété, et bien plus faible que celle de l’espèce. On peut presque dire d’une plante dont que l’on qualifie au niveau formel: « cela arrive ».
Friche [concept ou notion selon la rigueur d’utilisation. Phytosociologie. Ecologie]:
Au sens large: abandon de cultures laissées à la dynamique des successions naturelles. Il s’agit de formations post culturales au sens large, en tous cas rudérales, surtout pionnières, et à distinguer des ourlets. Senso stricto pionnières rudérales (souvent sur sols riches), en reconquête sur des sols dénudés.
G. Haut de page
Gabbro [lithologie. Géologie]:
Les gabbros sont des roches plutoniques à texture grenue de pH basique. Se différencie du granite car possédant de l’olivine et ne possédant pas de quartz. Le quartz se remarque bien à l’oeil nu.
Géomorphologie [une discipline]
La géomorphologie a pour objet l’étude des reliefs. La discipline s’intéresse donc aux reliefs et à leurs formations, à l’érosion et aux sédiments. es reliefs de types naturels sont concernés par la géologie, l’érosion (etc.) Deux sous-disciplines indiquées comme transverses sont peut-être plus particulièrement intéressante (?) L’une s’occupe de l’influence du vivant, l’autre de l’influence d’Homo sapiens. Le pendant de la terminologie écologique « Ingénieurs de l’écosystème » est dans cette discipline: la biogéomorphologie (qui semble se distinguer de la géomorphologie humaine -ici aussi, Homo sapiens semble détaché de sa phylogénie). Dans cette dernière l’influence des végétaux, bactéries, animaux sur l’évolution du relief (piégeage de sédiments, bioturbation, etc.) et les constructions (termitières, nids bombés de fourmis rousses, la formidable Formica rufa, etc.) sont étudiés.
Concernant les régions et espaces concernés par ce site:
Les reliefs du parc des Beaumonts (à Montreuil, 93), et du parc des Guillands (montreuil et prolongé à Bagnolet, 93) sont en grande partie artificiels: Les buttes sont formées par les restes des creusements des anciennes carrières de gypse (le gypse permet d’obtenir du plâtre).
Les reliefs de l’ïle Saint Denis sont artificiels, ils sont formés par l’apport de terre lors de la construction de l’autoroute A 86.
Un peu plus complexe: la Haute Marche (felletinois) et notamment une commune (dont je tais le nom par respect pour une personne) à une vingtaine de km, et faisant face aux Combrailles.
La géologie de la Haute Marche procède à l’instar de la péninsule armoricaine de la chaine varisque ou hercynienne (même « âge »). Les reliefs sont apparus lors de la formation de la Pangée. Les Combrailles marque le point septentrional de la chaine (volcanique) des puys. Mais uniquement de l’autre côté des Combrailles vis à vis de la commune. Les plissements de terrains sont issus de la collision des plaques lors de la formation de la Pangée. Ils n’ont pas donné lieu à la formation de volcans en ce qui concerne les communes visées ici.
Le collinéen est formé de mamelons et de pénéplaines. Les mamelons dominent la pénéplaine. Cette dernière étant creusée et donnant lieu à un fond de vallon où circule des cours d’eau temporaires ou permanents. Vu du fond de vallon, la pénéplaine fait l’impression d’un plateau.
Si je prends le mamelon assez élevé de la seconde commune (je vais l’appeler black mountain): proche du sommet on trouve un important chaos granitique qui je pense fait plus de 2 m de haut et se trouve être de forme sphérique. Ce chaos indique qu’il y a eu une forte érosion.
A l’échelle d’un humain qui est en train de marcher, et non à l’échelle des cartes de géologie BRGM, on va pouvoir se rendre compte (avec un peu d’attention et pas mal de curiosité) que les reliefs que l’on perçoit de loin comme régulier et plutôt comme semblant en pente douce (pas toujours tant que çà, le mamelon précité a une pente moyenne d’environ 20°, soit un drainage déjà un tout petit peu rapide, et comprenant de longues plages à plus de 25) sont pourtant très irréguliers. Dans une prairie que je connais la partie la plus élevée est comme un très large roc très irrégulier et en descendant on parvient sur une prairie plus plane, plus régulière mais semblant comme ridée à mesure que l’on marche: il s’agit d’un effet des reliefs sous-jacent. En continuant à descendre on arrive jusqu’à un mur de soutènement de cette prairie. Le sol de la prairie est donc principalement un horizon de colluvionement. Voir, donc à murets. Le colluvionement dans la région est en partie conduit par l’existence de ces murets, et cela rends plus indistinct les reliefs naturels.
Le colluvionnement c’est l’érosion depuis le sommet vers le fond de vallée en une nappe (une couche ou horizon).
Manche, les photos prises en Manche le sont plus souvent sur sols d’alluvions et de grès (-grauwacke et siltstone). Le paysage est tendrement vallonné. Sinon: littoral: estran, etc. Voir aussi à talus.
Gamète [biologie] :
Cellule reproductrice, qu’elle soit mâle ou femelle.
Glomérule [descripteur. Botanique. Typologie des inflorescences]:
Groupe de fleurs sessiles se présentant en petite boule. Il s’agit d’une cyme.
Glume [descripteur. Botanique]:
Voir fleur (structure, Poaceae). Semble parfois assimilée à des sépales. Je l’assimile à une bractée.
Glycophile [Concept. Botanique. Ecologie]:
Mot formé en opposition à halophile. Souligne la douceur … Concerne les plantes strictement inféodées aux milieux où l’eau qui parvient est douce.
Gneiss [lithologie. Géologie. Pédologie]
Le gneiss est constitué des même matériaux que le granite. Mais les différents constituants sont alignés. Tout comme le granite, il favorise un pH bas du sol
Granit, granite (inclus: microgranite)[lithologie. Géologie. Pédologie]:
Roche plutonique caractérisée par sa granularité : fait d’inclusions de quartz de feldspath, etc. Les roches plutoniques apparaissent par la lenteur du refroidissement du magma, elles sont typiques des affleurements de montagnes. Les sous-sols granitiques favorisent un pH bas du sol.
Granodiorite [lithologie. Géologie. pédologie.] :
Roche granitique, un peu moins dure que le granite, identifiable à certaines de ses inclusions. Les sous-sols granodioritiques favorisent également un pH bas du sol.
Grappe ou racème [descripteur. Botanique. Typologie des inflorescences]:
Inflorescence pourvu d’un axe principal portant des fleurs pédicellées. Si axes secondaires ramifiés : panicule, racème complexe.
Grauwacke [lithologie. Géologie. pédologie]:
Le greywacke est un grès dans lequel on trouve de veine de quartz (en blanc). Ici un grauwacke marin (de couleur sombre). Il ne s’agit pas d’une roche métamorphique.

Alt text: La photos du dessus montrent une pierre constituée de grains assez fort. La nature des grains est homogène. Traversée d’une ligne claire, laquelle est en quartz: du Grauwacke. La photo suivante est en plus gros plan.

Grès [lithologie. géologie. pédologie]:
Le grès est du sable sous forme de bloc rocheux. A distinguer notamment de la siltite. Voir aussi à greywacke. Le grain de la roche est donc visible à l’oeil nu contrairement à la siltite ou à l’argilite.
Grime (stratégie CSR de) [loi, concept ou notion selon la robustesse]:
Le triangle de Grime permet de visualiser des traits écologiques en rapport à des grands types biologiques chez les plantes (correspond à la question des stratégies r-K chez les animaux). Il est donc en lien avec le classement de Raunkaier.
C. pour compétitives; S. pour tolérance au stress, R. pour rudéral
Lien avec le classement de Raunkaier:
- C. correspond aux formations ligneuses: élévation de la plante, profondeur et étalement des racines, étalement foliaire, croissance jusqu’à rapide. Reproduction sexuée pouvant être moindre.
- S. correspond aux formations à chamaephytes: Plantes de croissances lentes, à reproduction moindre. haute altitudes, déserts …
- R. correspond aux formations à annuelles. Les thérophytes misent sur la reproduction sexuée. rapidité du développement, forte reproduction sexuée. Vit dans les friches, les jachères, les cultures sarclées. Plutôt dans des espaces riches en nutriments.
Gynécée [Organe. Pour description botanique]:
Partie femelle de la fleur.
H. Haut de page
Haie bocagère [typologie agricole]:
La haie qu’elle soit sur talus ou non, bordée ou non d’un fossé est à rapporter à une forêt linéaire. Cela qu’elle soit principalement instaurée (on semait les glands de chêne à la volée) ou encore pour sa part de flore spontanée. La Haie était taillée tous les dix ans. La haie bocagère fait partie de la mosaïque paysagère de l’ouest de la France. Longtemps confinée aux notables religieux en Bretagne. Puis démocratisation très lente à partir du XVI (les plus gros exploitants).
La Bretagne fait aussi partie des régions dont des départements ont connus des campagnes de marnage, en tous cas depuis le XVIII ème siècle (Côte d’Armor, Morbihan). Peut-être avant?
Halo-:
En rapport au sel. Halophile qui tolère le sel ou vit dans des milieux salés. Contraire de glycophile.
Hasté.e [descripteur. Botanique]
De forme sagittée, mais avec les pointes, les oreillettes qui divergent vers l’extérieur.
Hélophyte [Concept. Botanique]:
Espèce dont les organes de survie subsistent à la mauvaise saison sous le niveau de l’eau. Elles sont amphibies saisonnières et alors exondées une petite partie de l’année. Ou amphibies permanentes: leurs bases sont toujours noyées. Les aquatiques vivent dans l’eau. En situation encore plus hydrique, donc.
Hermaphrodite (biologie botanique. Descripteur.)
Qualifie une fleur ou une espèce dont les fleurs possèdent un gynécée et une androcée.
Histoire [une discipline]
Discipline s’occupant en principe du passé d’Homo-sapiens avec un grain temporel particulièrement fin. L’histoire peut-être d’un secours pour orienter la pensée vis à vis d’observations sur le terrains. On est sur une richesse un peu formidable au niveau des informations. Pas toujours facile, rien que sous cet angle à mettre en perspective. Voir historique des parcelles
La méthode est extrêmement différente. Presque d’apparence contradictoire, sous certains aspects. Et la méthode ne suffit pas, puisque je recherche des données de recherches articulables. J’avoue être devenu tout particulièrement exigeant vis à vis de la question de la subjectivité d’une part, et regardant vis à vis de la question de la preuve. C’est sans doute regrettable. Mais pour l’instant je mets çà sur le compte d’être devenu vieux con. Ces différences d’approches ne reprochent rien aux disciplines historiques. Cela ne me regarde en fait pas. D’autant qu’il m’importe un peu de me renseigner de ce côté là. Mais elles ont pour effets, soit d’impliquer un très gros travail de ma part, soit de déclencher de la timidité et de considérer alors ce que je lis comme ayant surtout un aspect informatif. Les données ou informations sont donc en ce qui me concerne difficiles à considérer comme outil conceptuel, d’autant qu’il n’est pas toujours possible de croiser les résultats avec d’autres disciplines telles la paléontologie ou l’archéologie.
Je ne suis pas indifférent à la colère que j’ai ressenti avec Fressoz, on est à peu près de la même génération, c’est à dire très influencée par la « méta-anthropologie » (l’anthropologie ontologique si l’on accède à une terminologie descolienne). Son dernier exploit, çà a été de la colère. Il est légitime de remettre en cause le GIEC, lorsque la portée est critique. Mais que pour la portée soit critique, a minima, il est utile d’en lire les rapports. Ce que son discours ne dénote pas. Or ce n’est pas la première fois qu’il y a des sortes de verticalités … Mon propre père, au moins une fois, pour commencer. Et puis … Et puis … Tout cela me remémore, geste rare, le lâché ou même le jeté de livre. Ce type d’attitude contribue à donner le sentiment d’une sociologie un peu particulière des historiens quand tous n’y répondent pas. Un peu à l’instar de ce qui se passe pour les journalistes, dont la plupart sont tout ce qu’il y a de plus chics, mais dont certains font beaucoup de bruits bizarres. Il y a du reste dans toutes les disciplines du reste des aspects très irritants. Ce très regretté Francis Hallé, dans son désir de partager et de populariser la dendrologie, ne s’est pas épargné des inexactitudes dans les ouvrages à destination du grand public (euh non la lignine n’est pas un déchet, ce n’est pas l’équivalent de nos fèces, et quelques chapitres plus haut sa fonction est bien indiquée).
Ce discours: une fois indiqués les tours et détours de l’histoire quant à l’utilisation de l’énergie (est-ce utile?), il faut toutefois admettre les leviers en jeux (ceux qui sont utilisables et ceux qui ne le sont pas, et faire sortir l’énergie carbonée des leviers est un gros problème, car comme noté nous disposons d’autres formes d’énergies. Par contre il n’est pas possible de demander aux bactéries telluriques de bien vouloir changer de comportement afin d’améliorer la situation des sols agricoles vis à vis du CO2). Une fois indiquée l’implication nécessaire des femmes, hommes et instances (& entreprises) de pouvoirs, on peut toujours se reporter à de plus anciens rapports IPCC (communément dit rapports du GIEC), et se remémorer l’un des schémas proposé par le groupe de sociologues qui y travaillait à l’époque. Ce schéma indiquait une voie technologique et autoritaire sur le plan politique, ce que Fressoz rejette. La toute dernière possibilité dans ces anciens schémas était tout simplement qu’il serait décidé de ne rien faire. Ce que l’Amérique du nord semble actuellement vouloir nous suggérer. Une autre d’entre elles était a contrario de promouvoir des modes de productions biologiques, ou traditionnels ainsi des propositions techniques agricoles de ce que l’on se permet parfois d’appeler le « sud global ». Aujourd’hui cependant, alors que des leviers tels que ceux en agriculture qui étaient jugés peu utilisables, chacun essaie une amélioration. Une fois tout cela bien indiqué, et en ce sens on peut écouter Fressoz (et Bonneuil), la question est effectivement celle de stimuler l’écoute sur certains problèmes.
Mais au delà d’une approche pouvant m’apparaître assez superficielle bien qu’intéressante de la thématique, quelque chose d’autre semble encore pouvoir apparaître à travers ce type de discours. Regretter la mise en abstraction de notre planète, de nos sociétés par les scientifiques, c’est d’abord la possibilité d’omettre que ce n’est pas des sociétés qui sont en danger, mais que c’est bien Homo sapiens qui l’est (et par suite, les sociétés …) C’est surtout la possibilité de craindre un gouvernement mondial des techniciens et scientifiques (« holocènologues » disait Bonneuil), sur la base d’exemple auquel le pluriel manque ou encore un peu discutables. Parce que cela nie qu’entre le constat des soucis climatiques et les propositions (si il y en a), des personnes fussent-elles climatologues, physiciennes, etc. Il y a deux moments et deux approches différentes et que dans la seconde approche, la qualité de citoyen intervient. Et que de ce fait, cela devient une histoire de personnes. C’est d’autant plus distinct qu’aucun rapport IPCC ne peut faire de propositions politiques. Ce type de discours contient un peu les germes d’une forme de complotisme.
Holo-espèce
Voir: espèce
Homo sapiens [Une espèce, classée de manière non homogène dans toutes les disciplines]
Homo sapiens est un mammifère hominé du genre Homo. Parmi tous les mammifères terrestres, il se distingue par sa grande glabréité. Une large touffe de longs poils sur le sommet de la tête. Les deux espèces encore vivantes les plus proches sont, on le voit, un peu éloignées (il n’y a plus d’autres espèces du genre Homo): le bonobo et le chimpanzé.
Du côté fonctionnel, le pied semble apparu chez des espèces du genre Homo si je ne me trompe pas. Ce qui est fort pratique pour courir, mais en terrain dégagé. Les bras courts, le fait de ne plus avoir de mains aux membres postérieurs rend beaucoup plus difficile en revanche le fait de se déplacer dans les arbres et d’un arbre à l’autre, bien qu’il grimpe (situation arboricole qui permet d’éviter des obstacles, avec un déplacement en revanche plus lent). L’acquisition de la bipédie, une caractéristique du genre Homo, semble avoir eue lieu en savane arborescente (milieu semi ouvert mais encore sombre) et s’est améliorée dans des savanes plus claires. Noter que l’homme de Toumaï avait la capacité de marcher sur ses doigts, possédaient de longs bras et que son déplacement dans les arbres étaient plus aisé que pour nous. Noter que les espaces ouverts sont l’exception et non la loi. C’est somme toute des espaces semi-ouverts (ou en tous cas partiellement ouverts) qui semblent avoir favorisé cette caractéristique. En ce qui concerne en tout cas Homo sapiens, la faible expression de sa pilosité favorise la synthèse de la vitamine D par la lumière, relativement aux autres espèces de mammifères terrestres, avec éléphants, rhinos, et hippopotames (questionnement sur son confort de vie, son adaptabilité éventuellement), et sachant l’importance du régime alimentaire sur la question de cette vitamine.
Un grand nombre de facteurs sont troublants lorsqu’on intègre Homo sapiens dans une « étude » naturaliste. Il est donc semble t’il exclu en tant qu’animal. On constate sa présence par ses effets.
->Il forme probablement l’objet inconscient (mais aussi parfois conscient, et cela n’est alors plus un problème) de « l’étude ».
-> le fait est qu’il sculpte de nombreux paysages. Qu’il cultive. Que l’on ne considère pas les plantes de cultures comme automatiquement également spontanée. Il introduit certaines plantes de manière volontaire. Mais ce faisant, il transporte involontairement des graines d’autres plantes, des spores, des poussières diverses. En ce qui concerne ce qui intéresse ici, les plantes volontairement introduites sont sorties du champ disciplinaire. Si l’on considère Homo sapiens dans sa phylogénie, donc en tant qu’animal … Il pourrait sembler que les champs de maïs sont naturels (puisque le produit d’un animal. Bon …) Or pour le maïs c’est simple: il n’est pas capable de se reproduire sans l’aide de Sapiens. Si l’on prends le blé. Le blé qui s’échappe est considéré comme une échappée de culture et rentre dans la discipline. Celui qui reste au champ est cultivé. En fait la césure se recrée d’elle même. Cependant, Homo sapiens possède plusieurs traits remarquables:
Sa chorologie couvre la planète.
Il a pour particularité la capacité à un déploiement d’énergie que l’on ne retrouve pas ailleurs. Voir limites planétaires.
En dehors même, de ce déploiement d’énergie, il a domestiqué et transformé morphologiquement plantes et animaux. Il a à minima modifié souvent la couche superficielle des sols.
Il s’est souvent évertué à maintenir des espaces ouverts (participant alors à une plus grande biodivers!té, en favorisant les espèces qui apprécient ce type d’espace).
Cela étant dit, une appréhension positive de la question semble pouvoir être interrogée par l’anthropologie culturelle (Descola). Pourquoi pas. Je ne sais trop quoi en faire, mais il est difficile de ne pas admettre que la vie est une somme de solutions variées, et quand elles concernent l’humain, on dirait que ces qualités (cultures, intelligence, ingéniosités, territorialités) qui pourraient le caractériser, il les exploites avec une plus grande force que d’autres vivants.
Aujourd’hui, il commence à comprendre l’ampleur de sa gaffe.
Ce qu’il faut noter: dans les contextes de l’histoire dite de l’évolution, de la génétique et de la biologie, Homo sapiens va être classé comme le mammifère Hominé qu’il est. Par contre, et curieusement à l’instar des disciplines de l’anthropologie et de l’ethnologie, en ce qui concerne l’écologie de la plante et notamment de ses communautés (i.e, la phytosociologie), Homo sapiens n’est pas classé. Or, son absence de classement tend à révéler non que cela soit du — comme n’importe quel animal- à une absence de rapport avec la discipline … Mais qu’il n’est potentiellement pas classé en tant qu’animal non plus. Voir le fait que la catégorie des ingénieurs de l’écosystème ne le prend pas en compte et donc le distingue (ces ingénieurs spécifiques sont une notion écologique, et non de phytosociologie). Cela pose un problème conceptuel. Notamment en raison des nombreux questionnements plus ou moins récents sur le concept d’espèce (notamment la continuité interspécifique), en raison aussi des interrogations posées dans le sillage des travaux de Descola, et d’autres en rapport avec les notions d’artificialité/naturalité … Et de manière très prosaïque, et moins fortement pertinente peut-être mais tout de même: parce que le fait qu’un aménagement d’origine humaine est susceptible de modifier le sol, l’écoulement de l’eau dans le temps long et même très long, et par suite, l’installation la plus spontanée qui soit de communautés de plantes bien spécifiques, en dehors même des groupes identifiés comme anthropogènes (justesse de l’analyse phytosociologique bien sûr, mais risque de non signalement d’une autre causalité bien qu’importante).
Horizons de sols [pédologie]
Les horizons décrivent la formation et l’évolution stratigraphiques des sols. Les couches de sols. Typiquement: l’horizon O correspond à l’horizon organique, la matière organique qui recouvre le sol. Sous l’horizon O, on trouve l’horizon A (horizon Arable). Dans les sols sarclés, ces deux horizons sont en mélange. Ici, c’est surtout ces deux horizons sur lesquels l’attention est portée.
D’autres horizons interviennent cependant. Sous l’horizon A, un horizon plus minéralisé, également colonisé par le racinaire: l’horizon B. L’horizon B est un horizon d’illuviation. Les minéraux s’y accumulent depuis la surface sous l’influence de l’eau.
Sous cet horizon, l’horizon C, plus grossier, fragmenté recouvre la roche mère (horizon R).
Selon ce qu’il se passe, d’autres horizon interviennent. Ainsi dans les podzols, Entre A et B, se trouve un horizon d’eluviation E. Eluviation signifiant le lessivage vertical des éléments minéraux, sous l’influence de l’eau et du froid. Il s’agit d’un phénomène d’illuviation mais entrainant la perte en minéraux tels argiles, fer, aluminium …
L’horizon FS des sols fersiallitiques prends place de l’horizon A à l’horizon C. Dans les sols bruns, l’horizon S prend place entre l’horizon A et l’horizon C (pas d’horizon B); cet horizon S est riche en oxyde de fer et en argiles.
Etc.
Humus [pédologie]:
L’humus est la partie plus ou moins dégradée du sol, de teinte sombre et est constituée de déchets végétaux et animaux.
La lignine, les lipides et le carbone sont longs à dégrader, les protéines et les sucres de dégradations plus rapides.
Selon la rapidité de dégradation du carbone en azote, il y a plusieurs type d’humus. Cette rapidité de dégradation est liée à la présence d’oxygène dans l’atmosphère du sol ainsi qu’au pH
- Mor: le mor est un humus très acide très sombre, très peu dégradé, formant une couche épaisse.
- moder: La litière est moyennement épaisse. La fonge intervient beaucoup dans la dégradation. Type d’humus un peu typique de la forêt.
- mulls: les mulls oligotrophes à carbonatés sont des sols fertiles. En forêt, ou en tous cas là où la litière est visible, ils se présentent comme très nettement discontinus entre la partie superficielle plutôt peu épaisse, et moins épaisse à mesure de la fertilité, et le sol minéral sous jacent. Ils sont rapidement dégradés. Les bactéries interviennent beaucoup dans les mulls Les mulls oligotrophes contiennent moins d’azote, en principe plus acides, et se dégradent donc plus lentement que les mulls doux mésotrophes et eutrophes. Dans les mulls calciques, une partie de la dégradation va être en partie bloquée par la présence de « gangues » de calcium autour des particules organiques.
Hybride [concept. botanique, etc.] :
Indiqué x. Un hybride est un nothotaxon. Issu du croisement de deux parents de deux sous-espèces différentes, ou de variétés différentes. En ce qui concerne les hybrides entre espèces, si la descendance est durablement féconde, cela tend à interroger le statut d’espèces des parents. Ils peuvent alors être ramenés (ou non) à un statut de sous-espèces. Plusieurs critères rentrent en compte dans la définition d’une espèce.
Noter, voir hybridogène qui me semble plus souvent utilisé dans ce cas: le taux d’hybridation n’est pas forcément de 50% des deux parents. Homo sapiens qui rencontre Homo neanderthalensis ne le rencontre plus suite à sa disparition. Par conséquence le taux de gènes appartenant au second baisse dans les générations suivantes, mais subsiste tout de même.
Les hybrides peuvent être spontanés ou concerner les cultigènes.
Hybridogène :
D’origine hybride.
Hydro
Relatif à l’eau.
Hydromorphose [pédologie]
Une hydropmorphose est une écomorphose arrivant sous l’influence de l’eau, remarquable à la transformation notamment du fer (Fe) dans le sol. Les pores du sol sont saturés en eau longuement ou plus courtement. Créant durant les périodes concernées un espace anoxique. Présence de tâches gris bleu ou gris vertes (due à la période d’engorgement), ou présence de tâches de rouilles (liée à la respiration oxydante de bactéries anaérobies ou à la période d’assèchement: oxydation). Les tâches noires sont dues à du manganèse (Mn) oxydé.
L’hydromorphose provoque des sols de type « gley ».
Comme les minéraux se déplacent créant alors ces tâches rouges et noires, des parties de sols peuvent être éclaircies en gris ou ocre (là où le Fe et le Mn ne s’y trouvent plus). Ici, de type pseudogley (engorgement périodique)
Le gley bleu ou vert est composé d’argile à fer réduit et forme le lit imperméable des plans et cours d’eau. Ici de type gley.
Hydrophile [concept. botanique]
Une plante hydrophile est une plante nécessitant la présence d’eau libre. En zone longuement inondable (plusieurs mois par an).
Hygro [concept. botanique]
Relatif à l’humidité. Une espèce hygrophile est une espèce qui marque de forts besoins en humidité quelle soit atmosphérique ( on parle d’aéro-hygrophilie), ou en parlant d’hygrophilie: il s’agit d’une plante vivant dans des zones courtement inondables (plusieurs semaines par an).
Hypertrophe, indiqué ici hypereutrophe [concept. Botanique. Ecologie de la plante] :
Désigne un sol ou l’azote et le phosphore (de manière peu distincte) sont en quantités très importantes. Le terme utilisé par Philippe Julve est polytrophe. Exemples de plantes hypertrophes : Arctium lappa, Arctium tomentosum, Armoracia rusticana, Asperugo procubems, Blitum bonus-henricus, Chaerophyllum aureum, Chenopodiastrum murale, Chenopodium vulvaria, Convolvulus sepium, Glyceria maxima, Leonurus cardiaca, Urtica dioica, Urtica urens.
Hysteresis [Loi plus que concept. Ecologie (en provenance de la physique, et modifié)]:
Dans le domaine écologique, cela renvoie à des états stables alternatifs. Et cela concerne essentiellement les phénomènes de trophie élevée. A conditions égales par ailleurs, comparé à son état précédent ou à un sol n’ayant pas acquis en azote/phosphore, un sol ayant acquis en trophie va se maintenir dans un état de trophie élevée, ne serait-ce que par la restitution de la biomasse, ou par d’autres facteurs. Il s’en suit que l’élimination de la source de pollut!ons ne suffit pas à rétablir la situation précédente.
I. Haut de page
Impact
décrit à: Transformatrice
Indigène [concept (à valeur temporelle). Botanique].
Plante dont les populations se sont développées sur le territoire concerné sans intervention humaine, ou provenant d’un territoire immédiatement voisin où la plante est indigène. Comprend donc la notion de néo-indigène. Cela souvent entendu comme au-delà des limites temporelles donnée par la lexicographie : par exemple : archéophyte, néophyte. Donc est indigène une plante qui était présente sur un territoire donné avant le néolithique, abstraction faite des grands temps géologiques précédents: i.e: l’indigénat a logiquement lieu au sein de l’époque géologique de l’Holocène (depuis seulement 12 000 ans), agrandir la fenêtre impliquant trop de modifications climatiques et géologiques. Cependant, factuellement, l’indigénat est +- souvent accordé au bout de 50 ans de présence d’une plante sur un territoire donné (pour les thérophytes).
Du fait, des plantes à spores notamment et de leurs répartitions, et notamment pour les lecteurs de Pierre Lieutaghi, et d’une manière beaucoup plus interrogative pour les lecteurs de Françis Hallé, il importe de bien cadrer la temporalité géologique au sein de l’Holocène pour ne pas perdre ce que cela signifie. Les évolutions laissent songeurs et c’est une belle chose.
Les plantes à spores pouvant nous faire remonter trankilou jusqu’au Carbonifère. Ci-dessous une image de la planète à cette période. Notre sol est alors durant cette longue période très animée, souvent plus proche de l’Equateur. Sur l’image … Une fois que l’on sait où est la chaine varisque … Cette chaine hercynienne qui va de l’Asie à la Bretagne correspond à la barre de la partie en T (en ce qui concerne notre continent actuel), chapeauté par une forme un peu en forme de chou-fleur. On se situe bien plus près de l’Equateur. Le carbonifère était période plutôt donnée comme luxuriante. Sa fin correspond à un refroidissement en lien avec une chute du carbone atmosphérique. Le cycle de Milankovitch et qui concerne les modifications orbitales de la planète possède une influence sur les saisons locales mais pas sur les températures mondiales.
Sammy2012, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons:

Infère [descripteur. Botanique]:
Fleur présentant une ovaire qui se trouve sous le calice et la corolle.
Inflorescence [descripteur. Botanique. Organe composé]:
Ensemble de fleurs et de bractées, non séparées par des feuilles vraies.
Ingénieur de l’écosystème [notion de l’écologie].
Ingénieurs de l’écosystèmes désigne les autres espèces que l’humain ayant une incidence significative sur l’environnement. Termites, vers de terres, fourmis, champignons en particuliers, bactéries, castors, etc. Et de manière paradoxale ou déplaisante mais sous certaines conditions, peuvent aussi être incluses les envahissantes (condition de chorologie au moins, car les envahissantes ne le sont pas partout, et à minima ne le sont sauf éventuelles et extrêmement rares exceptions dans leurs régions d’origines).
Si par goût de la distinction 🙂 , Homo sapiens est intégré ici, il faut alors prendre en compte et signaler la capacité qu’il a à utiliser de l’énergie. Les limites planétaires sont le reflet de l’énergie déployée par Homo sapiens. Cette notion issue de l’écologie insiste en effet sur la « naturalité » des effets produits. On aperçoit avec des questions actuelles et moins récentes que la frontière entre artificiel et naturel est apparemment fort visible mais analytiquement plus que floue, sinon sans objet. Si l’on introduisait Homo sapiens dans ce contexte, le concept phytosociologique de secondaire (primaire/ secondaire) s’élargirait potentiellement à certains autres ingénieurs, notamment les manipulations produites par les Castors (impliquant en amont un habitat d’eau calme contre rhéophile). Ce qui ne fait pas à mes yeux trop d’importance, mais attention à rester dans le champ disciplinaire.
Invasive [notion car concept en cours de détermination]:
Voir envahissante, et préférer sans doute ce dernier terme.
Involucelle [descripteur. Botanique. Groupe d’organes].
L’involucelle est comme un involucre mais à la base des inflorescences secondaires.
Involucre [descripteur. Groupe d’organes. Botanique] :
Ensemble de bractées formant coupe (voir l’exemple des Asteraceae), ou une collerette (voir l’exemple des Apiaceae) à la base de l’inflorescence principale.
Interdisciplinarité
La spécialisation des différentes disciplines fait que les chaînes de causalités mises à jours le sont au sein des disciplines concernées.
C’est un point en ce qui concerne la phytosociologie en tous cas mérite une défocalisation, soit au niveau de la pédologie, soit au niveau de la géologie et de la géomorphologie, soit aux niveaux des sciences humaines et sociales.
Tout simplement car une cause de plus grand impact que celle indiquée au sein de la discipline peut être traitée dans une ou plusieurs autres disciplines.
Mais s’intéresser à une autre discipline, ce n’est pas prendre un « nous on a çà », c’est d’abord comment ce « nous » obtient ce « çà ». Autrement dit de se permettre aussi une sorte de visite méthodologique.
Étant donné les particularités des Sciences humaines et sociales, un peu plus de temps, d’expression de ce qui semble s’y passer, et notamment de ce qui semble s’éloigner de ce qui pourrait être attendu est décrit. Sont attendus mais par principe (on ne se mêle non plus de ce qui ne nous regarde pas) l’existence et la bonne constitution des sources primaires, le champ classique de la constitution de la preuve. Toutes possibilités permettant de chasser la problématique de la subjectivité tant de l’auteur que des sujets observés. Quand c’est possible ou nécessaire, et seulement dans ce cas, la conduite rigoureuses d’expérimentations.
Je ne m’attarde effectivement pas sur les disciplines des sciences de la terre et dites naturelles … Car justement, il est plus rare que des choses s’éloignent de ce que je pourrai attendre. C’est seulement quand cela s’éloigne que je me demande ce que je peux en faire (et j’aime pas non plus qu’on me prenne pour un luron).
Un filtrage est donc produit.
Je vais m’expliquer avec l’exemple de l’anthropologue B.
Des livres très charmants. Mais rien ne correspond à rien de ce que je peux attendre. B. utilise des sources journalistiques. Ce sont donc des sources secondaires. Il présume l’honnêteté et l’objectivité journalistique en général. Cette présomption paraît d’abord logique. Cependant le minimum est de vérifier si çà tient. Dire « si il y a une erreur quelque part, il n’y en aura pas dans la masse moyenne » doit être interrogé, vérifié. Or l’observation trouve vite une réponse : le traitement médiatique des musulmans en France depuis les années 90, jusqu’aux USA, en Belgique, et au Canada désormais ne correspond pas nécessairement aux enquêtes d’opinions, et ne correspond apparemment pas aux travaux sociologiques. Il y a sans doute donc l’existence d’un marronnier médiatique de très grande ampleur (lequel ne parle au fond que des médias). Le référendum de 2001 sur le traité de constitution pour l’Europe a également montré un gap entre la société dans son ensemble et les médias. Je pense que les travaux que propose cet anthropologue ne sont pas suffisamment prudents. Par chance, cela ne concerne pas ce qui m’intéresse (en dehors du fait qu’il forme un très bon exemple de ce que je vais avoir tendance à filtrer très fort).
L. Haut de page
Labour (champs) [typologie agricole. Pédologie. Phytosociologie]
Voir Pratiques agricoles et voir Agriculture naturelle/agriculture de conservation
Lacinié, laciniata [descripteur. Botanique].
Lacinié: lanière. Généralement décrit comme « déchirée » finement. En bandes fines.
Lancéolé [descripteur. Botanique]:
Se dit d’une feuille de forme assez ovale, mais étroitement ovale. Nettement plus étroit qu’une feuille ovale, évoquant un fer de lance, et donc plus large du côté de la base.
Languette [descripteur. Botanique. Typologie des fleurs]:
voir fleur en languette.
Lande [descripteur. Jusqu’à concept (?) Phytosociologie]:
Formation végétale basse et ligneuse, régressive secondairement (plus rarement naturellement), caractérisée par les éricacées, également mais moins caractérisant par des ajoncs des genêts. Différents types de landes dont certaines peuvent apparaître proche du prairial. Certaines associations de landes ont été historiquement reversées dans le prairial (2 ou 3 de souvenir).
Les landes étaient broutées, ou encore l’ajonc exporté et broyé pour nourrir le bétail. Pacage faiblement nutritif. En ce qui concerne le grand ouest, fait partie de la mosaïque paysagère agricole. Noter qu’en Bretagne, très longtemps, les bovins étaient libres.
Lemme [descripteur. Botanique]:
Voir: Fleur (structure, Poaceae). Sorte de tépale. Parfois +- pédagogiquement assimilé à des pétales.
Lenticelle [descripteur. Botanique]
Les lenticelles sont des orifices visibles sur l’écorce de certains ligneux afin de favoriser l’échange gazeux du liège avec l’extérieur.
Ligule [descripteur. Botanique. Typologie des fleurs]
Ligule, en référence à langue, languette.
Pour les astéracées, ce dernier terme est préférablement utilisé en raison de la description très précise de « ligule » (fleur plate et tubulée, comportant 5 pétales soudés et repérables à 5 dents au sommet du tube).
Les ligules sont les fleurs extérieures en forme de languettes (de pétales) chez certaines asteraceae. Une ligule est une fleur également tubulée (les asteracées comportent des fleurs tubulées souvent centrales et souvent des fleurs en languettes rayonnant sur le pourtour), mais totalement applatie. Une ligule est une fleur qui comporte 5 pétales soudés entre eux, et présente donc … 5 dents. Dans la vie, on prend rarement le temps de compter ces dents. Donc languette est utilisé par défaut.
Les ligules des Poaceae sont des articles membraneux qui se trouvent entre la feuille (à la base de celle-ci) et la gaine, la tige. C’est un point d’observation courant chez les Poaceae.
Limites planétaire [outil ou notion; descripteur: climatologie. ecologie]
Cet outil permet de montrer un certain nombre d’évènements que les naturalistes sont susceptibles de rencontrer. Il présente un certain nombres de critères dont beaucoup ont excédés le souhaitable. Ces critères sont directement liés à l’activité humaine. Et sont généralement représentés sous forme de roue. Ce qui permet de mettre en autre en valeur leurs interactions. Aussi l’outil Limite planétaire est articulable avec la notion d’anthropocène.
- Dans le contexte du réchauffement climatique:
- le forçage radiatif (effet de serre)
- La concentration en CO2
- Le contexte de l’acidification océanique (zone côtière. L’acidification est liée au CO2 ainsi qu’aux flux bio-géo-chimique)
- Le contexte des aérosols atmosphériques (+ lien avec le forçage radiatif)
- L’appauvrissement de la couche d’ozone dans la stratosphère
- Nouveaux produits, nouvelle allure: il peut s’agir de plastiques, de métaux lourds, etc.
- Dans le contexte de l’occupation des sols:
- La quotité de forêt (estimée à 70% avant les défrichements par l’humanité: ce qui nous renvoie assez loin dans le temps)
- Dans le contexte de la biosphère:
- La biodivers!té au sens large: les pertes ou les changements en biodivers!té. La biodivers!té fonctionnelle peut par exemple faire remarquer un changement de taille dans des espèces fonction d’une datation; La biodivers!té génétique correspond à peu près à la biodivers!té telle qu’on l’imagine en général
- Dans le contexte de l’eau douce:
- L’humidité des sols (actuellement problématique);
- L’utilisation de l’eau douce
- Dans le contexte des cycles bio-géo-chimique, on a évidemment 2 éléments:
- L’azote
- et le phosphore: tous deux des nutriments essentiels à la vie des plantes, mais dont l’excès généralisé tend à faire disparaître les communautés végétales de sols pauvres, par exemple. Donc ici appauvrissement de la biodivers!té. Assez perceptible par un naturaliste: banalisation des espèces, et même des communautés de plantes.
Limbe [descripteur. Botanique]:
Partie principale d’une feuille, généralement plane.
Limon [lithologie. pédologie. agronomie, etc.]
Les limons ont une granularité plus grosse que les argiles, et plus fine que les sables. La taille du grain se situe entre 0.002 mm et 0.05 mm. Leurs pH dépend de leurs natures. Ils réagissent différemment à l’eau: notamment aux pluies. En cas de fortes pluies, les limons ont tendance à former une croûte superficielle sur laquelle l’eau glisse ensuite sans correctement pénétrer le sol.
Les sols limoneux sont par ailleurs appréciés aux jardins en raison de la facilité de travail.
Linéaire [descripteur. Botanique]
Se dit d’un organe long et étroit
Linicole:
Désigne les adventices de la culture du lin.
Lobe [descripteur. Botanique]
Division large n’atteignant pas la moitié du limbe d’un pétale ou d’une feuille, et souvent arrondie. Pouvant se terminer de manière aigue (voir par ex. Ronciné)
Locus, Loci:
Je ne parviens à rendre en français la manière dont on utilise ce terme. Le mot le plus proche est « site » mais dans sa valeur théorique et généralisée-généralisable: partout où l’on construit un barrage, l’eau ralentit. Partout où l’on laboure, les populations de mycètes et de bactéries sont périodiquement modifiées …
Lyré (e)[descripteur. Botanique]:
Présente plusieurs segments dont le terminal est beaucoup plus grand que les latéraux.
M. Haut de page
Malacophyte [concept. et/ou descripteur. Botanique]:
Plante à feuilles tendres, et non épaisses. Normalement caduque. A l’opposé les sclérophytes
Manteau [concept. Ecologie de la plante: Phytosociologie]
Formation arbustive de l’écotone entre un espace ouvert et le boisement. Se formant dans une dynamique vers la forêt. Les manteaux phytosociologiquement décrits sont à comprendre comme l’avenir de l’espace ouvert si les conditions qui en maintiennent l’ouverture cessaient. Voir également Pratiques agricoles, et Feu
Marcescent (e) [descripteur. Botanique]:
Les feuilles ou fleurs sèches restent longtemps sur la plante. Feuilles de Carpinus betulus, par exemple.
Marnage [une pratique agricole]
Le marnage consiste à introduite de la marne en principe calcaire pour faire remonter le pH, et la quotité d’argile dans des sols trop limoneux, trop sableux et trop siliceux. Les meilleures parmi les campagnes de marnages ont considérément améliorées la nature des sols de cultures en Bretagne par exemple. Fin XVIII, en comparaison, le marnage n’était pas pratiquée en Creuse, par exemple. Mais y aurait-il eu une raison pour cela?
Matorral [descripteur. Eventuellement notion si utilisée au sens large. Phytosociologie, phytogéographie]:
terme susceptible d’être utilisé extensivement pour désigner garigues et maquis.
Formation régressive d’arbustes et buissons (la succession est bloquée le plus souvent par le feu) de la forêt à chêne vert.
Garigues et maquis sont également des formations régressives. Le maquis sur sol siliceux (acide), la garigue sur sol basique.
Ces 3 formations sont méditerranéennes.
Mégaphorbiaies [descripteur. Eventuellement notion ou concept, selon la classification opérée ou à opérer. Phytosociologie]
Concerne les communautés où sont présentes de grandes dicotylédones vivaces, le plus souvent maintenues secondairement (fauchage, pâturage). Mais parfois « naturelle », en bords de cours d’eau (ou au niveau de suintements), et alors potentiellement maintenue par des phénomènes de crues. Concerné pour beaucoup par la classe du Filipendulo-Convolvutea, ainsi que par celle du Mulgedio alpini-Aconitetea variegati. Plusieurs degrés de trophie.
Méso- :
Moyen, moyennement. Mésophile: intervalle de situation d’humidité moyenne des sols.
Messicole [botanique] :
Désigne les adventices des cultures moissonnées.
Micaschiste (Mica)[géologie. lithologie. pédologie]:
Le mica favorise un pH bas du sol.
Microgranite [géologie. lithologie. pédologie]
Granite à inclusion plus petites. Voir granite
Micropolis
J’appelle micropolis toutes les stratégies, et notamment les systèmes familiaux, tenant d’adaptablilité sociétale, face à une situation donnée. Elle ressort par un « on a toujours fait comme çà. On vit ainsi. C’est normal » qui témoigne de la moralité. Le grain familial reste soit au niveau de la famille soit au niveau de la localité (une majorité de familles dans la localité), soit sur une échelle plus large encore. De cette manière, on comprend que les familles de type communautaire trouvent ce type peut-être (cela reste une hypothèse) comme une solution permettant de se « serrer les coudes » face à l’adversité (l’adversité pouvant être un sol trop peu productif en comparaison du marché national ou international).
Aussi, le fait de signaler ici les système familiaux dont certains traits ont des incidences directes sur le travail agricole, et donc sur l’emprise de l’humain sur les phytocénoses, apparait comme un facteur explicatif mais restant à l’état d’hypothèse.
Mono- :
Mono : 1
Monocarpique [concept. Botanique]:
Les plantes monocarpiques ne fleurissent qu’une seule fois. Elles meurent suit à la seule fructification qu’elles produisent. La plupart du temps, il s’agit de thérophytes. Quelques arbres monocarpiques dans l’espace intertropical font exceptions.
Monocotylédone, ou extensivement monocot [Ancien groupe de la systématique en botanique, dite de l’évolution. Botanique pratique.]:
Grand groupe de plantes caractérisé par le fait que la graine n’est constituée que d’un seul cotylédon. La plantule donne d’abord lieu à une feuille unique. Le plus souvent, donne des feuilles à nervures parallèles.
Monoïque [concept. botanique]
Espèce présentant des individus portant des fleurs mâles et des fleurs femelles.
Morphe:
Forme.
Mucron, mucroné.e, mucronulé.e [descripteur. Botanique]
Pointe (très) courte et raide, terminant un organe. Mucronulé: pointe plus courte que mucroné.
Murs et murets [pratique humaine, dépassant les pratiques agricoles.]
Les murs et murets vont accueillir une faune et une flore particulières. Pour la flore, celles des parois, des fissures de murs et celles des dalles rocheuses.
Certains murs de soutènements sont en fait des talus, et sont alors couverts de la végétation ad-hoc: souvent des ourlets (si sous frondaisons). Ils peuvent également être totalement arborés.
Puisqu’ils accompagnent la pente en en modérant le modelé, ils ont aussi une incidence sur les végétations.
Ces murs sont le plus souvent en pierres sèches, et quelques-uns, rares, sont vitrifiés: on a fait fondre par le feu la silice contenu dans le granitoïde, et le verre retient alors les pierres.
Ces artefacts ont un caractère très particulier, et appartiennent semble t’il majoritairement à la France siliceuse. Ceux du nord Finistère, plus rares disait on, ont finit par disparaitre courant XX, parfois fragilisé ou simplement abattus. Mais il semble qu’il en restait pourtant bon nombres dans le Léon (j’en ai vu à Plougonvelin mais j’ai toujours pensé de cette commune qu’elle aimait être jolie et accueillante). Mais de manière moins affirmée sans doute. Ceux du sud finistère sont bien présents. Le Morbihan en contient aussi, je crois …
Le Limousin brille un peu par la densité impressionnante de ses murets. Et si on les prends dans un ensemble (je ne vois pas de raison qui puisse s’y opposer), cela forme un très important monument, dont je trouverais intéressant la cartographie. On finit par comprendre. C’est certain que faucher dans les rochers affleurants implique de marteler souvent sa lame, ou d’avancer vraiment lentement. Il semblerait donc que le but tout premier était l’épierrage des parcelles.
Ces murs et murets vont d’une trentaine de centimètres à 3 m de haut. Ils sont le long des routes et chemins, en limites de parcelles, mais aussi à l’intérieur et dessinent un paysage qui se trouve presque en terrasses, mais terrasses conservant une part du modelé collinéen. Les pentes sont adoucies. Le parcellaire affirmé. Le sol par ailleurs, riche en composantes sableuses et limoneuses, est sans doute mieux retenu: l’eau aussi puisque les pentes sont moins fortes.
En Limousin, dans cette partie du Limousin … L’habitat est dispersé, les murets soulignent le cadastre … Et il semble qu’historiquement, en rapport aux migrations saisonnières concernant une large partie de la population (hommes en âges de travailler), il y ait une sensibilité aux familles complexes (notamment zones rurales), à priori sans atteindre le niveau de système-à-maison (familles souches), cela jusqu’au XIX ème en tous cas (pour Ussel). On peut préférer, c’est mon cas, utiliser un cluster car les dates peuvent avoir une sorte de relativité (données insuffisantes et lacunaires aux extrémités de la période considérée, pour obtenir un tableau statistique fiable). Pour les familles non nucléaires (lesquelles sont instituées par le code civil depuis Napoléon), la fin du cluster peut être plutôt situé avec les effets dramatiques sur la démographie humaine de la première guerre mondiale, et le début plutôt situé vers la fin du Moyen-Âge selon G. Delille.
Un autre intérêt des murets, liés à la retenue des sols tient à l’éventuel effet sur l’amélioration pour l’agriculture de ceux-ci. Notamment si ils soutiennent de la végétation (sauf sclérophytes).
Les murets commencent à retenir le sol,
Il y a donc en premier lieu un effet d’épaississement physique du sol. Et la mise en place d’un horizon de colluvionement organo-minéral sur l’horizon organo-minéral précédent.
En second lieu, mais notamment, si le talus est surmonté d’une haie, les feuilles apportent de la matière organique. Cet effet est sans doute très important sur le sols siliceux. Par apport de matière organique (douce), il y a une modification de la pédogénèse.
En troisième lieu, donc une plus forte bioturbation à proximité des murets (dans le champ d’influence des murets: là où le sol reçoit un horizon de colluvionement. I.e: sur une grande aire).
Le type de murets à terrasses paysagères breton a donc un effet positif sur le sol. Amélioration des qualités du sol pour la culture.
En Creuse, les haies n’ont rien d’obligatoire sur les murets. Il peut sembler que ces murets sont restés longtemps nus. C’est parfois à leur pieds du côté intérieur, donc dans le sol épaissi que des haies peuvent avoir tendance à s’installer spontanément. Mais pas seulement à cet endroit.
Sur les dispositifs de terrasses à murets nus, il reste donc l’épaississement progressif du sol. Par colluvionement (et donc aussi pour une part de la matière organique se trouvant en amont). Et peut-être aussi du fait, de cet épaississement, un peu plus de bio-turbation??? (ce qui serait vraiment à vérifier)
Au vu des formations végétales contemporaines, les murets de la zone 0 en tous cas, située en Creuse (Haute-Marche; Par respect pour quelqu’un je ne géocalise pas) ont plusieurs effets:
- ils rendent plus difficile la perception des aléas topographiques naturels.
- bien que fait de monts et de cuvettes, ils favorisent généralement des sols d’humidités moyennes (végétations mésophiles sauf dans le tout fond de vallon où coure la rivière, le long des fossés, ou dans des dépressions naturelles plus affirmées)
Les prairies mésophiles présente l’aspect prairial sans doute le plus classique. Cela permet d’avoir une masse de matière végétale, et si elles ne sont pas trop riches en nutriments, le fourrage sera intéressant (elles peuvent perdre de l’intérêt parfois aussi cependant quand le sol s’appauvrit, sans que ce ne soit la règle générale). Le système surtout permet après la fauche, souvent assez tôt dans la saison, de profiter du regain automnal soit pour une pâture, soit pour une fauche. Traditionnellement, dans la Haute-Marche, le bétail est mis à paître surtout dans l’Agrostietea, près de la rivière. Les parcelles sus-jacentes dédiées à la fauche, et des cultures près des maisons ou encore juste au dessus des prairies de fauche. Les sommets des collines est désormais dédiées aux boisements, mais formaient des parcours pour les bêtes.
Actuellement, cependant que le prix du foin a augmenté, dans les deux communes de Haute-Marche que j’ai pu un peu voir, les ovins et bovins (petits troupeaux) paissent aussi bien dans l’Agrostietea (avec ou sans accès à de l’Arrheneteretea), ou dans l’Arrheneteretea.
Voir aussi: géomorphologie
N. Haut de page
Naturalisé [Concept. Botanique]:
Taxon d’origine exogène capable de se maintenir spontanément sur au moins 10 générations (ce nombre de générations pour les thérophytes).
Naturaliste (nature)[problème conceptuel]:
Ce terme est proscrit. 🙂
Un naturaliste est une personne qui s’intéresse aux choses de la nature. Comment définir la nature?
Alors que l’anthropologie culturelle de Descola questionne le concept de nature. Et que par ailleurs, cette notion n’est pas vraiment existante dans les dites sciences de la nature mais la traverse effectivement fortement, sous des angles bien définis. L’opposition unique remarquée par Descola dans l’histoire et de culture occidentale homme/nature ou nature/culture est épuisée par les connaissances que l’on peut en avoir dans le contexte des connaissances dites naturalistes. L’ornithologie notamment a pu faire émerger la connaissance de cultures chez des espèces d’oiseaux. Les anciennes notions d’inné et d’acquis apparaissent finalement comme les 2 faces d’une seule médaille, y compris le plus probablement chez Homo sapiens …
En outre, la présence de l’humain a profondément modifié ce qui adviendrait sans lui, y compris en forêt amazonienne (modification de nombreux sols, notamment par le feu). Cela implique qu’il n’existe pas ou très peu d’environnements n’ayant subi l’influence de l’homme, à un moment ou à un autre. Pour autant, les éléments structurants des environnements dits ou supposé naturels, des environnements primaires (environ 500 ans sans interventions humaines en ce qui concerne les forêts primaires*) sont soumis outre les éventuels effets continus de dégradations anthropiques passés (si traitement réguliers d’essarts par le feu), à des facteurs biotiques et à des facteurs abiotiques. Or l’implication, c’est de considérer la structuration d’un environnement y compris par d’autres vivants. Et ici, il y a un hic possible … Car cela est susceptible de s’opposer à un continuum des effets sur leurs environnements de différentes espèces au moins animales. Ainsi il se pourrait que la structuration hétérogène en terme d’espèces végétales très nombreuses à l’hectare propre aux forêts équatoriales soit en partie dues aux animaux. Mais dans ce cas la notion d’ingénieurs de l’écosystème convient.
Des questions soulevés par le domaine du vivant en pédologie, en zoologie mais aussi en anthropologie culturelle interroge un peu l’influence restant peut-être un peu cartésienne de l’appréhension des formations végétales primaires/secondaires notamment, cependant qu’il faut surtout correctement circonscrire les questions.
Surtout si l’observation ou l’étude a lieu sur une aire suffisamment large, plus grande qu’un biome ou dans un biome très hostile (Sahara ou région de l’Afar, Arctique posant cet « mais comment mangent-ils? »), ou encore dans un temps long (jusqu’à une époque où d’autres Homo existaient), alors Homo sapiens sapiens revient spontanément à l’esprit en tant que partie d’un tout. Et donc reprend alors ses droits d’hominés.
Pour aller un peu plus loin je me permets de conseiller « Par delà nature et culture » de Philippe Descola.
*La limite des 500 ans est arbitraire, et je crois qu’elle n’est plus utilisée. Elle implique de toutes les façons un paraclimax très évolué.
Néo indigène [concept. Botanique].
Catégorie d’indigénat. Plante provenant d’un territoire immédiatement voisin, où elle est indigène.
Néophyte [Concept temporel. Botanique].
Taxon exogène, apparu sur un territoire donné après 1500, suite à la régularité de grandes traversées (Amérique, Asie, etc.). Des sous-catégories possibles interrogent le XVII, le XIX … Concernant la seconde partie du XX ème siècle, on arrive là tout à fait sur un nouvel élan. Je ne me souviens pas de l’avoir vu décrit dans ce contexte disciplinaire (?) Se référer à Anthropocène, ou préférablement à changement global.
Voir également Archéophyte, et Indigène pour les aspects temporels.
Néotaxon [Concept. Botanique]:
Un néotaxon est un taxon formé sur un territoire donné et de manière spontanée d’un ou de deux taxons parents exogènes.
Nitrophile [écologie de la plante. Botanique]
Plante qui aime les situations où il y a beaucoup d’azote (N). Comment savoir si il s’agit de N, de P, de K ??? Ce terme longtemps utilisé, devrait être remplacé par eutrophe, hypertrophe … Voir trophie
Son utilisation a pu être justifiée selon la loi de Liebig qui indique que les plantes règlent leurs absorptions en nutriments sur celle de l’azote.
Nomenclature [discipline botanique et autres sciences du vivant]
La nomenclature édicte les règles qui permettent la bonne lisibilité de l’ensemble des parties d’une chaîne taxonomique, mais aussi des rapports entre ces parties.
Caryophyllales>Caryophyllaceae>Silene nutans subsp. nutans
Ainsi ci-dessus, la mention de sous-espèce implique dans les règles nomenclaturales l’existence d’au moins une autre sous-espèce. Plus encore, la mention d’une variété dans la fiche descriptive, implique pour cette sous-espèce qu’il s’agisse de Silene nutans subps. nutans (élidé:) var. nutans
Mais ces règles « grammaticales » sont parfois travaillées par l’œuvre de la taxonomie. Le rang attribué à une plante pouvant être révisé.
Notho- [concept. botanique]
Utilisé pour désigner les hybrides.
Nutrition [biologie]
La nutrition de la plante intéresse peu la démarche qui consiste à la situer dans son environnement. Contrairement à la reproduction de la plante, laquelle est comportementale.
La plante pour se nourrir extrait par les stomates du carbone aérien (CO2) et le transforme en cellulose et en amidon (sucres de réserves). La cellulose comme l’amidon sont des carbones. Pour cet exploit, elle a recours à des nutriments, des minéraux qu’elle trouve au sol. Parmi ceux-ci, le phosphore a une importance particulière. L’azote également. L’azote dans la plante va se transformer en protéines. Le phosphore et l’azote vont se transformer en nucléotides. Et en particulier en adénosine triphosphate (ATP), c’est à dire en énergie.
Au niveau des racines, la nutrition fait intervenir la rhizosphère: bactéries et mycètes.
Les racines vont par la suite redéposer au sol par rhizodéposition (le terme consacré) un certain nombre d’éléments. La rhizodéposition concerne la restitution de débris végétaux au sol par les racines, les cellules mortes de la coiffe. Mais concerne en outre toutes formes de carbone, des lysats, des exsudats (sucres, peptides, acides organiques …), des composés minéraux, tel l’azote et le phosphore.
La cellulose est le principal matériau qui constitue une plante. Ce que l’on appelle le bois, c’est de la cellulose enduite de lignine (la lignine étant une métabolite secondaire ayant comme avantage pour la plante de la rigidifier).
Des parasites, des maladies de nutritions, ou des brûlures chimiques (notamment à l’ozone de basse altitude) sont susceptibles d’altérer le processus de photosynthèse nécessaire au processus nutritionnel de la plante. Des parasites et des déprédateurs existent au niveau des racines (certains nématodes par exemple).
Nyctinastie:
Par extension, concerne des plantes dont les fleurs s’ouvrent la nuit (pollinisation par des papillons, des chiroptères, etc.)
O. Haut de page
Ob- [descripteur. Botanique]:
Marque l’inverse. Oblancéolé se dit d’une feuille de forme lancéolé mais qui est plus étroite du côté de la base que du côté de l’extrémité terminale. Idem avec obovale.
Oblong.ue [descripteur. Botanique]
Plus long que large, terminée de manière arrondie, et à bords presque parallèles.
Occasionnelle [Concept. Botanique]:
Taxon pouvant apparaître comme spontané mais ne l’étant pas. Présent et fleurissant sur le territoire donné, mais ne parvenant pas à former une population se maintenant durablement (10 ans pour les plantes dont l’expansion est majoritairement due à la reproduction sexuée).
Oligo:
Petit … utilisé comme: peu.
Oligotrophe [pédologie. botanique. phytosociologie] :
Sols comportant peu de minéraux servant à la trophie des plantes. Sols dit « pauvres ».
Olivine [géologie. lithologie. pédologie]
L’olivine est un cristal ultramafique (riche en magnésium, fer … et calcium), particulièrement présent dans la péridotite et le basalte. Roche favorable à l’altération en argile.
Ombelle [descripteur. Botanique. Typologie des inflorescences]:
Inflorescence (ou fleur composée), où tous les pédicelles partent du même point, et sont approximativement de même longueurs.
Onglet [descripteur. Botanique]:
L’onglet désigne la partie rétrécie et proximale d’un pétale (si partie rétrécie). Partie distincte par ce rétrécissement.
Orbiculaire [descripteur. Botanique]
Se dit d’un organe de forme arrondie.
Oreillettes [descripteur. Botanique].
Appendice d’une feuille au sens large prolongeant le limbe, ou se situant sur l’axe de maintien du limbe. Terme utilisé extensivement: peut désigner des parties du limbe, mais mentalement « détachables » de celui-ci dans sa globalité.
Oro-
Relatif au hautes altitudes.
Ourlet (ourlification) [Descripteur. Concept. Phytosociologie]:
Formations végétales herbacées et cicatrisant les espaces ouverts (mais parfois dans les prairies, les ourlets se développent en nappes et se répartissent donc petitement au sein de l’espace ouvert), et donc se situant dans la partie extérieure des lisières, de l’écotone. Bordant le manteau.
L’ourlification peut faire référence extensivement à « l’enfrichement » des prairies, mais désigne in fine la dynamique de successions vers la fruticée, ou vers la forêt. Il s’agit de l’avancée de la lisière herbacée, en général vers la prairie (ou encore sur les chemins). L’ourlet est le bord d’un boisement.
Alors que la friche correspond à des formations de reconquêtes sur des sols dénudés, et au sens large souvent sarclés donc, l’ourlet correspond à une avancée du boisement sur les espaces ouverts.
Voir les taxons suivants (comprenant également des pelouses): Lamio albi-Chenopodietalia boni-henrici (=Galio aparines-Alliarietalia petiolatae), Melampyro-Holcetea mollis sur sols plus acidophiles, et le Trifolio medii-Geranietea sanguinei (sur sols acidophiles à basiques).
Les ourlets phytosociologiquement décrits sont à comprendre comme l’avenir de l’espace ouvert si les conditions qui en maintiennent l’ouverture cessaient. Voir également Pratiques agricoles
Ovaire [Partie d’organe, pour description. Botanique]:
Partie inférieure du gynécée ; Partie qui s’exprimera le plus visiblement comme le fruit.
Ovale [descripteur. Botanique]
se dit d’une feuille dont le limbe est ovale et plus large du côté de la base, assez large. Plus large que lancéolé. Ovale de ovum (soit œuf) pour donner une idée de la largeur.
P. Haut de page
Paillette [descripteur. Botanique]
Petite écaille translucide mêlées aux fleurs tubulées des astéracées
Paléole [descripteur. Botanique]:
Voir Fleur (structure, Poaceae). Sorte de tépale. Parfois assimilé à des pétales.
Paléotonlogie [une discipline]
Discipline s’occupant de ce qui fût vivant. Du vivant disparu (en principe). Elle est le pendant de l’archéologie, laquelle s’occupe des traces restant des artefacts humains.
Ainsi une paléophyte est une plante ayant vécu mais disparu. A distinguer donc des archéophytes.
La paléo-botanique s’occupe donc des fossiles de plantes. Prioritairement. Elle est d’un secours pour la systématique.
La paléo-écologie s’occupe de l’écologie disparue. Pour cette discipline, la phytosociologie est susceptible d’être utilisée. La phytosociologie utilise une méthode floristique, qui permet donc le travail sur les traces des plantes en présence. Le code EUNIS ne me semble pas utilisable car descriptif d’un paysage qui par définition pour cette discipline n’est plus là. Cette discipline fin XX, et sans doute plus encore en ce début de siècle tend à s’orienter de plus en plus vers des aspects ethno-anthropologiques. C’est évidemment l’humain qui fascine. En France contrairement aux écoles américaines (je pense notamment à Glenn Shepard), les disciplines tendent à rester bien séparées, il n’y a pas ou peu de cursus dans l’interdisciplinarité, et cette pratique semble souvent renvoyée au cursus de géographie. Je regrette un peu cette absence apparente au MNHN. Noter qu’en 1987, l’écologue Bernard Clément passe une thèse d’écologie, largement orientée archéologie (et donc visant Homo sapiens).
Palmé.e [descripteur. Botanique]
Dans une feuille plamée, toutes les nervures divergent à partir du sommet du pétiole, y compris les proximales.
Palmatilobée: les échancrures des lobes atteignent moins de 50% de la longeur de la nervure du lobe concerné (jusqu’au rachis): peu échancré.
Palmatiséquée: les échancrures des lobes atteignent plus de 50% de la longueur de la nervure du lobe concerné (jusqu’au rachis): très échancré.
Digitée, Palmatipartite: l’échancrure atteint le rachis de la feuille, sa nervure principale.
Panicule [descripteur. Botanique. Typologie des inflorescences]:
Grappe dont les fleurons sont au moins 2 x pédicellés.
Pappus [descripteur. Botanique. Partie d’organe]
L’aigrette est un faisceau de soie qui surmonte certaines akènes (ou achènes), leur permettant la dispersion par le vent en vols façon parapente.
Pauci- :
Pauci veut dire peu.
Paraclimax [Concept. Phytosociologie]
Stade donné comme terminal d’une succession végétale: souvent forestier. Le terme est préféré à celui de climax pour souligner qu’il y a involution et évolution, même au dernier stade de successions.
Parasitisme [concept. écologie]:
Relation asymétrique entre deux ou plus organismes vivants dont l’un vit au dépens d’un ou des autres. Homo sapiens sapiens connaît cela avec les infections (bactéries ou champignons), les virus … Cela ne détermine pas nécessairement une maladie. Une espèce végétale peut se trouver hôte d’une autre espèce végétale, parasite, et qui à elle seule n’a pas la capacité de se nourrir. Le parasite vit entièrement au dépens de la plante hôte. Celles de ces plantes parasites qui parviennent toutefois à faire de la photosynthèse sont dite hémiparasites. L’hémiparasite vit partiellement au dépens de la plante hôte.
Patrimoine [notion vague, ici. ]
Espèce ou espace patrimonial.e: il s’agit d’une notion subjective. Elle diffère du patrimoine culturel. Le tabac, les 2 espèces connues des européens notamment pourrait être proposées, si ce n’est le cas au patrimoine culturel de l’humanité en raison de son rôle dans les cultures des sociétés amazoniennes. Ces espèces à caractère ethno-anthropologique très marquées prennent le nom d’espèces emblématiques.
Cette valeur alors donnée comme symbolique, peut toutefois parfois intervenir dans les critères d’attribution de cette notion. Ainsi que l’intérêt scientifique.
La rareté au sens large va définir une espèce ou un espace patrimonial-e. Elles sont extraites des listes rouges, elles sont en danger ou vulnérables. Elles sont protégées ou réglementées.
Si non protégées ou non réglementées, elles sont en limites d’aires où la population est exceptionnelle (endémisme, effectifs remarquables).
L’intérêt de cette notion est d’insister sur la fragilité de certaines espèces ou espaces. Cela étant dit qu’évidemment elle attribue émotionnellement une valeur plus importante aux espèces et habitats en situations de précarités.
Pédalée [descripteur. Botanique].
Une feuille pédalée présente 3 nervures principales avec les deux nervures proximales ramifiées.
Pédicelle [descripteur. Botanique] :
Dans des inflorescences, des fleurs complexes. Des tiges partent du pédoncule. Le pédoncule soutient ces tiges, et ces tiges soutiennent les périanthes. Ces tiges sont, si l’on veut, de « petits pédoncules », des pédoncules secondaires : des pédicelles.
Pédo:
Relatif au sol.
Pédoncule [descripteur. Botanique]:
Le pédoncule est la tige qui soutient le périanthe.
Pelouse [Descripteur. Concept. Phytosociologie. Phytogéographie]
Formation naturelle végétale herbacée, souvent de faible hauteur (40 cm max, en principe). Montrant le sol. Le sol est à nu par endroit. La biomasse est faible.
Extensivement, ce qui tient du gazon dans les jardins. Ce gazon est en fait une prairie maintenue basse par une fauche très régulière, composée principalement de Lolium perenne, de Poa pratensis, de Festuca rubra, de Lolium arundinaceum.
Peltée [descripteur. Botanique]
Se dit d’une feuille orbiculaire mais dont le pétiole est attaché au milieu du limbe
Pennée [descripteur. Botanique]
Comme les pennes d’une plume. Un limbe penné présente des segments, des lobes des folioles l’un en face de l’autre de chaque côté du rachis (au moins 3).
Imparipennée: la feuille est terminée par une foliole à son extrémité extérieure.
paripennée: sans cette foliole.

Pennatilobée: les échancrures des lobes atteignent moins de 50% de la longueur de la nervure du lobe concerné (jusqu’au rachis): peu échancré.
Pennatiséquée: les échancrures des lobes atteignent plus de 50% de la longueur de la nervure du lobe concerné (jusqu’au rachis): très échancré.
pennatipartite: l’échancrure atteint le rachis de la feuille, sa nervure principale.
Périanthe [descripteur. Botanique]:
Le périanthe constitue grosso modo ce qu’on appelle communément la fleur. Il est constitué de pièces de protections tel que sépales et pétales.
Péridotite [géologie, lithologie. pédologie]
Roche grenue contenant beaucoup d’olivine. La péridotite est ultramafique (contenant beaucoup de magnésium et de fer), de pH basique.
Pétale [descripteur. Botanique]:
Les pétales sont le plus probablement des feuilles transformées. Les pétales sont plus tendres que les sépales. Ils constituent notamment des pièces de protections (avec les sépales) de la fleur proprement dite (étamines et pistils) et peuvent protéger complètement ou incomplètement cette fleur selon la position de l’ovaire (infère ou supère).
Pétiole [descripteur. Botanique]:
Tige d’une feuille.
Petiolule [descripteur. Botanique]:
Tige ou presque une tige mais secondaire, en tous cas petite, et portant le limbe dans une feuille composée.
pH :
voir potentiel Hydrogène.
Phénologie [concepts: science du vivant]
Phéno: apparence. La phénologie s’intéresse aux différents stades de développement d’une plante. Stade semis, stade plantule, etc.
Les différents stades sont provoqués par l’accumulation de chaleur par la plante. Chaque espèce a des besoins différents et montre une phénologie différente. De sorte qu’il y a des groupes d’espèces à floraisons hivernale, printanière, estivale, tardi-estivale.
Les tous premiers stades concernant la germination peuvent en tous cas nécessiter froid et/ou ombre.
Les dates de floraison étaient assez précises et indicatives, si l’on se réfère à la flore de Coste, par exemple. Elles le sont restées longtemps. L’amplitude de précision était de l’ordre de 15 jours environ, et sachant qu’il y a un décalage d’environ un mois parfois entre le nord et le sud de l’hexagone. Actuellement, et plus encore dans les hyper-agglomérations, le gradient de chaleur général a changé. Il s’en suit que les floraisons peuvent être décalées mais pas toujours plus tôt. Et pas tous les ans pareils, bien évidemment (c’était déjà le cas avant pour ce point). On peut alors choisir ou non d’indiquer les dates de floraisons, lesquelles ont tendance à devenir de plus en plus théoriques, mais si positivement, il faut comprendre que c’est une indication un peu fragile.
Phorbe
Comme cela ne l’indique pas forcément. Phorbe concerne, non pas les plantes spécialement pâturées, mais les plantes dicotylédones.
Phytocénologie [une discipline]
Synonyme de phytosociologie.
Phytocénose [Concept fondamental. Phytosociologie]:
Formation végétales, communautés végétales suffisamment matures et constituées, fonctionnelles, et autonomes. Et cependant dépendantes de facteurs biogéoclimatiques à plus grande échelle (atmosphère, hydrosphère, lithosphère, pédosphère impliquant une interrelation de toutes les parties).
En sont en principe plus ou moins exclues les communautés basales. Parmi les plus courantes dans les espaces urbains.
Les phytocénoses sont susceptibles de rassembler plusieurs synusies. Des périodes de relevés sont indiquées.
Phytosociologie [une discipline]:
Etude des communautés de plantes (ou végétations). Les plantes montrant des besoins spécifiques, se rassemblent en fonction de facteurs écologiques notamment en lien avec le sol, le climat. Ainsi une formation de Savane, une formation forestière, une prairie, un champs cultivé (retourné), une prairie grasse, une prairie pauvre, etc.
Des ingénieurs écologues s’interrogent parfois sur la pertinence de cette discipline vis à vis de la typologie Eunis bien cohérente et extrêmement pratique. La phytosociologie semble plus chronophage. L’effectuation des relevés, etc. Cependant, de manière plus générale, il faut prendre en compte que la phytosociologie s’articule avec la botanique du côté de l’écologie de la plante (son auto-écologie). Elle est également utilisée en paléo-écologie … Il me vient au fond juste l’idée que si il y avait un besoin interdisciplinaire, il y a alors ce petit côté pratique où toutes les données peuvent se mettre bien en place. Au fond, c’est une question de perspective de travail.
Elle me semble cependant beaucoup plus précise. Je pense notamment à un cas devenu plutôt courant. L’abandon de culture. Une prairie ou une culture sarclée éventuellement. Mais essentiellement le prairial. En abandon de culture. Jusqu’à quand on est sur du prairial, et à partir de quand on est sur de la « friche »au sens large autrement dit pour le prairial de l’ourlet ? La proposition de Catteau et al dans le guide de détermination des végétations du nord de la France semble claire: moins de 50% de recouvrement ou plus de 50% par des plantes d’ourlets dans le prairial. Sachant donc que tout cela peut-être très « discret », pas toujours complètement perceptible de manière spontanée.
Les communautés de plantes étudiées témoignent des conditions anthropiques et abiotiques (climat, sols) où elles se trouvent.
Elle est donc censée se présenter comme comprenant ou avoir des référence à la phyto-écologie (ce qui ressort de la pédologie, et de la géologie), et les éventuels caractères indicateurs. Elle présente historiquement deux méthodes, la sigmatiste ou braun-blanquetienne, et la synusiale. La première est une méthode mis au point Josias Braun-Blanquet et correspond au terrain. La seconde mise au point par Bruno de Foucault, François Gillet et Philippe Julve est beaucoup plus analytique. Les référentiels qui servent sur le terrain indiquent par principe les données de la phytosociologie synusiale. Cette dernière travaille sur les rapports logiques concernant les données géographiques, temporels, ou d’évènements et de traitements entre les différentes synusies. C’est ainsi que dans un référentiel concernant par exemple une prairie, il est aussi fait référence aux groupements végétaux qui la borde et qui représente l’avenir des groupements végétaux de la prairie si toutefois le traitement que l’humain procure au locus devait s’arrêter. Par ailleurs des référentiels font état de la physionomie du groupement végétal décrit. Cette physionomie est fort pratique, et c’est sur cette logique qu’est aussi construit le code Eunis.
Finalement, l’objet donc de cette discipline subit deux influences signalées comme permanentes et obligatoires. Ce sont donc les seules, dans le champs de cette discipline, à devoir être mentionnée avec un haut degré de priorité: la géologie ( ou lithologie+ remarques éventuelles sur la pédologie ou idem et chimie et mouvement concernant les plantes flottantes dans le domaine aquatique) et le climat (atmosphère et hydrosphère, etc.). Les espaces rudéraux et sarclés donnent lieux à des communautés de plantes liées à des espaces secondaires anthropisés mais tout particulièrement distincts des autres communautés par leurs floristiques.
Si un groupe de ligneux (boisement) identifiable au travers d’une phytocénose ad hoc ne correspond pas complètement à l’écologie perceptible du lieu: la phytocénose est néanmoins juste. C’est ce qui intéresse. Cela n’empêche dans un second temps, mais de manière séparée donc, de chercher et de trouver l’autre influence, très probablement d’origine humaine, et très probablement: un aménagement.
Dans le cas d’incidence de gros ingénieurs de l’écosystème, ou plus précisément des autres bâtisseurs que l’humain (je reste un peu bloqué sur le castor), c’est d’une part considéré comme rare. C’est aussi actuellement renvoyé aux ingénieurs de l’écosystème.
Les critères de raisonnements pour les groupes de plantes sont en premier lieu la floristique, et en second lieu l’aspect fonctionnel (rudéral est un aspect fonctionnel). la phytosociologie est hiérarchisé dans ce sens.
Les successions des communautés primaires (« naturelles ») ou secondaires (« anthropiques ») sont étudiées. Les communautés et successions secondaires sont signalées comme telles.
Pistil [Organe. Pour description botanique]:
Le pistil est composé du stigmate (porte d’entrée du pollen), du tube stigmatique ou style, et de l’ovaire qui comprends les ovules. Si l’ovaire n’est pas protégé par le calice, si celui est au-dessus, la fleur est donc à ovaire infère. Si le calice recouvre l’ovaire, la fleur est supère ou à ovaire supère.
Plagioclases [géologie, lithologie, pédologie]
Les plagioclases forment une série minérale allant continument de l’acide au basique. Fait partie (avec l’olivine) des roches favorables à l’altération en argile. Les feldspaths sont des plagioclases.
Ploïdie [génétique senso lato]:
Jeux complets de chromosomes dans une cellule d’un organisme donné. Le chromosome correspond à une molécule d’ADN, laquelle porte de l’information génétique (ainsi que des protéines). Les chromosomes et les allèles sont en double dans un organisme. Ici, il s’agit d’identifier et compter les allèles. Les allèles sont les versions possibles d’un même gène, mais différant par leurs séquences.
Les espèces végétales peuvent être polyploïdes, cela à la différence de la plupart des espèces animales. Si une espèce animale se trouve être polyploïde, elle meure le plus souvent ou parfois donne lieu à une sorte de « chimère ». Les espèces végétales polyploïdes sont susceptibles d’être plus vigoureuses, et possèdent en tous cas une capacité à traverser les barrières écologiques.
Pour le règne végétal uniquement, l’allopolyploïdie, c’est à dire l’acquisition de la polyploïdie suite à un flux de gènes d’un autre taxon (hybridation, donc) possède un potentiel spéciant. En effet, un polyploïde ne peut se reproduire avec un diploïde.
Podzolisation [pédologie]
La podzolisation a lieu sous l’incidence du froid et de la pluie et concerne des types de sols d’assez hautes latitudes. Des effets de podzolisation peuvent toutefois être parfois plus ou moins engagés, de par différents facteurs, sous nos latitudes.
Des sols acides et peu pourvu en argiles soumis à de la matière organique acide (Pinus sylvestris, ericaceae) chélate l’argile qui glisse dans des horizons plus profond que la surface du sol (horizon O-A). Le sol n’est presque plus fertile.
Dans un podzol, l’horizon O-A, l’horizon de surface présent un humus de type mor (très sombre, très acide, à dégradation très lente, avec une litière épaisse). La matière organique a glissé (par éluviation) dans l’horizon B.
Un horizon d’elluviation E (lessivage vertical) s’est inséré entre l’horizon A et l’horizon B. L’horizon d’éluviation est de teinte cendré, dépourvue de cette matière organique, dépourvue surtout de minéraux et d’argiles.
L’horizon B est brun rougâtre, noir a reçu de la matière organique (acide fulvique), et des oxydes de fer, et d’aluminium, notamment dans la partie supérieure de cette horizon. Lequel est parfois cimenté dans sa partie inférieure (juste au dessus de l’horizon C)
Poils [descripteur. Botanique]:
Pour les plantes, ce terme est utilisé de manière extensive ou un peu abusive. Il ne s’agit pas d’un organite mais d’une extension de l’épiderme. Les poils peuvent être fourchus, simples en navette, courts, longs, dressés ou hirsutes, souples, rares ou tapissant, etc.
Pollen [botanique]:
Se présente comme de petits grains évoquant une poussière. Ce sont de petits sacs produisant et contenant les gamètes mâles.
Polymorphisme [botanique]:
Concerne le fait qu’il y ait une divers!té de forme d’un organe, cela au sein d’un taxon. Cela ne présente pas de rapport avec le polyphénisme. Le polyphénisme n’existe pas dans le monde végétal. Le polymorphisme met en jeu des variations génétiques au sein d’une population ou d’un taxon. Pour le polyphénisme, il s’agit de l’expression d’une variation phénotypique, au sein d’un même génotype. Typiquement, un individu peut prendre plusieurs aspects. Changement de couleur … Selon des évènements apparaissant dans l’environnement. Le lemming ou la Belette qui deviennent blancs quand il y a de la neige. Pour un taxon végétal, le polymorphisme indique la variation morphologique au sein de ce taxon de certains organes. Comme les feuilles, par exemples …
Potentiel Hydrogène [essentiel! ] :
Le potentiel Hydrogène est une mesure d’acidité ou de basicité. De 1 à 14. 7 étant neutre. 1 hyper acide, 14 hyper basique. Pour s’en faire une image: au niveau et en deçà du pH du piment (4,3 à 5,2), l’équilibre trophique d’un sol peut prendre un caractère plus stochastique (en deçà de 4,5 de mémoire). Au niveau du pH du citron (environ 3 pour le pH du citron; en deçà de 3 pour la possibilité des plantes à vivre) : la végétation est nulle.
Noter que pour l’eau comme pour l’usage courant des sols (agricole par exemple), le neutre est posé intuitivement à 7. Mais il semble que pédologiquement le neutre soit à 5, 47 et des poussières, soit 5, 5.
Dans les sols neutres et neutro-calcicoles, la chélation organo-minérale se fait avec le calcaire noté Ca, dans les sols acides (dont le pH est inférieur à 5) les liaisons organo-minérales se font avec l’hydrogène acidifiant en premier lieu mais également par la suite avec l’aluminium (Al), et avec le fer (Fe). Or l’aluminium et le fer sont plus instables, alors que les liaisons avec les éléments calcaires sont très fortes. Ils sont en particulier à certaines doses phytotoxiques.
Le pH est plus élevé l’hiver que l’été. La variation saisonnière sous nos climats est d’environ 1/2 point.
Les sols acides présentent une richesse microbienne moindre, une capacité d’échange cationique potentiellement moindre.
Le potentiel Hydrogène à quelques égards peut être considéré comme le chef d’orchestre des processus pédologiques.
Voir également: pouvoir tampon
Prairie [Descripteur. Concept. Phytosociologie]
Formation herbacée normalement dense et fermée (on ne voit plutôt pas le sol), présentant donc en principe une important biomasse, dominée par des poaceae et notamment des graminoïdes, mais aussi composées d’espèces à fleurs plus grandes. La hauteur est d’au moins 40 cm. Se distingue ainsi des pelouses que la prairie domine (présence de plantes de pelousaire en sous strate). A distinguer aussi des steppes (dont certaines semblent trompeuses).
Prairies de fauches et prairies de pacages, voir aussi Pratiques agricoles
Primaire [Concept. Phytosociologie]:
Primaire s’oppose à secondaire. Une formation primaire est une formation dont l’origine est spontanée. Pour être un peu exigeant: pour laquelle l’influence de l’humain est nulle, non significative ou pas détectable (pas détectable dans le champ de la phytosociologie).
Une forêt primaire est une forêt jugée analogue à celle qu’elle aurait été si elle n’avait jamais subi l’influence de l’humain (ou n’ayant jamais subie cette incidence). Une forêt de 150 ans sans incidence humaine est une forêt déjà ancienne. Une forêt primaire est parfois considérée telle à partir de 500 ans.
De la même manière une succession primaire est une succession d’un groupement de plantes vers un autres groupement de plantes sans intervention humaine.
Quelque soit leurs incidences sur la gestion ou modification du milieu, on range ici en primaire, les ingénieurs de l’écosystème. Cependant cette terminologie a tendance à engager Homo sapiens, lequel en Ecologie semble déclassé ou plus ou moins mal classé (sans rapport avec sa phylogénie). Il faut donc détailler pour mieux expliquer.
Une plantation de peuplier constitue une culture et a pour effet d’assécher le sol (et a pour objet son effet ou la production de pâte à papier). Il s’agit d’une forêt secondaire. Dans la proximité immédiate, des communautés de plantes bien constituées sont trouvées. Elles sont notées comme telles. Sans les peupliers, les populations de plantes trouvées auraient été des plantes de sols plus humides. Selon mon goût, il n’est pas inutile de signaler par ailleurs la présence de cette plantation.
Les prairies de fauches permanentes sont parfois qualifiées de milieux semi-naturels. En effet, l’idée de l’agriculteur est de laisser pousser de l’herbe pour avoir du foin. Et il a déjà semé quelques espèces intéressantes. Hors ces espèces, on va trouver d’autres espèces qui viennent s’y installer, et dans la synusie de sous strate, des plantes de pelousaires, ainsi que par ailleurs des plantes de l’ourlet. J’indique ici seulement de mémoire qu’il me semble qu’en ce qui concerne le parcours technique, il semble recommandé de retourner et refaire un semis tous les 10 ans environ. Reste à partir de là de voir l’écart entre les pratiques et les conseils. Tout cela ne fait pas beaucoup de différence. Pour obtenir une prairie, il faut supprimer les ligneux et l’entretenir par la fauche (ou par l’abroutissement). Les prairies semi-naturelles sont des milieux secondaires.
Un aménagement est produit par un castor (je l’analyse comme artificiel). Le barrage qu’il a produit modifie la vitesse de l’eau. Les populations de poissons ou de plantes tendent à être remplacées par des populations d’eaux calmes. Ces populations sont notées comme telles. Il ne me semble pas du tout inutile d’indiquer l’ouvrage du castor. D’autant que l’on ne sait pas quand il sera sommé de partir.
Dans le raisonnement qui suit, il s’agit pour moi d’observer quelque chose. Je produis un léger déplacement (rattachement stricto sensu de H. sapiens à sa phylogénie). Les concepts de primaire et de secondaire sont de type fonctionnels. Cependant il peut arriver que le raisonnement floristique laisse plus de place qu’attendu au raisonnement fonctionnel dans la définition ou le rattachement d’une phytocénose (çà a été le cas de l’Epilobietea angustifolii). Enfin la phytosociologie présente un intérêt vis à vis des activités humaines comme l’agronomie, par exemple. Le fait d’indiquer qu’un milieu est secondaire car c’est presque toujours l’humain qui modifie à ce point, permet d’établir à partir d’un milieu primaire jouxtant des données concernant aussi ce milieu secondaire, et être indicatif par comparaison.
Le fait que j’analyse l’ouvrage d’un castor comme un aménagement artificiel, indique que je pense qu’il s’agit d’un locus secondaire. Je le pense parce que l’aspect fonctionnel (aménagement, barrage) a plus d’importance que son origine ou son auteur. Egalement parce que je rattache Homo sapiens à sa phylogénie d’une part, et d’autre part parce qu’il s’agit d’un aménagement ayant des effets significatifs. Rien n’oblige à indiquer que les populations étudiées sont en milieux primaire ou secondaire … Sauf si par exemple la floristique était typifiée, car cela engagerait nécessairement des questions. Ce n’est pas le cas. En phytosociologie, la floristique est prioritaire sur la fonctionnalité. Ce qu’ on observe c’est la communauté de plantes ou la communauté animale (poissons ici). Néanmoins « primaire » et « secondaire » sont des définitions qui quant à elles sont à caractères fonctionnels, et non à caractères floristiques.
La phytocénose répond à ce que l’on trouve habituellement dans des milieux primaires, elle est donc supputée de type primaire, même si elle est située dans un locus manipulé. Elle est en fait secondaire. L’aspect primaire dissimule potentiellement l’aspect secondaire du locus. Par contre, si des caractéristiques floristiques avaient émergées de cette situation, il aurait fallu décider si il s’agit d’un milieu (la phytocénose) primaire ou secondaire. Ce que je cherche à indiquer, c’est que d’une certaine manière la manipulation du milieu ne détermine pas une communauté de plantes spécifiques. On peut en déduire que la manipulation par le castor n’a peut-être pas une incidence significative. D’un autre côté on sait que l’incidence est importante. Il s’agit d’un changement de milieu (plantes d’eaux calmes contre rhéophiles). C’est quand même intéressant de le préciser. On aura compris que je rattache Homo sapiens à sa phylogénie … Ce qui dans un tel cas, ouvre pour la définition de secondaire sur une insistance sur la manipulation du milieu, en indiquant : notamment par l’humain … A l’instar de la définition de rudéral
Pratiques agricoles (3 grands traitements) [typologie agricole]:
- La fauche a lieu le plus souvent 2 fois par an mais peut voir à l’automne au lieu d’une fauche le pacage d’animaux. Les prairies fauchées sont sensibles à l’ourlification. Cela se passe rapidement. Les toutes premières phases dynamiques vers le climax sont susceptibles d’être très vite un peu présente.
- L’abroutissement est à comprendre comme une fauche extrêmement régulière à laquelle s’adjoint selon l’unité de bétail par hectare, un piétinement plus ou moins prononcé ( également fonction de l’intensivité ou de l’extensivité de la pratique). Dans les milieux clos, une part de ce qui est exporté par abroutissement est rendu par les fèces, là où a eu lieu l’exportation. La régularité de la fauche par abroutissement maintient fortement le milieu. Par ailleurs, le piétinement donne une « couleur » à ce milieu.
- Le labour a des effets très particuliers. Le premier effet du labour est le désherbage des hémicryptophytes et bien moindrement des géophytes. Le labour a ceci de particulier qu’il rudéralise. Transforme totalement le milieu. Le second effet est suite à la puissance du désherbage et à l’exportation très importante des cultures et de leurs restes, l’affaiblissement à un niveau plus bas que les autres pratiques agricoles de la fertilité naturelle (voir: C/N; CEC), et l’implication d’amendement. La texture et la structure du sol produites par le labour provoquent cependant de nombreux avantages, y compris vis à vis de la fertilité (minéralisation plus rapide en lien avec le pédoclimat plus chaud car les pores étant plus gros, la quantité d’air, lequel se réchauffe et se refroidit vite, est plus importante, et notamment: rétention d’eau a effet thermostatique). Lorsque le soc retourne la terre. C’est à dire le labour tel qu’on le connait aujourd’hui: d’une part il aère certaines parties. D’autre part, si le labour est profond, il mélange les couches de sols. Ce qui a pour conséquence d’envoyer une partie des micro-organismes de milieux oxygénés dans une zone plus anoxique. Cela limitant plus ou moins fortement la dégradation de la matière organique vers l’humification, et sa transformation en azote. Il tend à rompre pour partie et à terme le cycle carbone ->azote. Mais le labour en général est aussi l’occasion d’amender, d’enrichir le sol. Les toutes premières phases dynamiques vers le climax, lors d’un abandon du culture, s’en ressentent. Et donne lieu à une flore particulière: le Stellarietea mediae (voir Ordre 68.01 et 68.02). Sont compris ici par labour (sauf précision de labour profond) tout types de labour, y compris labour superficiel (ou pseudo-labour).
Précisions terminologiques
Actuellement, on considère le pseudo labour comme intégrant les pratiques de non labour. Je trouve çà contestable.
Ici, est entendu
Non labour: agriculture naturelle (Masanobu Fukuoka), agriculture de conservation. Voir aussi agriculture naturelle/agriculture de conservation
Labour: labour superficiel ou pseudo labour (tracer un sillon), labour classique (avec mélange de la terre mais n’atteignant pas la couche anoxique du sol), labour profond (40 cm, 50 cm: mélange de la terre impliquant la couche anoxique du sol)
Autre sarclages pour aires de petites dimensions: serfouette, houe, fourche-bêche, bêche: ces sols sont très riches tant en matière organique qu’en azote.
Sous solage: utilisation d’une charrue permettant le décompactage des couches profonde du sol.
Top soil inversion. Cette technique est à mettre en lien avec le labour profond. Au lieu de mélanger la couche aérobie et la couche anaérobie, les deux couches sont inversées. De sorte que les bactéries aérobies en grandes difficultés. Cette technique a pour but de défertiliser un sol. Elle comporte des risques: en présence de trop d’eau, la matière organique renvoyée trop profondément en milieu anoxique va mal se dégrader (dégradation de type tourbe et dans un pire des cas une dégradation analogue à une méthanisation si noyage). Aussi le désherbage doit nécessairement précéder.
Voir également Feu, et Agriculture naturelle/agriculture de conservation pour d’autres pratiques agricoles, mais plus particulières.
Autres renvois concernant les parcelles cultivés: Agriculture, Archéophytes, Cycle de l’eau, Cycle du phosphore, Cycle de l’azote, CAH, Nitrophile, Carbone-azote, CEC, Potentiel Hydrogène, Trophie, Sidérophore, Humus, Rhizosphère, Limon, Argile, Sable, Ingénieurs de l’écosystème, Calcaire, Géologie, Climat
Preuve (?)
La preuve est presque un gros mot, en tant qu’elle est évolutive. Ce qui cependant indique justement sa pertinence. On ne peut pourtant non plus situer la science seulement dans son évolutivité, car il y a des acquis : une pomme n’a qu’une unique manière de chuter depuis Newton.
Pour administrer une « preuve », idéalement, il faut pouvoir procéder à la conduite rigoureuse d’une expérimentation.
L’expérimentation n’est pas toujours possible.
Lorsque l’on ne peut expérimenter, il reste l’observation :
Dans un premier temps, il faut beaucoup distinguer les sources secondaires des sources primaires.
Les sources secondaires doivent absolument être notifiées car très incertaines. Les sources secondaires n’ont pas vocations à l’établissement d’une preuve. Elles sont simplement informationnelles.
Cependant certaines publications possèdent une valeur scientifique majeure : les actes de congrès et de colloques, etc. les publications de pairs, et notamment les revues systématiques de littératures.
Il faut donc considérer la source primaire.
Lorsque l’on déclare la présence d’une plante il est ainsi demandé si on l’a vu de visu. Cela permet de savoir si la source est bien primaire. Ces données, si elles sont communiquées par des personnes non agrées (ne faisant pas partie d’une institution ou des associations agrées) sont contrôlées par du personnel qualifié.
En ce qui concerne l’identification sur le terrain, on ne peut obtenir qu’un faible niveau de preuve. On ne peut obtenir au mieux que des séries d’observations s’appuyant éventuellement sur des croisements de données. Mais c’est bien de là où l’on part.
Des programmes d’observations particuliers peuvent par contre être menés.
En partant du terrain, il faut considérer que :
Les espèces ou les unités de phytocénoses sont distinguées comparativement et proprement. Une espèce est dotée de caractéristiques propres que ne possèdent pas une autre espèce. Idem des phytocénoses. Pour en savoir plus voir à relevé phytosociologique
Il s’en suit que l’ensemble des caractéristiques, sauf éventuellement critères de distinctions très secondaires, sont attendus pour une bonne identification.
Typiquement l’espèce rencontrée doit correspondre à sa définition. Sa définition est représentée dans un herbier. L’individu d’herbier est considéré comme représentatif de son espèce. Chaque individu d’herbier est l’exacte réplique du nom de l’espèce. L’herbier doit donc être en quelque sorte agréé par des personnes ou une institution faisant suffisamment autorité en la matière. La bonne conservation de ces herbiers est vraiment importante.
On ne se promène pas avec de tels herbiers dans la nature. Une autre représentation de l’herbier si l’on veut sont les flores et les guides. Les guides sont assez peu riches en nombre d’espèces décrites. Certaines flores font autorités. C’est la cas de la Flore bleue pour la Belgique ou de Flora Gallica pour l’Hexagone et Corse. L’indice pour savoir si la flore fait autorité ou non n’est certainement pas de vérifier si elle fait référence à des herbiers car elle peut être construite différemment. C’est curieusement déjà de se rapporter aux auteurs indiqués. Les auteurs indiqués sont susceptibles d’indiquer des sous-champs interprétatifs. C’est la cas des flores régionales de Jauzein, lesquelles font autorités, dans la mesure où il met en exergue la cytologie (ici, identification et comptage des allèles -allèles ou copies des gènes).
Il y a un supplément dans les flores vis à vis des herbiers : elles font états de l’évolution des questions sur les espèces considérées à dates de leurs publications (et notamment des données cytologiques, et génétiques). De manière succincte cependant.
Sur le terrain, on détermine uniquement par la morphologie.
Concrètement, l’identification est terminée chez soi, ou au bureau … Un référentiel faisant autorité au moins en main. Une flore la plupart du temps. Le référentiel sert d’aide à la détermination. Les descripteurs dans le référentiel doivent correspondre à une définition à la fois concise et précise pour éviter l’interprétation.
Idéalement, la fiche de déclaration d’espèce demande : le climat, des renseignements sur le sol (indiqué géologie), et son humidité. L’habitat ou la phytocénose. L’endroit, les coordonnées GPS. Le nombre ou la quotité. Et la date bien sûr. La date d’observation.
Elle est déclarée. C’est l’établissement de la source primaire. Cela peut permettre les statistiques. On commence donc à avancer à partir de là.
On peut remarquer que dans la déclaration d’une plante identifiée (en source primaire), les facteurs sont indiqués : quel sol, quelle ombrothermie (ou caractéristiques écologiques générales), où, à quel date, quel climat ????
En ce qui concerne les phytocénoses (les communautés de plantes), un certain nombres de points sont indiqués comme à signaler. Beaucoup du même ordre que pour l’espèce (les données écologiques, avec peut-être un peu plus d’exigences) ainsi que les traitements (humains) et incidences biotiques constatées. Et surtout les phytocénoses adjacentes.
La preuve de l’existence d’une espèce en tel lieu et à telle date est plus complexe aujourd’hui. La référence à l’herbier n’est plus suffisante.
La manière dont une espèce se distingue morphologiquement est donnée plus haut. Cependant des descriptions suffisamment précises sur l’ensemble du territoire de sous espèces ou variétés données peuvent amener à une révision et considérer l’ensemble jusqu’alors distingué comme une seule espèce (continuité morphologique sur les gradients géographiques)
L’espèce engage en outre un aspect biologique. Forment espèce des individus dont la descendance est durablement féconde. Mais cela reposant uniquement sur l’hypothèse de barrières reproductives interspécifiques. Or, l’on sait aujourd’hui que les plantes sont plus tolérantes que les animaux à la polyploïdie. On sait en outre que pour les plantes, la spéciation par endémovivariance avec introgression de gènes est forte.
Pour l’expérimentation entre deux taxons supposés au sein d’un genre, il existe tout un tas de trucs auxquels penser. Par exemple :
– doit être autorisé le prélèvement de graines pour chacun des taxons (statut de protection)
– doit être décrite la question en jeu. Les taxons choisis sont ceux soupçonnés comme pouvant s’hybrider/ ou non dans un espace naturel. Un hybride pouvant exister de manière cultivée et protégée, mais être contre-selectionné dans un milieu naturel. Ce qui est visé dans ce test simple, c’est la faible capacité de croisement entre deux taxons supposés différents à se reproduire de manière durable. Mais aussi pourquoi on soupçonne que deux espèces supposées différentes pourraient n’en former qu’une (en général des chorologies ou des conditions écologique)?
– Cette toute dernière question va pouvoir déterminer la/les populations contrôles. Décrites, donc.
– doivent ainsi être connues les caractéristiques propres et différentielles de chacun d’entre ces taxons.
– Les individus testés doivent être normaux et représentatifs des taxons visés.
– Il peut alors être nécessaire de s’assurer que les différences morphologiques entre 2 taxons supposés sont bien dus à une différence taxonomique et non à une différence de milieux/niches où ils poussent : consultation de la littérature. Et en absence de réponse, mise en culture possible de chacun des taxons. Noter que pour les Taraxacum, la mise en culture demande plusieurs générations de plantes avant identification. Noter qu’il est possible que l’expression de taxons mis en cultures soit plus vigoureuse que dans le milieu naturel où la concurrence est plus forte. A ne pas confondre avec la vigueur hybride. Il est sans doute préférable de bien connaître les espèces. Ce qui advient est comparé. En annulation de différence morphologique d’une espèce mise en culture présentant pourtant des différences à l’état spontané … Bref, le résultat est là.
– doivent encore être connues les périodes naturelles de floraisons respectives : dans la même période, au moins par tuilage, sinon pas de représentativité ou faible représentativité.
– Doit être garantie que la fécondation visée est bien celle qui a eue lieu. La fécondation doit préférablement être produite de manière artificielle.
– Des tests d’autofécondations peuvent être recommandés : pour déterminer l’existence d’une barrière reproductive en autofécondation. Normalement on peut aussi supprimer les étamines sur la plante fécondante.
– Il faut éventuellement un nombre de croisements d’individus de chaque taxons. Pour aider à la garantie que la fécondation concerne bien les taxons visés. Pour se prémunir des aléas génétiques au sein de choix d’individus pour chaque taxons. Pour aider à la description de l’individu issu de croisement si toutefois il existe.
– Il peut éventuellement être testé la capacité de l’individu issu de croisement à se reproduire mais en principe, les semences s’obsevent.
Si il ressort des graines viables, donnant naissances à de nouveaux individus, ceux-ci sont décrits et comparés à leurs parents (taxons de départ). Si il y a beaucoup de différences morphologiques entre les 2 générations de 2 parents différents, cela peut indiquer que le transfert de gènes est important. Si il y a une telle transformation morphologique … Une attention particulière est donnée à la forme des graines de ces nouveaux individus lorsqu’ils arrivent à l’âge reproductif. Par principe, l’hybridation est considérée comme mal soutenue, et donne lieu à du matériel reproductif déformé. L’observation du matériel reproductif est indicatif des difficultés d’un hybride à se reproduire. Toutes, beaucoup ou très peu de semences sont déformées, non viables. Si l’individu issu de croisement donne beaucoup de graines viables et ne donne pas une morphologie étonnante, il peut être soupçonnés que les 2 parents sont très proches spécifiquement ou appartiennent à la même espèce.
Une espèce génétique est considérée comme un ensemble homogène, et se distinguant donc d’autres ensembles homogènes formant d’autres espèces. Ces ensembles homogènes peuvent inclure à chaque fois un flux de gènes extérieur, mais ce dernier ne peut être trop important ni trop conséquent. L’étude génétique comprend donc les caractéristiques endogènes à l’espèce mais peut également considérer ses caractéristiques adaptatives (phylogénie). L’étude est bien entendue menée par un laboratoire.
En résumé, si on applique un peu l’échelle de la preuve, l’existence d’une plante sur la Terre peut être prouvée, démontrée ou (probablement à très fortement) présumée. Par contre indiquer la présence d’une plante en tel endroit à telle date tient beaucoup plus de la présomption (probable à très certaine).
Les SHS se prêtent pour beaucoup assez mal à cette échelle de la preuve. Elles atteignent les doigts dans le nez le niveau de présomption sur cette échelle. Pour le reste, on évite en moyenne de faire des expériences sur des congénères. Lorsqu’elles ont lieux, le double aveugle tend à s’imposer. Il n’est sans doute pas toujours possible mais si il est complexe de déterminer des données comme primaires (ou que cela interroge autrui, en fait), il faut trouver n’importe quel moyen ou une organisation de ces données qui permettent de les faire travailler afin qu’elles se filtrent en quelque sorte, et qu’elles puissent puisque c’est le but révéler quelque chose (c’est mon point de vue sur ce dernier point et c’est ce qui les rends parfois très complexe à manipuler/utiliser/lire, et probablement à produire.)
Proximal [descripteur. Botanique]
La base d’une feuille est proximale. Contraire de distal. Partie la plus proche de la fixation d’un organe.
Psammophile
Psammo: sable. Qui vit dans le sable. Synonyme de sabulicole, selon que l’on préfère la Grèce ou Rome.
Pyro-
Relatif au feu.
Q. Haut de page
Quartzite (quartz) [Géologie. Lithologie. Pédologie]:
La quartzite est une roche siliceuse qui tend à abaisser le pH du sol.
Le quartz est beau car il est majoritairement composé de silice. Un sol siliceux est donc un sol acide.
R. Haut de page
Racème [descripteur. Botanique. Typologie des inflorescence] :
Voir grappe. Racème est en principe préférable. Mais tout à fait synonyme de « grappe », et plus précieux.
Rachis [descripteur. Botanique]
Axe centrale d’un organe composé. Si l’organe composé l’est x fois, les axes secondaires sont des rachillets.
Raunkaier [échelle conceptuelle. Ecologie de la plante. Et phytosociologie]
Cette classification qualifie les types biologiques des espèces végétales. Notamment vis à vis du froid. Elle est utile pour comprendre des situations écologiques de groupements de plantes. Voir stratégies CSR de Grime.
- Phanérotypes (ligneux): les bourgeons de renouvellements sont à plus de 40 cm au dessus du sol.
- Mégaphanérotypes (32m)
- Mésophanérotype (16m)
- Microphanérotype (8 m)
- Nanophanérotype(2 à 4m)
- Chamaephytes: (au moins partiellement ligneux; les chaméphytes herbacés sont renvoyés pour des raisons pratiques aux hémicryptophytes): les bourgeons de renouvellements sont à moins de 40 cm du sol
- frutescent
- sufrutescent
- en coussinet
- Hémicryptophytes (non ligneux, sauf parfois à la base et alors plutôt en fin de saison): les bourgeons de renouvellements sont au niveau du sol
- érigés
- stolonifères
- cespiteux
- rosettés
- ruboides ( de Rubus, les ronces …)
- bisannuels
- Géophytes: les bourgeons sont situés sous la surface du sol
- à bulbes
- à tubercules
- à rhizome
- Thérophytes: ce sont des annuelles. Cela comprends des bisannuelles.
- vernale (printemps hiver)
- estivale
Relevé phytosociologique [pratique, méthode]
Le relevé phytosociologique est le fait soit que l’on rencontre une phytocénose (homogène, donc), soit d’un repérage lequel peut être assez long. Et d’aller à la rencontre de ces phytocénoses.
Repérage.
Le repérage va impliquer le fait de viser des régions naturelles (Beauce, Combrailles, etc.). Il va impliquer d’observer la géologie, les pentes, l’exposition, l’humidité, des contraintes à l’expression de la végétation comme l’altitude (froid) ou la continentalité (contraste saisonniers bien sûr mais à l’inverse : les embruns) ; de penser donc en fonction de l’échelle d’Ellenberg. Mais encore, les traitements qui ont été produits afin de sculpter le paysage. Et donc l’historique des parcelles. Ce dernier point peut sauter à l’esprit lorsque l’on va dans une région que l’on ne connaît pas.
Ce qui est repéré : c’est une situation pleinement homogène. Cela demande donc du temps. Le phytosociologue va chercher des situations de groupes de végétations qui soient complètement homogènes.
L’expression d’une phytocénose est conçue comme étant la causalité de la géologie et du climat, par ailleurs, causalité des traitements impliqués par Homo sapiens. Sur le temps long dans certains cas. Aussi, il faut une certaine précision. La précision peut permettre de passer de la corrélation à quelque chose de plus proche de l’exposition de la causalité (par exemple, incidence humaine sur les aspects physico-chimiques du sol mais cela dépasse un peu la discipline). Enfin par conséquence, il n’est pas observé à cheval sur deux prairies jouxtantes.
Ce qui est rejeté : les zones de transitions, les zones à nues. Les zones de transitions sont les zones entre l’ourlet et la forêt ou entre l’ourlet et la prairie par exemple.
Pour repérer ces zones homogènes, il peut être nécessaire d’avoir un peu d’habitude.
L’homogénéité va s’exprimer fonction des conditions stationelles, de la structure paysagère, c’est à dire de la physionomie de la végétation en 3 dimensions, et de la répétition de combinaisons de taxons sur une surface.
Enfin, il faut passer pour repérer la meilleure expression saisonnière.
A ce niveau, le phytosociologue peut envisager de produire plusieurs relevés. Mais, aucun ne doit être juxtaposés ni trop proches (car cela induirait une pression d’observation trop importante).
On voit que ce qui est observé se passe à un degré un peu plus large et plus abstrait que ce qui se passe dans ton jardin dans ton champs dans ta prairie dans ta forêt. Il n’empêche que ce qu’il se passe dans ton champs ou ta forêt puisse répondre à ce qui est observé (parfois sur un rang plus élevé que l’association).
Des point GPS des placeaux, des espaces à observer sont pris. Sont reportés mais sont contrôlés les données géologiques. Le contrôle de la lithologie se fait sur place, en identifiant roches et cailloux (HCL pour les calcites, loupe x10 pour la siltite). L’aire minimale est calculée.
Hauteur
Il est demandé de produire la hauteur moyenne modale de chaque strate.
Ma main fait à peu près 20 cm
Je compte environ 2 cm pour une de mes phalanges, 1 cm pour l’ongle correspondant.
La hauteur de ma jambe fait …
La hauteur de ma poitrine, etc.
Donc 2 points ici.
Hauteur modale : hauteur à laquelle le maximum d’organe végétatif se situe. C’est plutôt de visu. Mais si on part sur un métrage précis, concernant les herbacées … il est possible d’utiliser un disk-mètre. Petit disque qui va écraser les tiges les plus faibles et les plus hautes pour les ramener à peu près à hauteur modale de la plante.
Pour les plantes de grande hauteur. Calcul en tendant un crayon (principe de la croix de bûcheron).
Les strates.
Strates arborée, strate arbustive, strate herbacée haute (prairial), herbacée basse (pelousaire), strate bryo-lichénique. Un point ici sur les 2 dernière strates. Les mousses ne sont que rarement faites. Peu de botanistes du côté de la mousse. Quant aux lichens, il existe des habitats lichéniques à l’instar de la phytosociologie. C’est une spécialité du coup, mais cela n’empêche pas de prendre en compte.
En principe pour le point suivant, l’abondance/dominance, on part du haut vers le bas. Mais ne pas oublier ses gros pieds maladroits, notamment concernant les sous strates herbacées correspondant au pelousaires, et à la strate des mousses.
Abondance/dominance.
L’espace à observer étant repéré, il peut être découpé en parties (par exemple utilisation de quadrats. cadres de 1×1 m). L’abondance dominance joue pour chaque espèce rencontrée. Les espèces ne parviennent pas à floraisons exactement au même moment. Des phénologies différentes peuvent occurrer. Si l’on se renvoie à la partie guide de ce site, pour certaines espèces, il pourra sembler impossible de les traiter. Les espèces présentées sur ce site le sont en fonction des critères botaniques de la diversité. Il faut dans ce cas pouvoir opter pour une altitude un petit peu plus souple, le cas échéant (soit sur les fiches les premiers gros indices, déjà, sans aller jusqu’à l’affinement le plus précis parfois impossible à trouver dans ce type de situations).
Toutes les espèces qui laisseraient un doute sont indiquées entre parenthèses. Si la consultation de la documentation ne répondait pas, et qu’il était décidé de retourner sur le terrain pour parfaire l’identification … Attention : il s’agit de parfaire l’identification d’une plante, et surtout de ne pas reprendre un relevé phytosociologique dans un espace qui aura déjà évolué. Il faut surtout ne pas faire çà. La présence d’une plante ou d’une autre, peut sembler compléter correctement le relevé … Mais il s’agit probablement d’autre chose. L’expression d’un groupement de plantes existe dans l’espace et dans le temps. Par ailleurs, l’espèce peut être notée comme agrégat (indiqué gr. Pour groupe à la place du terme agrégat).
L’abondance/dominance est indiqué dans le relevé phytosociologique. Ce relevé demande de la précision. Plus il sera précis, et produit dans le bon ordre, plus le risque d’un plantage (total) s’éloigne, et cerise sur le gâteau : moins le recours aux mathématiques sera précocement important. Mais cela se passe un peu plus loin. Avec les relevés intermédiaires. Là on est juste sur le terrain.
L’abondance concerne le nombre d’individus par espèces sur l’espace observé.
Cela se présente de manière assez différente que dans un comptage absolu (cas de la biodiversité).
En général les ligneux peuvent comptés 1 par 1, les cespiteux et cespiteuses par fréquences (ou par tiges), en présence/absence pour d’autres cas …
L’observation en simple présence absence est qualitative. On obtient un semi-quantitatif grâce au coéficient d’abondance/dominance.
La proposition en phytosociologie depuis Braun-blanquet est plutôt de faire une estimation. Ce qu’il faut remarquer, c’est qu’une espèce peut présenter un grand nombre d’individus et une estimation de recouvrement peu importante alors qu’une autre espèce peut être peu nombreuse et présenter une estimation de recouvrement importante. L’abondance et la dominance, étroitement liées mais parfois contradictoires sont réunies grâce à une fourchette. Cette fourchette selon mon sentiment donne plutôt l’avantage à la dominance.
La dominance correspond à l’estimation de la projection au sol des parties végétatives pour une plante. Le soleil est de midi.
La dominance (soit le recouvrement estimé) diffère un petit peu du recouvrement. Des modes de calculs ont été proposés pour passer de l’un à l’autre.
Donc il y a une échelle, crée par Braun-Blanquet en 1928 par laquelle l’abondance/dominance est traduite ainsi (les 3 premiers sont moins intéressants):
i : individu unique
r : individu très rares, avec moins de 1 % de recouvrement.
+ : individus peu abondants avec recouvrement estimé de moins de 5 % de la surface.
1 : individus assez abondants avec recouvrement estimé de moins de 5 % de la surface.
2 : individus abondants à très abondants avec recouvrement estimé de 5 à 25 % de la surface.
3 : un nombre d’individus quelconque. Le recouvrement estimé est de 25 à 50 % de la surface.
4 : un nombre d’individus quelconque. Le recouvrement estimé est de 50 à 75 % de la surface.
5 : un nombre d’individus quelconque. Le recouvrement estimé est de 75 à 100 % de la surface.
Pour déterminer les chiffres de (i-)1-5, il est peut-être pratique de faire un croquis.
Sociabilité (agrégation) ;
La sociabilité est traitée à part et facultativement.
1 : espèce isolés, très diffuse, ponctuelle
2 : peuplement ouvert très fragmentés à contours diffus, en touffes
3 : peuplement fermés mais fragmentés en petits ilôts (nappes, bosquets)
4 : peuplement fermés à contours nets, se présentant un peu comme en réseaux
5 : peuplement fermé dense, unifié.
Enfin le stade phénologique peut être intéressant ainsi que la vitalité/fertilité (robustesse) … Mais cela n’apparaît que rarement.
La vitalité peut être surprenante pour les espèces qui poussent dans des milieux bien pourvus en eau et en nutriments. Mais l’idée sous-jacente ici est de repérer les plantes accidentelles qui n’accomplissent pas bien tout leur cycle (difficulté à fructifier, par exemple)
Fréquence.
A partir du relevé produit, il doit déjà être possible de se reporter aux relevés typifiés de végétations. En ce qui concerne ce site. La page consacrée ne considère qu’une primo-information et donc ne traite que de la présence des plantes (considérant donc que les phytocénoses décrites sont souvent suffisamment hétérogènes). Pour en savoir beaucoup plus, je renvoie directement au guide de terrains pour les relevés phytosociologique de Loïc Delassus, du CBNB. Il ne traite que du relevé de terrain. C’est assez complet. Ça me plaît beaucoup.
La fréquence n’est pas donné comme obligatoire. Elle donne une valeur à la présence des espèces rencontrées.
Soit : le nombre de relevés possédant l’espèce/ le nombre total de relevés x100 (parfois indiqués en dernière colonne des relevés typifiés)
r <6 %
+ 6 à 10 %
I : espèce très rare (fréquence entre 11 et 20 % de présence)
II : espèce rare ou accidentelle (fréquence entre 21 et 40 % de présence)
III : espèce relativement fréquente (fréquence entre 41 et 60%)
IV : espèce abondante (fréquence entre 61 et 80%)
v: espèce constante (fréquence entre 81 et 100%)
Il s’agit de distinguer ici des sous ensembles. Les relevés doivent faire l’objet d’une mise en ordre. Il s’agit d’un travail qui prend du temps et qui demande du calme. Il existe aujourd’hui des logiciels. Bruno de Foucault a produit un guide pour le faire manuellement, avec toute la rigueur nécessaire (initiation à la phytosociologie sigmatiste). Ce travail considère plusieurs relevés. L’organisation des relevés est progressive.
En premier lieu, les tableaux sont d’abord organisés avec une colonne par relevé, et une ligne par espèce (le chiffre qui se trouve au croisement est le coefficient d’abondance/dominance).
Puis progressivement, délicatement, en prenant son temps, il est produit des déplacements de colonnes et de lignes selon a) les relevés (en colonnes) qui se ressemblent le plus et b) les espèces (en lignes) selon leurs affinités phytosociologiques. Les espèces de fréquences moyennes sont plus intéressantes pour aider à produire ces déplacements (fréquence III). Finalement, à l’intérieur du tableau dans sa totalité, des sous ensembles homogènes vont se distinguer.
Un premier contrôle rapide de l’homogénéité des sous ensembles peut avoir lieu avec la mise en place d’un diagramme, avec en ordonnée le nombre d’espèces de chaque classes de présence (fréquence), et en abscisse les fréquences (classes de présence) de I à V. Si le diagramme ne prend pas la forme d’un L, d’un J ou d’un U, cela indique qu’il y a un souci et que 2 sous-ensembles sont en fait réunis alors qu’ils ne devraient pas l’être. Cependant que si la morphologie du diagramme ne choque pas, il peut y avoir des erreurs.
Le contrôle s’effectue statistiquement. Le nombre d’espèces par relevés est une variable aléatoire. Bruno de Foucault indique pour Eo, la demi amplitude de cette variable. Eo = nombre d’espèces maximale- nombre d’espèces minimale/ 2. Eo est ensuite divisé par l’écart type, et le résultat doit être inférieur à 2.
Relictuelle, Relique :
Le plus souvent des ligneux, toujours des vivaces. Plante ayant été planté, continuant à fleurir mais ne se reproduisant pas.
Réniforme, rénimorphe [descripteur. Botanique]:
En forme de rein.
Rhéophile:
Relatif.ve aux eaux courantes.
Rhizosphère [Botanique. Pédologie. Ecologie]
Dans l’environnement immédiat des racines (parties jeunes, chevelu), l’environnement se modifie. On porte en particulier l’attention sur les mycorhizes (mycètes), et les bactéries.
Rhomboïdal [descripteur. Botanique]:
En forme de losange.
Ronciné [descripteur. Botanique]:
Quand une feuille pennée possède des lobes très aigus, réfléchis vers la base. Typiquement, les pissenlits.
Rosette
Une rosette est un groupe de feuilles disposées en cercle, à la base de la plante au niveau du sol (Point).
Noter que l’évocation d’une rosette renvoie assez directement aux hémicryptophytes (ainsi qu’à des bisannuelles). Certaines annuelles peuvent présenter pour un temps réduits un stade précoce (suite au dicotylédon) de feuilles disposées en rosette.
Rudéral [notion de l’écologie de la plante]:
Le milieu a subi de fortes perturbations, d’origines « naturelles », débordement d’un fleuve, chute d’un glacier et conséquences, etc. Et notamment, d’origine « artificielle »: présence de l’humain et de ses activités (à distinguer des pollut!ons diverses que l’humain peut produire). Par extension, taxon favorisé par les activités humaines. Plus précis qu’anthropohile.
Bien qu’il existe des milieux rudéraux à vivaces, ce terme renvoie par principe aux thérophytes.
S. Haut de page
Sable [lithologie. géologie. pédologie]
Les sables ont une granulométrie plus grosse que les limons. le grain mesure entre entre 0.05 mm et 2 mm. Les graviers font plus de 2 mm. Leurs pH dépend de leurs natures. Leur réaction à l’eau est plutôt de la laisser filer. Mais dépend en grande partie de leurs provenances éolienne ou aquatique.
Sabulicole
Sabu: sable. Synonyme de psammophile
Sagitté [descripteur. Botanique]:
Forme triangulaire avec deux pointes à la base
Santé unique (one he@lth) [Notion onusienne (et programme) et du monde de la santé, environnement]:
La santé unique fait le constat de plusieurs points liés aux changements globaux … L’évolution des dispersions du vivant … et leurs conséquences sur la santé de l’environnement et de l’humain en particulier. Voir: limites planétaires ; anthropocène
Alors qu’il est habituellement et mécaniquement peu pratique d’intégrer Homo sapiens dans l’étude « naturaliste« , il revient alors par la porte dérobée … Puisqu’il s’agit de le viser aussi dans un système global dont le fonctionnement est nécessaire dans son tout pour assurer le bien être des parties.
Le programme vise en particulier les risques de zoonoses, et de pandémies.
Savane [Concept. Phytosociologie. Phytogéographie]
Les savanes sont des formations tropicales primaires ou secondaire recevant entre 1000 et 500 mm de pluies environ par an. Les formations primaires sont donc en principe très nettement arborées, sans que la canopée ne soit totalement couvrante, bien que beaucoup plus dense vers l’équateur. Elle présente aussi des formations à hautes graminées entre ces arbres. Les formations secondaires, parfois ou souvent traitées par le feu, laisse place à l’image que l’on se fait de la savane: peuplée de très hautes herbes. En directions des pôles, elles se terminent avec des formations xériques analogues à celles des steppes. Le facteur limitant des savanes est la chaleur (forte évaporation).
Scarieux [descripteur. Botanique]
Terme utilisé en opposition à l’aspect de feuillé d’un organe: écailleux, membraneux, sec … Parfois un peu comme ayant la consistance d’un papier (calque).
Sciaphile [descripteur. Botanique. Ecologie de la plante]:
Qui vit à l’ombre.
Sclérophyte [descripteur. Concept (?) Botanique]
Les sclérophytes sont des plantes à feuilles épaisses, recouvertes d’une cuticule épaisse, nettement perceptible à l’oeil, et parfois cireuse. Feuillage persistant. Adapté à la sécheresse.
A l’opposé les malacophytes.
Secondaire [Concept. Phytosociologie]:
Secondaire s’oppose à primaire. Une formation secondaire est impliqué par les humains. D’autres animaux ont sans doute une influence où même une capacité à transformer le milieu. Mais il faut considérer un impact suffisamment fort et distinct. Pour les autres animaux ayant une incidence sur l’environnement, on peut préférablement utiliser la notion d’ingénieurs de l’écosystème. Leurs influences sont renvoyés en milieux primaires.
Mais attention, bien noter que rattachant Homo sapiens à sa phylogénie, j’ai tendance à proposer certains ingénieurs dans cette catégorie: Les vers de terre ameublissent partout (un peu moins et différemment en forêt, cela dit): je les renvoies dans des loci primaires. Idem pour les termites en milieux intertropicaux. Idem bactéries. Idem mycètes spécialisés dans ce même types de tâches, etc.
Pour les fourmis … Lol! Formica rufa fabrique de magnifiques fourmilières. Effet extrêmement localisé à priori, une simple remontée de terre. Cependant, je pense qu’il faut faire du cas par cas. La paléo ecologue, Delphine Renard, beaucoup citée par Stephen Rostain dans « Des Îles dans la forêts pluviale » (je ne connais pas le titre français mais çà doit être approchant), résout le travail à travers les siècles de fourmis: Ici, ces fourmis c’est des loci secondaires. L’impact est très important, très significatif. Magnifique livre our l’un, magnifique article pour l’autre. Marquant!!!
Les castors, et leurs travaux BTP, je rattache çà à des loci secondaires.
Segment [descripteur. Botanique]
Petite division du limbe (inférieure à 20% de sa taille totale), ou petite division libre du limbe
Sempervirent [descripteur et concept (?). Botanique]:
Se dit d’un taxon, d’une plante qui a toujours des feuilles quelque soit la saison. Les feuilles sont en fait renouvelées.
Sépale [descripteur. Botanique. Organe] :
Les sépales forment le calice et constituent des pièces de protection de la fleur proprement dite. Ils peuvent être de couleur verte ou non, ils ont un aspect plus feuillé que les pétales. Ils se situent juste dessous.
Série de végétations [Concept. Phytosociologie]
Une série de végétations est un groupement dynamique de plusieurs phytocénoses. A l’intérieur d’un Tesela (unité spatiale écologiquement homogène), les différents stades dynamiques, s’inscrivant donc dans des successions végétales, caractérisent la série de végétation.
Serpentinite [lithologie, géologie, pédologie. écologie. environnement. phytosociologie]
Roche métamorphique ultrabasique, ayant aussi une incidence sur la végétation en lien avec sa richesse en métaux lourds (Nickel, Cobalt et Chrome).
Sessile [descripteur. Botanique] :
Organe fixé directement à la tige : fleur sans pédoncule, feuille sans pétiole.
Sidérophores [écologie. biologie. pédologie. agronomie]
Les sidérophores sont beaucoup le produit de certaines bactéries, ainsi que de quelques plantes telles les Poaceae.
Un grand intérêt semble porté à Pseudomonas fluorescens. Très belle bactérie, mais très utile aussi. Elle produit de la pyoverdine (le nom du sidérophore) qui va lui permettre de rendre disponible pour elle le fer qu’elle trouve au sol. Mais de manière amusante, le phosphore (lequel a tendance à se transformer de manière indisponible pour les plantes) à tendance à se coller au fer. Si bien que Pseudomonas fluorescens est vendu comme biostimulant (nom comique mais l’équivalent d’un engrais qui fonctionne, par contre) car il a le pouvoir de rendre disponible le phosphore pour les plantes: le sidérophore rend par le même coup le fer et le phosphore sous des formes disponibles.
Siltite [lithologie. Géologie. Pédologie]
Silt: Limon. La siltite c’est du limon sous forme de bloc rocheux. Il s’agit donc de granulométries des composants de la roche. Normalement les composants du siltstone sont plutôt homogènes. Un peu plus que dans le grès. Pour rappel le limon possède une granulométrie plus fine que le sable et plus grosse que l’argile. Déterminer la siltite implique par principe une optique spéciale permettant de faire des mesures. Cependant la siltite a un comportement différent du grès. Elle se comporte comme une schiste (mais ne présente pas de feuillets horizontaux comme le schiste): quand on la casse cela fait des feuillets. On peut la rayer avec une lame de couteau. Comme sa granularité est fine, la poussière produite (par exemple lorsqu’on la casse) est douce à l’instar du limon.
Ici, cette siltite issue du magnifique complexe géologique de Granville contient de la quartzite:

Alt text: la photo ci dessous montre une pierre qui a été aisément brisée à la main, formant des sortes de feuillets. Elle illustre la définition du texte que l’image accompagne.
Soie:
Poil long, raide (avec cette consistance). Se réfère aux poils de certains animaux: suidés (porcs).
Sous-espèce [concept. botanique]:
Rang taxonomique directement inférieur à l’espèce. Un taxon peut être désigné comme sous espèce du fait de son hybridation possible avec un taxon très proche et non identique : un peu différent (notamment morphologiquement). Ces petites différences mais parfois nettes, constantes, interdisent l’assimilation de ces deux taxons à une seule espèce. Les deux taxons prennent alors le rang de sous-espèce, et le rang d’espèce devient théorique (on ne trouve pas l’espèce type puisque son rang est la sous espèce autonyme). La chorologie un critère rentrant en compte. Les sous-espèces se trouvent le plus normalement dans des aires distinctes. Si deux espèces, peuvent donner lieu à une descendance, cela interroge leurs statuts d’espèces. La chorologie est indicative de modalités de spéciations.
Un ensemble de critère permet de distinguer les rangs d’espèce, sous-espèce, variété ainsi que forme.
S’écrit : subsp.
Spatulé [descripteur. Botanique]
De spatule. élargi au sommet et se rétrécissant progressivement sur le pétiole.
Spontané [Concept. Botanique]:
S’oppose à cultivé, cultigène. Croit de manière spontanée, « naturelle » sans intervention humaine. Petite fleur sauvage …
Steppe [Descripteur, concept. Phytosociologie. Phytogéographie]:
Une steppe est souvent moins haute, moins fermée (recouvrement du sol inférieur) à une prairie (biomasse inférieure), elle est bloquée dans sa dynamique de successions par un climat trop contraignant. Le facteur limitant est généralement le froid. Elle est cependant plus haute que les pelouses. Les steppes des grandes prairies américaines ont été confondues avec des prairies, et mis en cultures par les colons anglo-saxons … Il s’en est finalement résulté le dust bowl, du fait d’exigences de cultures un peu forte pour ce type d’écosystème.
Stipule [descripteur. Botanique]
Appendices foliaire, écailleux ou même épineux à la base d’une feuille, par deux, sur le pétiole (mais parfois au niveau de la tige).
Stomates [descripteur. Botanique. Biologie]:
Ce sont des orifices qui se trouvent sous la feuille et qui permettent les échanges gazeux de la plante avec l’atmosphère de l’air. Notamment le CO2, le carbone qui sera synthétisé pour que la plante en tire sa matière (cellulose et amidon pour l’essentiel). Par ailleurs, c’est par là qu’elle fait pipi. Toute l’eau surnuméraire absorbée par la plante est vaporisée à l’extérieur par les stomates.
Voir: Nutrition
Stress thermique (écologie)
Froid: le stress thermique pour les plantes est variable selon l’espèce considérée.
Chaud: On considère les gradients de 45-50°C, comme présentant des risques pour la bonne homogénéité des membranes tissulaires des végétaux. 50°C et au delà: risque de mort. Pour s’en faire une représentation, 50°C est une température diurne possible dans le Sahara.
Structuralisme [méthode]
Le structuralisme est une méthode issue de la linguistique rapportée notamment à l’anthropologie par Claude Lévi-Strauss. Avec un certain succès. Rapportée à l’histoire par Pierre Vidal-Naquet, par exemple, avec un succès plus mitigé (mais il faut encore beaucoup prendre en compte l’enjeu des questionnements).
Cette méthode a particulièrement intéressé Bruno de Foucault lorsqu’il a participé à la mise en forme de la phytosociologie synusiale. L’intérêt qu’il y porte tient au fait qu’il s’agisse d’une analyse de systèmes de systèmes.
J’aperçois un autre intérêt. Plus modestement. Concernant les disciplines dont les travaux ont une tendance à reposer sur des témoignages. Or, dans un témoignage, il y a quelqu’un qui témoigne. Ce quelqu’un se fait d’une part une idée de lui même, il est doué de subjectivité. D’autre part il est pris dans le cadre de ce témoignage dans un maillon social. Ce qui fait des informations alors produite, des informations presque toujours parfaitement valides (le plus probablement), mais difficile à utiliser, à en produire un outil de réflexion (qui ne soit pas lui-même le fruit de la subjectivité de celui qui réfléchit sur ces informations). Les contenus textuels (iconographiques également), mais aussi dans une moindre mesure les enquêtes sociologiques (le semi directif ne me convainc pas toujours assez, bien que … ) ont tendance à m’interroger, désormais –cela n’a pas toujours été le cas. Je suis sans doute trop prudent.
Les structures analytiques très abstraites si l’on veut, font finalement fi de l’impression subjective du témoin. Ainsi quelqu’un peut décrire sa famille comme matrifocale, mais ne pas du tout accepter l’idée de matrifocalité. Ses arguments peuvent alors être mis à l’épreuve par la manière dont on constate la manière dont les choses s’organisent d’une part, et statistiquement d’autre part. Et son déni mis en valeur.
La discipline historique est je crois la première à avoir pu noter des limites avec le terme courant d’information de guerre. De manière plus ou moins surprenante, le fait qu’une majorité de la population adhère, et par ailleurs est incitée à adhérer à quelque chose de faux, cela dépasse malheureusement l’information de guerre, et même le couramment perceptible. Cela va me donner l’occasion de donner l’explication de pourquoi le Journal de Référence est pour moi le plus souvent un tract tarifé. Au lendemain du fait que le FMI entérine l’analyse de la dette cachée du Sénégal (et donc entérine le fait que le gouvernement Sall a effectivement fauté) le journal Le Monde regrette justement le contraire « les autorités du pays accusent le régime précédent d’avoir dissimulé les vrais chiffres de la dette publique et du déficit budgétaire » dans « Sénégal : face aux difficultés économiques, le premier ministre demande des « sacrifices » à la population », en date du 10 novembre 2025. Plus impressionnant, cet article est en fait un article de l’AFP. Pour qui se prennent l’AFP et Le Monde pour aller expliquer l’inverse de ce que comprend le FMI, partenaire essentiel dans cet évènement? Le fait de savoir que Macky Sall, est l’un des rares dirigeants non blancs à être apprécié du chef d’Etat français a t’il un rapport? Quoi qu’il en soit, l’AFP comme Le Monde nous incite à penser des choses non avérées, et à propos desquelles nous n’avons a priori aucune raison de penser qu’il y aurait de la pol-pol à produire en direction des masses.
Cet exemple pour montrer la difficulté à entreprendre la question de la subjectivité, laquelle parfois ne peut même pas être forcément mis en balance par des statistiques. J’admire la ténacité des historiens, lesquels se trouvent particulièrement exposés à ce type de difficultés.
Bien que je ne me sois jamais fait moqué par des ethnologues, on trouve aussi ces problématiques que je décris ici. Cependant que d’une manière théorique, les sociétés contemporaines peuvent être plusieurs fois visitées et étudiées (certaines l’étant plus que d’autres, et l’ethnologie et l’anthropologie manquant aussi de chercheurs). D’un côté je fais partie des personnes un peu sceptiques sur l’anthropologie de Pierre Clastre (et cela a une influence sur la réception que j’ai de son ethnologie, mais il s’agit d’un exemple bien particulier, et très lié à sa rhétorique), d’un autre côté je me sens souvent un peu embarrassé dans la littérature purement ethnologique. Le « niveau » anthropologique permet une réorganisation des données. Il y a heureusement beaucoup de disciplines anthropologiques dont l’anthropologie historique (ce qui convoque si je me souviens correctement: Braudel, Le Goff qui me fatigue je ne sais pas pourquoi, Vernant et Vidal-Naquet …)
Dans ce cadre de réorganisation des données, le structuralisme me semble très satisfaisant. Il faut cependant remarquer qu’il y a une sorte de familiarité des raisonnements entre le structuralisme et la phytosociologie. Cela implique que d’autres formes de réorganisations des données soit satisfaisantes sans que j’y accorde l’intérêt légitime. L’anthropologie structurale va impliquer la mythologie, les systèmes familiaux, etc. ). Ces structures familiales sont relativement touffues, sachant qu’on les abordes aujourd’hui à partir de la famille nucléaire égalitaire et de l’exogamie qui nous concernent.
Les structures familiales complexes contiennent un flou. Ce flou est pour nous, en Europe, entretenu par la différence lexicographique de Le Play et de l’anthropologie structurale de la parenté. Les concepts dans cette discipline sont particulièrement précis et articulables. La tentation est donc d’utiliser le premier mot historique subissant ces ambiguïtés. Quant bien même, la définition finale, après description mettra en échec ce terme, pour en proposer un autre plus juste. Le système à maison est une structure complexe mais qui n’a rien à voir avec les familles étendues. L’entreprise Renault je crois a justement longtemps été une maison. Qui que ce soit qui dirige, il s’agit de la maison Renault. C’est la maison qui prime en tant que personne morale en ce qui concerne l’identification sur les personnes physiques qui y sont. Ce système a été proposé par Lévi-Strauss. L’ambiguité terminologique ne concerne pas seulement la personne qui s’intéresse aux structures sociales mais aussi la personne qui lit/écoute.
La position d’Emmanuel Todd n’a rien arrangé selon moi. Il réemploie la terminologie leplaysienne dans une autre perspective analytique.
Je voudrais montrer un exemple avec la société Wolof. D’un point de vue structural, la société wolof est (plutôt) polygame et présente des familles souches virilocales avec classes d’âges et éventuels autres cadets sociaux (parce que : primogéniture matérielle agnatique, essaimage du/des cadets et dispersion des filles). Cela diffère alors des systèmes simplement étendus (ou communautaire) où l’héritage se trouve partagé.
Ce type de terminologie ne rend que partiellement compte de la réalité à décrire ou décrite. C’est du brut. Mais ici en l’occurrence, on va trouver encore un ensemble de problèmes. Car cette terminologie pourrait être tout à fait insuffisante ou risque d’être trompeuse.
D’une part, Delphine Durand Sall a choisi d’étudier la circulation des femmes et les effets induits. Ce qui m’a incité à m’interroger non seulement sur la patrilocalité ou bilocalité (patrilocal strict mais avec bilocalité cordiale, au moins un petit moment), mais éventuellement du coup sur l’idée de quelque chose d’autre comme une éventuelle part de système à maison (échec : il n’y a rien de ce côté là)
Surtout le meilleur descriptif concernant les sociétés ouest africaine existe. Mais très englobant, il est totalement difficile à articuler. Evans-Pritchard l’a décrit d’Inde sous la terminologie de société lignagère. Le concept est assez globalisant puisqu’il comprend la question des « territoires ». En l’occurence pour des agriculteurs, la zone d’habitation et les terres. Un des grands intérêt du concept de société lignagère, ici, est de mettre en valeur le lignage comme structure politique. Le fait que le concept inclut les « territoires » est assez peu pratique dans le champ de mon questionnement général (mais on est ici dans un cas où il n’est pas très pertinent de faire abstraction du travail. Il y a une correspondance genre-tâches plus qu’importante.) Et je préfère du coup tant que possible conserver la lecture structurale. Cela peut je l’espère permettre des comparaisons. Cependant, l’essaimage familial, ici décrit avec la position du/des cadet(s) est indiqué dans le concept de société lignagère. De souvenir le travail classique d’Abdoulaye-Bara Diop propose une lecture structuraliste (ou proche), Jacqueline Rabain fait référence à Evans-Pritchard dans le titre d’un ouvrage. Harris Memel-Fôté utilise ce concept pour la Côte d’Ivoire. Les lignages sont indiqués dans le mythe fondateur des sociétés Wolof et Sérère (Ndiadiane Ndiaye). Les sociétés lignagères, hyperclassistes et hyper autoritaires, ne proposent qu’un lignage, qu’il soit cognatique ou qu’il soit agnatique. Ici, se marque une différence. L’enfant retourne beaucoup plus vers sa mère que vers son père, semble-t-il.
Le double lignage crée un halo. Ce double lignage incite à être délicat.
Par ailleurs, il y a deux types de mariages : dotal ou musulman, mais cette question n’est pas abordée ici. Noter que la polygamie n’a rien d’obligatoire. Il est possible de choisir la monogamie. Et que cette dernière peut dominer de n’importe quelle manière pour des raisons économiques.
(Presque toutes les données ici sont en sources secondaires, et ont donc valeur d’informations:)
Le lignage maternel est donné comme symbolique mais déterminant qui s’occupe de l’enfant en priorité (quelles tantes biologiques), et avec qui se mariera plutôt l’enfant (le mariage répondait au modèle le plus courant: le dravidien). Il y a un patriarche et quand il n’est pas là sa première femme est « matriarche ». La filiation cognatique (du côté des femmes) est réputée donner la personnalité, le charme et tout ce qui compte vraiment. La filiation agnatique (du côté des hommes) est la plus concrète, transmission du nom de famille, et primogéniture agnatique (tempérée de la position de la première femme). La maison=le hameau (=la famille) lequel est partitionné selon le genre des adultes, avec une position particulière pour le patriarche qui doit pouvoir voir venir de loin qui arrive au hameau. Terminologiquement, le patriarche est donné comme le chef de famille. C’est une exagération de la traduction. Il est Borom Kër. Borom, c’est pas seulement chef mais aussi propriétaire, et Kër, c’est aussi bien famille que maison. Il n’est pas seulement chef/propriétaire des personnes qui vivent à la maison. Il est chef/propriétaire de la maisonnée. Il est chef de maisonnée. La famille forme 2 sociétés de travail complémentaires. Noter qu’il y a jusqu’à deux foyers (ou 4 mais considérer les 2 foyers suffit à la distinction), plutôt 2 au moins en termes d’horaires (il y a priori d’autres formes de partitionnement possible selon les degrés de consanguinité, d’affinité). Les foyers et lieux de vies: L’un pour les femmes et les jeunes enfants, l’autre pour les hommes et les garçons à partir de 5-7 ans. Je témoigne de la séparation des foyers. Les badoola (les paysans) ne sont pas castés (la société Wolof comportait des libres et des castes). Les artisans l’étaient et devaient se marier obligatoirement au sein de leurs castes. Pour interpréter ces données qui restent trop brutes, il faut prolonger. J’ai pour habitude de prolonger à partir du statut des enfants (le statut des enfants, c’est ce qu’on attend de la génération suivante ; ce que l’on veut pour eux et ce que l’on veut pour soi d’eux. Il n’est pas question par exemple d’imaginer une agentivité de l’enfant wolof).
Etant donnée la très stricte séparation des tâches et de toute la vie entre les hommes et les femmes, attribuer une noblesse des tâches perçues fonction des genres n’est pas forcément évident. Si. Cependant bien que les parcours techniques agricoles choisis privilégient l’autoconsommation, une partie de la production réalisée par les hommes sera généralement vendue et participera distinctement à l’économie domestique. Du côté des enfants, donc et pour en avoir la portée:
L’enfant appartient au hameau, en tous cas à la famille étendue mais le lien le plus prégnant est pour moi le double système de productions au sein d’une maisonnée. Typiquement cependant, il y a une articulation entre l’importance de la famille et l’importance de la maisonnée. De l’appartenance au hameau ou à la communauté familiale, des priorités sont édictées. Ce n’est pas n’importe quelle tante qui va prioritairement s’occuper de l’enfant en plus de sa mère biologique (lecture en parenté du système wolof), et notamment donner le sein. Une tante sur le côté mariable ne peut pas donner le sein car elle deviendrait la mère de l’enfant. En ce qui concerne la terminologie, le système semble iroquois (mais il s’agit d’un système dravidien préférentiel): les cousins et cousines biologiques sont dénommés frères et sœurs (pas toute.s), l’oncle biologique est appelé petit papa, la tante, petite maman. Petite maman habite peut-être un autre hameau. Après son mariage elle rendra visite. Les enfants dont elle est co-responsable restent pour autant là où ils sont (sauf dons d’enfants). Les liens affectifs de l’enfant sont ainsi tissés ou en tous cas encouragés. La maisonnée, c’est à dire le système de production double me semble l’emporter légèrement sur la question des lignées cognatique/agnatique. C’est à dire que finalement l’aspect agnatique domine puisque matériellement plus efficace. Légèrement. Légèrement car les alliances, et donc la circulation des femmes introduisent d’importants changements, et modifient très substantiellement le schéma de filiation agnatique matérielle (la thèse de Durand Sall est de positionner la maison du marié comme un peu moins importante que la circulation des femmes dans la société). Cependant, l’ainé est l’héritier par principe de la maisonnée, i.e: du système de production. Cette filiation agnatique apparaît sans ambiguïté. Cette absence d’ambiguïté fait de la question de la maison, maison comme typologie anthropologique, et si tant est qu’elle existe un personnage très secondaire. Cependant encore que le double système de production n’est pas tant secondaire que cela. Les genres trouvaient une expression nécessaire dans les types de tâches (surtout du côté des hommes où l’ensemble des tâches n’a qu’une portée unique) et les rôles dévolus par genres sont en liens avec la circulation des femmes et celle des hommes. Il ne s’agit pas ici selon moi de mélanger une analyse de type économique à une analyse de la parenté avec une analyse des circulations. Les genres et j’en témoigne se mélangent peu. Il ne faut pas en conclure à une mésentente. Cela n’a rien à voir. Il semble que la séparation entre les genres était vraiment très très nette et tendent à le rester ou même à prendre des traits caractéristiques différents mais en témoignant. Cela a des implications sur l’organisation de la maisonnée, or cette dernière s’exprime par les circulations et par ce qui s’y passe comme un système de production. On dit des sociétés Wolofs qu’elles sont à lignages. Ce qui est totalement correspondant, mis à part la question revendiquée du double lignage, attestable en tous cas par le fait qu’une tante qui n’est pas mère classificatoire, et se trouvant donc du côté mariable de l’enfant ne peut lui donner le sein sous peine d’en faire son enfant et réduire alors ses possibilité de mariages à venir. Attestable plus certainement par l’importance attribuée par les wolofs à ce double lignage.
Dès lors qu’ils sont doués de paroles (en opposition avec la période nourrisson), l’éducation des enfants est très cadrée. Respect des ainé.e.s, des adultes et des anciens. Ils sont susceptibles très tôt d’être assez constamment ramenés à leurs sexes biologiques. Les garçons à partir de 5-7 ans quittent la maison de femmes et vont suivre les hommes aux champs. Les filles restent avec les femmes. On attends d’eux qu’ils apprennent à devenir sociables. Les enfants doivent apprendre à être rafetal (que je traduis dans ce contexte par « corporate »; rafet veut dire joli). Ils subissaient autrefois mais jusqu’à il n’y a pas suffisamment longtemps des sévices éducatifs ou en tous cas de telles choses sont rapportées. Il n’est pas dit que ce soit pire que dans des lycées catholiques du nord finistère ou à Bettharam, bien moins pire en fait. Notamment les garçons lesquels pouvaient être confiés au marabout (l’imam) pour un « dressage » plus vigoureux. L’éducation des filles était également susceptible d’être un peu dure.
Les enfants wolofs passent souvent aux yeux des occidentaux pour de petits adultes. En ce sens, il faut modérer la dureté de l’éducation. Les enfants travaillent. C’est à dire qu’ils participent aux tâches, bien plus qu’en Europe. Cela semble être perçu par les adultes comme de l’aide ou au mieux de petites tâches. Il s’agit de tâches assez importantes déjà. Cela s’inscrit dans une visée éducative. L’enfant participe. C’est une manière de socialisation. Il travaille, c’est une manière d’inscription dans la société. Il apprend la hiérarchie sociale. Il est obéissant. Kae Amo (dans l’anthropologue à l’école coranique (…), Anthropochildren n°4) indique bien cet aspect. L’anthropologue s’attarde sur un exemple devenu discutable aujourd’hui (ce n’est pas seulement les intellectuels urbains et les occidentaux mais l’État sénégalais qui s’est saisi de la question) mais particulièrement représentatif de ce que cela a pu être par le passé, et de surcroît comparable à ce que l’on a pu connaître en France: il s’agit des talibé (apprenant, étudiant). Les enfants talibé mendiants. Les enfants passent du temps notamment vers midi en dehors de leurs daara (école coranique) pour mendier. Il rapporte l’argent au marabout qui se paie ainsi de son enseignement. C’est le point de friction avec l’Etat. On voit là quelque chose de tout à fait désagréable. Si on change de perspective, et Kae Amo indique avoir fait des entretiens … On obtient apparemment quelque chose autour de la grâce du sacrifice. L’enfant s’illumine ( vers Allah) en se sacrifiant mais illumine en retour celle ou celui qui le remarquera. C’est très proche de la culture de l’indulgence catholique. Je comprends mieux sous cet angle le talibé qui a travers l’avenue proche de Sandaga à Ndakaru me tendait un bonbon avec un regard rempli de générosité. Indice de la mésestimation des femmes dans ce système familial wolof: c’est aux enfants filles que l’on pense prioritairement.
Pour bien forcer le trait, je vais me reporter au début du XX ème siècle, période un peu particulière, pendant laquelle les femmes étaient promises dès parfois 6 ans. Il y a une différence entre la promesse et le mariage. Il y a une distinction: le mariage est imposé. Il y a bien sûr une grande différence, parfois inaperçue ici, entre le mariage et la consommation. Ainsi qu’indiqué plus haut la famille forme une double société de travail. C’est un peu comme une entreprise. Les sentiments vont s’exprimer à travers ce contexte. Et alors que chez nous la beauté plastique a parfois une certaine importance, la séduction est/était liée chez les wolofs à l’idée de bien travailler. Avec comme axiome secondaire: tel enfant, tel parent. Une personne fille belle est donc une personne dont on dit que la mère travaille bien. Une personne garçon belle est une personne dont on dit que le père travaille bien. Cela pouvant être une explication du très jeune âge des promesses de mariages au début du XX. Quoi qu’il en soit la fille plus que le garçon connaît des rituels qui l’emmène vers l’âge adulte et vers le mariage. Parmi ceux-ci, les coiffures. De souvenir, il y 4 ou 5 types de coiffures qui sont indicatifs de l’âge de la personne. L’une des dernières signifiant « bientôt mariable » et indiquant en outre que la jeune femme est en train d’apprendre à confectionner les meilleurs plats. Ce rituel est aussi indicatif de l’existence de classes d’âge chez les enfants wolofs, mais également des classes d’âges adultes (le respect des anciens). Potentiellement, la coiffure sénégalaise a pu peut-être être un frein au port du voile (???) La symbolique des coiffures a disparu depuis assez longtemps. Et depuis quelques années, c’est les qualités esthétiques qui sont mises en avant.
La jeune femme mariée partira préférentiellement chez un cousin croisé. Les données consultées concernant les unions indique le type dravidien qui par ailleurs est très courant. Cela jusqu’à Delphine Durand Sall. Certainement une évolution de la société. La jeune mariée quitte donc sa maison. Et se dirige vers une personne qui ne lui a jamais été tout à fait inconnue, mais pas nécessairement bien connue non plus (cependant, l’épouse ou l’époux d’or est le cousin croisé de degré 4, par exemple la fille d’une sœur du père). Lors de son arrivée dans sa nouvelle demeure, la nouvelle mariée sera guidée souvent par une sœur du marié (ou une amie proche de lui) pour appréhender la particularité des habitudes et rituels de la famille. Cette cousine particulière le restera. Il s’agit de la Ndjëkke (: mari féminin). Elle gardera donc une autorité sur la nouvelle mariée. Cette nouvelle mariée s’intégrera dans une société féminine où le respect de la belle mère et potentiellement de la première femme est indiqué (ne serait-ce que parce que c’est factuellement la belle mère est la patronne et qu’en tant que telle, elle se dispense parfois de certaines tâches). Cette société féminine s’exprimera dans un mélange de concurrence, d’éventuelle coopération et d’organisation très millimétrée, leur libérant du temps pour vaquer à des occupations pécuniaires. La femme nouvellement mariée était semble t’il accueillie par les autres femmes avec un rituel assez puissant (toujours un peu « théâtral ») où on lui interdisait l’entrée à coup d’insultes (elle est « voleuse de mari »). La cousine particulière ayant ici le rôle difficile de négociatrice (ainsi que d’éviter que cela ne dégénère). L’articulation maisonnée/filiation familiale est susceptible de rester un temps dramatique pour les femmes puisqu’il peut y avoir des périodes de retours à la maisonnée d’origine. De fait, la femme ressort de deux maisons, celle d’origine où elle se sent certainement mieux et celle qu’elle rejoint. De la même manière, les liens biologiques du côté des hommes à l’intérieur d’une maison (kër) peuvent parfois être un peu distendu. L’enfant fille regarde un avenir beaucoup plus difficile que celui que regarde l’enfant garçon, lequel n’est promis qu’à une seule et unique fonction: ramener à manger à la maison (de l’argent ou du mil). Cette fonction unique fait cependant peser un poids très lourd sur ses responsabilités. Les données sur la circulation des hommes (agriculteurs) sont liées aux périodes de grandes sécheresses où ils migraient alors périodiquement en ville pour le travail. L’enfant qui n’est pas héritier peut également avoir un intérêt à fonder sa propre maisonnée. Je témoigne que les hommes semblent circuler différemment (d’une manière générale l’ethnologie de Durand Sall résonne et explique ce que j’ai pu voir). D’une manière générale, le retour est lié à la consanguinité et à l’affinité. A la famille proche, comme pour les femmes. Mais le contexte est aussi celui du travail. La consanguinité, l’affinité est vraiment très importante, et signalée de longue date (dans le mythe fondateur de la société Wolof et Sérrère avec le mêen –Mythe de Ndiadiane Ndiaye) sur le flanc matrilinéaire.
Aujourd’hui les rencontres sont organisées semble t’il presque exclusivement entre amis mais aussi frères et sœurs et cousins dans une belle entente: au niveau du quartier. Si les mariages restent toujours trop précoces dans les campagnes (les badoola ne connaissent pas bien les lois sénégalaises), de plus en plus de femmes vivent en familles monoparentales, reprochant aux hommes de ne pas savoir s’occuper des enfants. Si il y a un reproche sur le chômage des hommes je ne suis pas sûr qu’il soit exprimé. Eux ne semblent pas parvenir à le vivre. La dimension si l’on veut un peu « féministe » s’inscrit dans l’histoire du Sénégal. Le féminisme assez universaliste de Fatou Benitou Dial ne rencontre pas forcément le succès attendu dans des milieux plus populaires tels que la famille du nord de la péninsule dakaroise décrite par Delphine Durand Sall. On comprend entre autre l’intérêt pour une jeune femme de constituer un réseau de connaissances (pour toutes sortes de raisons mais aussi pour des raisons professionnelles par exemple, en tous cas il y a un intérêt ici) en acceptant/désirant l’expérience du mariage traditionnel polygame, cela quitte à divorcer par la suite (le divorce pour raisons de comportements est admis et pratiqué).
Le Système familial Wolof traditionnel était structuré très précocement selon le genre, et cela étant visible dans la topologie des lieux, Et tout particulièrement stratifié. Stratifié d’une part vis à vis de l’âge des personnes, et stratifié d’autre part vis à vis du degré d’éloignement vis à vis du patriarche. Ce dernier étant le seul à n’avoir que des cadets sociaux, sans être lui-même cadet social de qui que ce soit dans un sens ou dans un autre. Le nombre de foyers peut témoigner des stratifications. La distinction en genres se répète dans la topologie et dans les responsabilités. Ce dernier aspect allié à la forte hiérarchisation impliquent une liaison très forte des aspects travail-genre-circulations types. Si l’on compare avec la famille conjugale élémentaire (nucléaire) égalitaire en héritage tel que pratiqué en pays de Vitré comparée elle même à tel que pratiquée dans la Manche, on s’aperçoit que dans ce dernier cas (la famille élémentaire dans cet ouest de la France), il n’y a pas de formation obligatoire d’un couple travail-genre pour les egos (le travail genré est du à une représentation de l’homme ou de la femme, mais beaucoup plus facilement distinguable de la structure de parenté).
noter: un cadet social se trouve avoir plutôt plus de devoirs et moins de droits que son aîné social. Ici, par exemple un cadet vis à vis de l’ainé, un affin vis à vis d’un consanguin etc. Il s’agit des classes d’âges et du degré d’éloignement vis à vis du patriarche. Ce sont je crois des concepts issus d’analyses marxiennes. Ils sont pratiques. Je ne vais pas plus loin autour de çà.
La polygamie constitue un facteur favorable pour avoir beaucoup d’enfants dans chaque maisonnée. Avoir beaucoup d’enfants, c’est espérer que l’un d’entre eux au moins réussisse et puisse aider dans le vieil âge. Sur le plan agricole, les Wolofs sont situés sur sols Dior (secs sablonneux et plutôt pauvres). Très peu d’arbres. Plutôt pas d’arbres. Plutôt pas d’élevage non plus (la possession d’un cheval est/était préféré à la possession d’un tracteur). Le parcours technique agricole néglige la restitution des fanes et restes végétaux au sol et privilégie de les donner aux bêtes (aux vaches notamment) de sociétés qui pratiquent plus l’élevage qu’eux. Les sols ont donc tendance à s’appauvrir encore un peu. Cependant, cette remarque prend peut-être mal en compte la pratique arachidière, et la mort des racines nodulées azotées des cacahuètes (l’appauvrissement semble confirmé par une étude phytosociologique). Il y avait jusqu’il y a peu une part de conquête territoriale dans la pratique agricole wolof: agrandir le bol. Mais agrandir le bol, défricher et acquérir de l’hectare est aussi susceptible de demander plus de bras. Il y a donc un rapport qui s’établit entre le parcours technique agricole (et ce que cela rapporte) et la manière dont est envisagé la polygamie. Il faut cependant noter le champ interprétatif réduit. Ce type de structure familiale est répandu en Afrique de l’Ouest, prenant à chaque fois des particularités, et quelque soit la production économique des différentes familles ou sociétés. Cependant le lien entre le nombre d’enfants à espérer et la possibilité de conquête de terre est ici effectif, et le rapport à l’essaimage (les cadets s’en vont ailleurs faire une autre maisonnée). L’un des grands tabous wolof est (? ou était) le fait de ne pas avoir d’enfant (une explication donnée du don d’enfants au bénéfice des couples qui ne peuvent en avoir). Je crois que le Sénégal tends à se situer dans le haut du panier en terme d’enfants par femme avec 4 contre 3 ailleurs en Afrique de l’Ouest. C’est ce qui est considéré comme beaucoup d’enfants. A comparer avec la fécondité au moins souhaitée des catholiques intégristes (au doigt mouillé, tout à fait équivalent), et au fait que pour l’hexagone, l’insee fait commencer les familles nombreuses à 3 enfants.
Pour comparaison, dans le système amazonien (sur l’exemple machiguenga. Merci Esteban): le chef de « hameau » est celui qui chasse le mieux. Celui qui chasse le mieux est celui qui rapporte le plus de nourriture. On chasse pour les autres et non pour soi. Le produit de la chasse est donc donné. Le patron est celui qui donne les bonbons, si l’on veut. Cependant, il ne s’agit pas vraiment d’un chef. Mais d’une personne ayant plus grande aura. Un mec à succès. L’homme est réputé prendre les décisions au niveau de la famille. Esteban Arias me suggère qu’il faudrait peut-être vérifier que ce ne soit à la demande des femmes. Les femmes travaillent aux essarts. L’homme ne possède rien. La femme ne possède rien. Personne ne possède rien. Dans le système amazonien, la position du jeune homme est plus difficile que celle des femmes. Le jeune homme, dans le contexte d’une union dravidienne, bien que polygame, se déplace chez sa belle famille. Chez la mère de son épouse. C’est elle qui est dépositaire des terres qui sont mises en cultures, et de celles de chasse. Cependant il se déplace surtout chez son beau père, à qui il devra prouver qu’il est suffisamment bon chasseur. L’éducation des enfants: elle est très libérale (et demande beaucoup d’attention et d’énergie aux adultes). Les rapports d’autorités sont très différents dans le système amazonien que chez les Wolofs ou même les Sérères, où la circulation intra et extra maisonnée est importante, et notamment mise en valeur par Delphine Durand-Sall.
J’ai mis hameau entre guillemets pour les amazoniens car l’ensemble de terminologie hameau-village-ville est vraiment très bien décrite mais me semble trouver quelques limites, d’ordre seulement théorique en principe. Si on suit la définition, il n’y aurait que des hameaux dans les sociétés amazoniennes. Cela est susceptible théoriquement de subir un biais d’ethnocentrisme occidental. En effet pour les sociétés amazoniennes leurs vécus de qui est le « chef » n’est pas fantasmé. Quant bien même, chef il n’y a pas. Simplement un mec qui réussit mieux. Pour les pays comme la France ou le Canada qui n’ont pas tout ratifiés concernant les droits des « peuples premiers » (conventions 107 puis 169 de l’Organisation Internationale du travail, en rapport notamment à la question du foncier), ils imposent un maire à ces sociétés (par groupe de « hameaux » plutôt que par « hameau »). Cette autorité extérieure et artificielle n’éteint évidemment pas les modalités traditionnelles de l’exercice des prises de décisions. En ce qui concerne le système qu’on trouve en Amazonie, la représentation de chaque « chef » (donc ici plutôt le groupe) vers des entités extérieures est pour moi tout simplement différente. Pour le patriarche wolof, c’est en tant que représentant de sa « maisonnée » qu’il va se déplacer pour produire des démarches par exemple administratives. Cela même si son statut d’autorité n’est pas reconnu par une autorité géographiquement (et administrativement) supérieure comme l’Etat. Je perçois un problème d’ordre théorique sur le concept de hameau. Car ce concept nécessite que l’autorité géographiquement supérieure (telle celle d’un Etat) d’une part existe, et d’autre part n’admette pas, ne reconnaissent pas l’autorité au sein de chaque « hameau ». Cette dernière est pourtant susceptible d’être très fortement vécue. Les occupations humaines en Amazonie concernent plusieurs familles. Au Sénégal, dans les campagnes, les occupations humaines concernent une famille. Plusieurs occupations humaines pouvant être accolées ou non. Mais la séparation est alors stricte (historiquement les hameaux étaient sous forme de fortins circulaires). Normalement quand çà colle avec le propos, quand çà ne sonne pas bizarrement … Je préfère, les termes d’occupations humaines. Cependant les terminologies hameau-village-ville met en valeur la plus grande précarité du hameau en terme administratif, au sein de sociétés très « structurées » comme le sont les nôtres.
A un niveau très fin, les systèmes familiaux sont susceptibles d’avoir une incidence sur la manière dont est traité un paysage par des humains. A un niveau plus large ou plus grossier, ils peuvent être interrogés (très) hypothétiquement comme stratégies vis à vis de contraintes politiques, économiques ou biogéographiques.
Quelques termes: Classificatoire: un parent classificatoire est un parent qui ne l’est pas dans notre terminologie de type eskimo (une tante qui est appelée maman, par exemple, est une tante classificatoire). Une parenté eskimo ne distingue pas les cousins entre eux et la césure de représentation se fait au sein des frères et soeurs de sang (les germains) vis à vis de l’ensemble des cousins. Le type dravidien distingue les cousins parallèles des cousins croisés. Résidence patrilocale: les époux vont chez le père de l’époux. Résidence virilocale possède une acception plus large que le précédent (ex: wolof). Résidence matrilocale ou uxirolocale: les époux vont chez la mère de l’épouse ( ex: machiguenga); Résidence néolocale: nouveau mariage, nouveau lieu (ex: Manche). Une terminologie est proposée dans le glossaire (…) du numéro 154/155 de la revue L’Homme.
La question de l’organisation sociale: Etat (je m’appuie provisoirement bcp plus sur Godelier), l’Etat implique que les membres de la société reconnaissent légitimement l’autorité (cela qu’elle s’incarne de la manière la plus simple ou à travers un réseau administratif plus ou moins complexe. Aussi une société sans Etat ne m’apparait pas dans le concept de société lignagère d’Evans-Pritchard (au contraire), une société sans Etat est une société ou l’organisation se produit en commun, qu’il y ait un chef ou non (mais si il y a un chef la valeur qui lui est conférée est limitée par rapport à la valeur conférée à la communauté), çà va être le cas des Machiguenga. Typiquement une société sans Etat est ce qu’on appelle parfois une bande. Le caractère de pouvoir coercitif indiqué par Evans-Pritchard me dérange (un sentiment mal mesuré chez moi qu’il serait trop inspiré de ce qu’il se passe chez nous). Autrement dit chaque famille/ »hameau/village » peut se comprendre comme un segment d’Etat mais à condition de se reporter à un époque utopique (le type de royaume qui nous fait penser à une sorte de féodalisme ne connaissait peut-être pas ce type de famille, étant donné le fait que les structures familiales ne sont pas vraiment vouées à la durée?)
Par ailleurs, la cosmogonie-type selon Descola pourrait également avoir une incidence sur la manière dont est appréhendé son environnement par telle ou telle société humaine. Je fais partie de ceux qui reste sceptique sur l’expression pleine et entière d’une cosmogonie (ontologie) naturaliste depuis la cosmogonie analogiste. Cependant que dans l’article produit par Emma Lelong (dans le cadre de sa thèse) dans le dernier Penn ar Bed de 2025 (n° 257) sur ce récent chantier gigantesque du projet de protection pour la méditerranée (PAMEx), il est apparu la question d’accorder à cette mer une personnalité juridique (en droit français, cela dérive de la personne). Or, à lire l’article les pays du nord de la méditerranée souffrent d’une appréhension qualifiée d’humaniste quand ce n’est pas le cas des pays du sud de cette mer qui entreprennent la logique scientifique d’une manière … Scientifique (il s’agit d’admettre l’interaction de la mer et des humains). L’appréhension qualifiée d’humaniste implique ici l’idée que l’homme domine et maîtrise la nature. Ce qui semble ici contredire Descola le confirme au contraire. Les pays du sud de la mer sont peut-être plus susceptibles d’un héritage analogiste que les pays du nord. Mais le détachement naturaliste depuis l’ontologie analogiste trouve dans les pays du nord un appui historique dans les philosophies humanistes. Quant aux pays du sud, on peut avoir des systèmes de croyances (si tel est le cas des personnes en présence) sur plusieurs plans (l’un par exemple religieux, l’autre par exemple scientifique). Ce fut le cas de Darwin dont les découvertes ne l’ont pas détaché du christianisme, puisqu’il même devenu de plus en plus réactionnaire au fil de sa vie.
| Afar (corne de l’Afrique) | Wolof (Afrique de l’Ouest) | Sérrères (Afrique de l’Ouest) | Matsiguenga (Amazonie) | Manche (Europe de l’Ouest | Creuse (Europe de l’Ouest) | |
| Type de famille | étendue (++) | Souche-étendue (société lignagère) | Souche-étendue (société lignagère | étendue | Conjuguale | Communautaire (?) |
| Polygame/ monogame | Polygame | Polygame | Polygame | Polygame (rare cas de polyandrie) | Monogame | Monogame |
| Cousins? | (bientôt) | Dravidien | Dravidien | Dravidien | Eskimo | Eskimo |
| Localité des époux | (bientôt) | virilocal (duolocale au tout début pour les épouses) | Virilocal | uxirolocal | néolocal | ? (manque de données pour l’instant) |
| Héritage | Le clan hériterait du clan. Voir articulation avec la famille | Primogéniture agnatique matérielle | (trou de mémoire: vérifier) | cognatique | égalité | librement? |
| Filiation | (bientôt) | Agnatique | ? | ? | Agnatique | Agnatique |
| Patriarcat? | (bientôt) | Prises de décisions, autorité : le patriarche (la matriarche seulement en son absence) est le seul sans cadets sociaux | plus souple que le précédent (mais en ville pour cette info) | Hommes? A revoir (?) | Egalité des genres pour les prises de décisions, et l’exercice de l’autorité (les enfants obéissent | (?) |
| Cadets sociaux, classes d’âges | oui, oui. | oui cadets sociaux, oui modéré (classes d’âges) | oui | système de classes d’âge: non | seuls les enfants sont cadets sociaux | a priori non |
| Education des enfants | (bientôt) | Autorité forte | ? | nettement libérale | moyenne | ? |
| âge de raison | (bientôt) | 5-7. Susceptibles d’être renvoyés à leurs genres biologiques avant cette période. Filles travaillent avec les mères. Garçons avec les pères. +école (les daara complémente l’offre publique scolaire) | 5-7 | 5-7 (apprendre à chasser, à pêcher: garçons) | 5-7 L’enfant est confié à la République une large partie de la journée (école : apprendre des contenus fondamentaux comme lire et écrire compter, le goût de la concurrence et le respect de l’autorité administrative) | 5-7 L’ ’enfant est confié à la République une large partie de la journée (école : apprendre des contenus fondamentaux comme lire et écrire, le goût de la concurrence et le respect de l’autorité administrative |
| Insertion de la famille dans la Cité | Articulation importante à observer | ressemblant à du féodalisme autrefois. Désormais Etat sous un modèle de type français. La structure familiale peut apparaître comme un segment d’Etat | Ressemblant à du féodalisme autrefois. Désormais Etat sous un modèle de type français. La structure familiale peut apparaître comme un segment d’Etat | Société sans Etat | Etat administratif très ramifié | Etat administratif très ramifié |
| Tâches, genres | oui | oui. femmes : enfants, Repas et toutes préparations, ménages, etc. plus un peu de commerce Hommes : agriculture | oui. femmes : enfants, Repas et toutes préparations, ménages, etc. plus un peu de commerce Hommes : agriculture | oui. Pas ou peu de jugements Hommes. Chasse et pêche Femmes essarts enfants, cuisine, etc. (hommes cultivent plantes en lien avec la chasse ou la pêche.) | oui. Pas ou peu de jugements | oui. A approfondir. Hommes absents à la belle saison impliquant l’hypothèse de tâches agricoles féminines. |
| Typologie agricole (I) Titre | Pastoralisme | Agriculture | Agriculture/élevage | Agriculture (essarts)/chasse-pêche | Agriculture/élevage | élevage, plus que d’agriculture (moutons le plus probablement devant les bovins). Noter ici que l’objet de l’élevage supposé principal est de la laine pour la tapisserie de Haute-Lice. |
| Typo-morphologie. | désert, quelques herbages. Les délimations territoriales sont connues mais pas forcément visibles. Déserts de roches basaltiques, parfois de sels. Très extensif (pastoralisme). Itinérance forte. Semi-nomadisme | Arbres: très peu, presque nul. Pas de délimitation des parcelles. Sols Diors Extensive (très) | Arbres: oui. Peu de délimitations des parcelles ? Sols diors et diors-decks (type meilleur que le précédent) Extensive (moins) | Forêts Plusieurs types de sols (en général les sols alluviaux semblent distingués, mais également par la teinte plus ou moins foncée/noire) Parcelles d’essarts nettement délimitées, y compris ou surtout sur le front de forêts. La forêt paraît plus « magique », réservée aux activités masculines. Itinérance. Oui. Tous les 10-15 ans. 2 possibilités (hors envies de bouger, guerres, présence d’une industrie extractive, etc.) : moins de gibier en forêt. Pas forcément ce qui vient vite à l’esprit. Ou commencement d’épuisement des ressources des sols pour la culture en essarts. | Bocage (intensif du coup) Parcelles délimitées. Pour ce qui concerne la basse manche occidentale observée ici: Sols sur le complexe géologique de Granville: chacun tente sa chance! C’est la roulette … | Murets, quelques haies basses (pour ainsi dire parfois de l’embouche). Les murets sont souvent de soutènements. Il s’agit de terrasses. Parcelles délimitées. Sols siliceux. |
| Relations/ Corrélations | (à venir) | La polygamie, la manière de l’envisager permet d’envisager la possibilité d’avoir suffisamment d’enfants pour exploiter de plus larges territoires | (à venir) | (?) Tout comme pour les afars, la question de la sécurité du groupe prime probablement sur l’acquisition de nourriture, vêtements, etc … Par ailleurs l’itinérance a lieu au sein de territoires dont la femme est dépositaire. L’itinérance me semble pouvoir être l’axe possiblement corrélé soit pour raisons de sécurité, soit pour produire mieux. Pour obtenir le principe de la corrélation, il faut pouvoir distinguer les deux raisons possibles. | L’héritage égalitaire est susceptible de rentrer en contradiction avec le bocage (réduction des parcelles, augmentation de l’ombrage); Ce qui est susceptible de favoriser des mariages arrangées. Ou dans d’autre cas, il va y avoir un problème. | (?) |
Subspontanée [concept. Botanique]
Plante exogène se comportant comme une spontanée, non (encore) naturalisée, et qui se distingue des accidentelles par son mode d’introduction: échappée de culture.
Succession végétale [Loi. Phytosociologie]
Les communautés de plantes se succèdent spontanément. Par exemple, d’un stade ouvert, pelouse, prairie ou espace sarclé vers le paraclimax s’établissant en principe de manière forestière. Le principe de succession vers la forêt a force de loi naturelle, sauf situations notamment abiotiques très contraignantes. Voir Grime pour visualiser pourquoi cela se passe comme cela.
Des situations abiotiques ou dues à des pratiques humaines ont une incidence sur ces successions: les cultures sarclées ne laissent que les annuelles tant qu’il n’y a pas d’abandon du culture: pas de succession. La fauche ou l’abroutissement bloquent également au stade prairie. Le froid (pelouse de haute montagne), le vent et les embruns salés pour les rares landes littorales au stade paraclimacique. Le feu en ce qui peut concerner des pyropaysages comme des matorrals.
La succession progressive primaire est « naturelle »: elle implique l’épaississement progressif du sol et la progression des espèces de hauteurs modestes et herbacées vers des espèces ligneuses de plus hautes tailles.
La succession régressive primaire est liée à des accidents d’origines « naturelles ».
La succession progressive secondaire est concernée par l’abandon des pratiques agricoles.
La succession régressive secondaire est mise en œuvre par des pratiques agricoles: défrichement, fauche et pâturage.
Les successions autogènes sont des successions qui ne se forment pas sous l’influence d’éléments extérieurs, que ce soit du à des pratiques anthropiques, ou que cela soit du à des évènements climatiques. Des successions impliquées par des grands mouvements, des modifications climatiques d’ampleur ou des pratiques anthropiques sont des successions qualifiés d’allogènes: il s’est passé quelque chose.
Les successions décrivent donc le passage du stade pionnier au stade climacique, et toutes les phases transitoires.
Subulé.e [descripteur. Botanique]
Longuement éffilé.e
Supère [descripteur. Botanique]:
Une fleur est dite supère lorsque le calice recouvre l’ovaire. les points d’insertion du calice se trouve sous l’ovaire.
Symbiose, Symbiote [concept. Ecologie. Biologie]
Cas général: la symbiose implique une relation inverse à celle de la relation parasitaire. Il s’agit d’une relation mutualiste.
Difficulté:
La totalité des organismes eucaryotes (comme nous le sommes, ainsi que les plantes, etc.) sont symbiotiques avec des organismes procaryotes (comme c’est le cas des bactéries ou des archées). Cela a donné la proposition de notion d’holo espèces.
Par ailleurs, le règne des champignons ou mycètes est un règne d’organismes symbiotiques incluant les lichens.
Pour éluder cette étrangeté mais qui résonne aussi facilement à la difficulté de la symbiose eucaryote-procaryote, et pour faciliter la lecture, les chaines taxonomiques des lichens données sur ce site sont coupées et il est indiqué qu’il s’agit de: symbiotes.
Sympatrique [concept géographie botanique. Phytosociologie, écologie]:
Des taxons sont sympatriques lorsqu’ils occupent une aire géographique commune. Un petit côté misogyne dans ce terme, peut-être … Tenter: les plantes synmatriques occupent une même matrie …
Synusie [Important concept. Phytosociologie]:
Dans un espace donné et homogène, Tout en prenant en compte les phases de développement des individus (stade phénologique pour les plantes), une synusie est une strate à une période donnée. La strate muscinale, la strate herbacée, la strate arbustive, la strate arborescente. On sépare les mousses poussant sur les branches d’arbres en une autre strate.
Cela en fonction d’une période considérée. La saison en pratique: vernale, tardi-vernale, estivale, tardi-estivale.
Les lichens ne sont pas des animaux. Les lichens ne sont pas des plantes. Il existe une classification des communautés de lichens.
Systématique [Discipline des sciences du vivant et dites de l’évolution]
La systématique étudie l’organisation des taxa. Il s’agit d’un système hiérarchisé souvent représenté par un arbre. Ce système peut également être représenté par des emboîtements. Et il peut-être plus simple de l’expliquer ainsi.
Il présente plusieurs rangs ou clades.
La première clade ou rang comprend tout le vivant. I. e: dans cette clade, on range tout le vivant, à savoir plusieurs règnes (le règne animal, le règne végétal, le règne des bactéries, le règnes des archées, le règne des champignons)
Dans les clades des règnes, on range toutes les divisions ou phylum correspondantes. Ainsi pour les plantes, on trouve le phylum des cryptogames et le phylum des phanérogames. Le phylum des cryptogames concerne les plantes qui ne produisent pas de graines.
Chaque phylum comprends différentes classes. Dans la boite des phanérogames ou autrement dit spermatophytes, on trouve des groupes qui sont les gymnospermes et les plantes à fruits dont la graine est habillée (ce qu’on appelle les plantes à fleurs): les angiospermes qui ne se divisent plus en dicotylédones et en monocotylédones. Les angiospermes sont une clade de même niveau que les dicots, les vrais dicots, les monocots, et les magnolidées. Dans ces « boites » on trouve normalement des clades correspondant à des ordres, mais il arrive qu’une clade intermédiaire soit déclarée. Cette clade intermédiaire est une innovation de systématique.
Dans la boite des angiospermes on trouve des groupes qui correspondent à un rang qu’on appelle l’ordre.
Chaque classe (de l’ancien système) ou clade désormais comprends donc des ordres, lesquels comprennent les familles, lesquelles comprennent les genres et les espèces.
L’étude phylogénétique actuelle ne rend plus obligatoire les noms de rangs utilisés jusqu’alors, cela en descendant jusqu’à l’ordre. Il est simplement exprimé « clade » car cela permet d’en mettre autant que nécessaire. C’est une innovation. Certains niveaux peuvent être modifiés. Les Domaines ont été modifiés: les bactéries et les archées ayant été élevées au rangs de Domaines.
A partir des familles, les noms de rangs subsistent.
Par exemple: Ranunculales est le nom de l’ordre, Ranunculaceae, celui de la famille, la clade supérieure non indiquée ici etant celle des dicots vrais (eudicotyédones):
Ranunculales>Ranunculaceae>Nigella damascena
Le changement intervenu ne rendant plus obligatoire les noms des clades sur les rangs les plus élevés est un acte de systématique, par exemple.
Cela donne des expressions un peu contre-intuitive pour qui est très habitué.e à une classification classique:
- Giardia intesitinalis est un Eucaryote bikonte du règne Excavata (ce n’est donc pas une bactérie, ni une archée: les anciennes procaryotes)
- Plasmodium falciparum est un Eucaryote bikonte du règne Chromalveolate (même remarque. Anciennement classé dans les protistes)
- Homo sapiens est un eucaryote unikonte du règne Animalia
- Yersinia pestis est une Eubacteria du règne Bacillati et sous règne Bacillota, de la classe des Bacilli, et de l’ordre des Enterobactérales. Les bactéries étaient considérées comme procaryotes. Le terme de procaryote restant acceptable, bien que défini négativement vis à vis des Eucaryotes: pour les bactéries et les archées.
La classification est enchâssée par des caractéristiques parfois dites évolutives … Ou plus simplement adaptatives. Lorsqu’une innovation apparaît et qu’elle est intéressante, rien ne s’oppose à ce qu’elle se répande. Ainsi les fleurs à ovaires supères sont mieux protégées que celles à ovaires infères, puisque l’ovaire est recouverte par pétales et sépales.
De cette manière si l’on compare les Ranunculales qui comprennent les renoncules aux Rosales, et notamment aux Rosaceae (les roses, etc.) … On trouve des caractères morphologiques apparemment proches mais marquant une certaine opposition. Les Rosales vont être données pour « évoluées ». Les Ranunculales comme beaucoup plus « archaïques »
D’un premier regard, 5 pétales et nombreuses étamines. Calice et corolle séparées. En fait ce premier regard convient aux Rosales. Le programme est en fait beaucoup moins bien déterminé concernant les Ranunculales. Pétales de 3 à 5; étamines spiralées ou cycliques (cycliques chez les roses). Parfois calices et corolles mais facilement des tépales. Et de manière curieuse, l’expression de nombreux fruits disposés les uns auprès des autres, au lieu d’un seul fruit par exemple contenant de nombreuses graines.
Adaptabilité, selon moi plutôt qu’évolution. Cependant, il faut noter que les innovations doivent être perçues dans une temporalité, au moins les unes par rapport aux autres, mais aussi par rapport à la situation géographique. D’autant que la situation des terres émergées n’a pas toujours été la même, ainsi que les périodes climatiques. Aussi, la représentation en arbre de type évolutif reste vraiment utile.
T. Haut de page
Talus (Géomorphologie humaine, pratiques humaine)
Dans un grand nombre de cas, Nord de la France, et notamment pour l’ouest, le talus renvoie à la haie. Mais pas seulement.
Il me semble important de renvoyer directement au travail ethnologique proposée dans les numéros 153-154 de la revue Penn ar Bed. Rédigé dans une période où la place du bocage a une valeur un peu mythologique pour la région. On y cherche encore peut-être le premier bocage de l’histoire. Un goût marqué très tôt.
Des questions y trouvent des réponses, parfois de circonstances.
A quoi sert une haie ou un talus? Depuis l’époque du témoignage, il apparait la protection des cultures, et l’idée de marquer la propriété cadastrale.
Il me semble personnellement que le premier point, la lutte contre la divagation du bétail herbivore a certainement joué un rôle dans l’expansion des haies et des talus. L’autre fonction non négligeable est celle de la limitation du ruissellement et de l’érosion.
Les talus peuvent être fait de pleine terre, de pierres, ou de murets couverts de terres. Les talus renvoient donc soit aux haies, soit aux murets.
Pour la Bretagne, il y avait une ségrégation des tâches en fonction du sexe et de l’âge: c’est à dire, de la noblesse apparente des tâches. Bien que présenté sous un jour de travail physique ou moins physique. Que ce soit pour l’entretien des haies et talus, soit pour la confection de ceux-ci.
En ce qui concerne l’aspect structural des familles (micropolis), des études approfondies, pratiquement « clocher » par « clocher » semblent nécessaires. Il y a un très bon texte, mais du côté de Douarnenez (on appelle ce coin un pays à murets. C’est très différent. Les coins sont très différents) et d’autres textes que je me suis promis d’explorer. L’histoire est passé par là. Il y a deux types de bretons, le progressiste traitera l’autre de fou ou de conservateur (de collaborateur nazi dans certains cas: le breizh atao). Je ne peux qu’avec de très grandes difficultés témoigner de ma famille, située dans les confins occidentaux. Cette famille était de type très progressiste. Ma mère, l’ainée, n’a jamais parlé ni compris le breton. Ma grand-mère parlait avec sa mère en breton, plutôt lorsque leurs conversations ne regardaient pas les enfants. La césure a eue lieu à cette période. De nombreux traits traditionnels sillonnent la vie de ma grand-mère fière pourtant comme un bar tabac d’avoir été avec sa belle soeur et voisine –maisons collées, les premières au village à avoir la télé. Pas de machine à laver (inutile avec des bras comme les siens) mais tout ce qui peut être moderne si le besoin est avéré. La plus grande majorité des enfants de mon arrière grand-mère vivaient à sa proximité immédiate. Ma mère, également résolument moderne, m’a expliqué que la matrilocalité apparente était du à des évènements, était de circonstance. A vrai dire: je n’en sais rien. Je garde un doute très profond sur les arguments de ma mère. Cependant revenir sur les aventures de mon arrière grand-mère, sise dans la presqu’île de Plougastel, sous la dépendance de Daoulas, à Logonna. Mon arrière grand-mère était adorable. Elle était tombée amoureuse de son mari. Mais catastrophe anthropologique, son mari n’était pas du bon village. Je ne peux l’affirmer mais je me demande bien … Si il ne s’agit pas d’un « mariage mixte » Penn Sardin et Bigouden (lol). Fuite donc à la frontière du Léon (Plougastel constitue un pays mais enfin … Je n’ai pas connu sans les ponts vers Brest). La Kermesse (en tous cas un fest dei) avait lieu dans un pré derrière chez elle. J’étais trop jeune. Mais c’est comme çà qu’on a remarqué qu’elle avait gardé un muret de pierre sèche. Bon les animations, il y avait courses en sacs, tirs au pigeons (assiettes d’argiles), une fois courses à l’oeuf, tirs à la corde, etc. Je crois qu’il y avait un truc avec des cochons aussi. Je n’ai pas connu la fête des morts (les breuriez, et statistiquement ma mère très peu, mais elle détestait les fêtes autour de la pomme). De l’autre côté, ils se sont mis après guerre+ au moment de la retraite à se rassembler dans le même coin de village, ils ont peuplé un quartier, toujours en Bretagne, sur la frontière avec le pays gallo. Là encore les unions, la structure familiale telle que j’ai pu la rencontrer réponds aux attentes de la république. Je sais en tous cas qu’au moins en certaines occasions, à table, il était bon que les fils s’assoient à la gauche du père. La mère prenaient ensuite ses enfants à sa droite. Ma mère, mes tantes à la gauche de ma grand-mère. Les enfants en face. Le grand père tenant un bout de table. D’un coup la consanguinité semble avoir primé les alliances. Les fêtes du 15 août (les grands mères s’appellent toujours Marie) étaient l’occasion de réunir la famille élargie (tiens donc?). Il y avait la tablée des adultes et cela se déclinait par … Âges (tiens donc?). Etant né parmi les derniers des petits enfants, ma visibilité sur la table des adultes était réduite. C’est cette autre grand-mère, lors de la retraite de mon grand-père qui a choisi le lieu de résidence. Ma mère a elle-même choisi notre lieu de résidence. Je ne suis pas certain pour les autres membres de la famille. Couple ami de mes parents, moderne très fortement république française: c’est lui qui un jour ne supporte plus la vie loin de son « pays ». Retour en pays bigouden (pays à murets. Ils ont un trait toujours de nos jours. Je l’indique car cela me fait sourire). Ces exemples pouvant tout aussi bien indiquer un reste assez pâle d’anciennes habitudes de vie communautaire, pour la génération de mes grands-parents. Ou encore pas grand chose. Les hommes dans le domaine domestique en tous cas sont plutôt silencieux. Les femmes sont dans leurs domaines. On m’a souvent rapporté les tablées à l’ancienne (est-ce une légende? ) avec les hommes d’un côté les femmes de l’autre, et l’ancienne debout pour servir le repas. La maîtresse de maison. Les tâches sont totalement genrées (c’est un peu différent du côté des pêcheurs puisqu’ils s’en vont lors des campagnes, parfois longues), mais leurs hiérarchisations? La transmission du nom autant que je sache est simple et du père aux enfants. L’héritage des biens ??? A voir pour chaque clocher. Mon impression générale: il s’agit de sociétés patriarcales. Après, c’est selon les familles. Des fois, cela peut être très fort.
En ce qui concerne la religion, le catholicisme romain y fut probablement et selon les localités assez teintés. On trouve des sculptures un peu particulières parfois sur les églises (voir la revue penn ar bed, numéro 257, de 2025). Il a été fin XIX et début XX, la source d’un passéisme assez profond, éventuellement violent ( un facteur possible de la révolte des sardinières). La violence du fait religieux explique la tension très forte entre les modernes et les tradis. Alternativement, le parti communiste a pour les bretons représenté un grand espoir. La religion possède des modalités probablement fervente. Selon les individus et les localités.
En ce qui concerne le sud du Cotentin, on y trouve côté campagnes un paysage de haies, comprenant aussi des chemins creux. Le système familial de La Manche (sur la base des travaux de Zonabend, donc par extension pour ce sud ouest de la Manche), occurrent jusque dans les années 70 à 80 (du fait de personnes encore vivantes) présente la cellule familiale la plus simple. Les enfants sont égaux (en héritage et en responsabilités). Les parents (ou en cas décès, l’ainé.e) ont une autorité importante. Les biens du mari et les biens de la femme sont séparés. L’homme et la femme sont considérés à égalité jusque dans les tâches. Les grands parents font déjà figure d’éloignement vis à vis de la cellule familiale. Nombreux cas de célibats. Cas de Lévirats. Possibilités de mariages entre cousins germains (4° degrés et donc relativement proches, non vu si croisés). En remontant un peu dans le temps, car on comprends que dans l’héritage à égalité, les biens se disloquent entre les parties, les mariages (arrangées par autorité parentale) sont susceptibles de se faire en fonction de la juxtaposition des parcelles. Pour chaque couple, un foyer: familles nucléaires égalitaires.
Le système familial est à rapprocher de celui du sud est de l’île et Villaine où, la solution consistant à arranger les mariages fonction de la juxtaposition des parcelles ne semblait pas exister et à causé des problèmes en les réduisant à travers le temps, donnant plus de place à l’ombrage produit par les haies (Voir Périchon Samuel, dans Bocage et Société. Cf bilbio)
En ce qui concerne la religion en Manche, le nombre d’édifices, assez important, semble impliquer une certaine ferveur quant au catholicisme romain.
Noter qu’il y a de très nombreuses autres religions monothéistes que les religions abrahamiques. Tous ou la majorité des africismes (les Religions Traditionnelles Africaines) sont monothéistes et semblent répondre à la catégorie descolienne, et même très fortement, de cosmogonie ou ontologie analogiste (tout comme les religions abrahamiques).
Tampon. Pouvoir tampon [pédologie].
Le pouvoir tampon d’un sol désigne en général la résistance d’un sol (le CAH) à l’ion H+, l’hydrogène très acidifiant. L’humus et l’argile sont particulièrement favorable à cet effet tampon. Un sol peut également tamponner des bases.
Lorsqu’un ion H+ (un proton) est dans la solution du sol, il est acidifiant. Plus que lorsqu’il est lié au CAH. Si l’ion H+ passe de la solution du sol, libre et disponible au CAH, en remplacement par exemple d’un proton Ca++, ce dernier passe dans la solution du sol. D’une part l’acidité baisse par la fixation de l’hydrogène au complexe argilo-humique, d’autre part le pH remonte en libérant le calcium (Ca++)
Taxon [Concept des sciences de la terre] :
Rang dans la taxonomie : ordre, famille, genre, et espèces sont chacun des taxons. La famille des rosacées est un taxon, telle espèce de rose en particulier est aussi un taxon.
La manière dont sont organisés les taxa entre eux est étudié par la systématique.
Taxonomie [Discipline des sciences de la terre]
La taxonomie consiste à circonscrire les taxons par le biais de caractéristiques génétiques, biologiques, morphologiques. L’activité taxonomique produit donc (in fine) des rangs hiérarchisés produisant l’arbre du vivant pour chaque taxon. Autrement dit, sa phylogénie.
Cette phylogénie en tant qu’étude ou activité ressort en principe plutôt de la systématique.
Elle diffère notamment de la nomenclature, mais aussi de la systématique (objet un peu différent).
Tépale [descripteur. Organe. Botanique]:
Ce terme est utilisé quand il n’est pas possible de distinguer une pièce du périanthe comme étant un pétale ou comme étant un sépale. Un ensemble de tépales forme un périanthe (ou périgone)
Terné [descripteur. Botanique]
Par 3; trois folioles, trois lobes, etc.
Tesela [Concept. Phytosociologie]
Groupement en mosaïque ou en zonation de plusieurs phytocénoses dérivant les unes des autres par des successions progressives ou régressives secondaires. Concept de la phytosociologie synusiale. Concernant des échelles assez grandes.
Therophyte [Concept. Botanique]
Une plante thérophyte correspond à ce qu’on appelle habituellement une annuelle. Ainsi que quelques bisannuelles. La définition comprend qu’il s’agit de plantes monocarpiques, et qu’elles passent la mauvaise saison sous forme de graines.
D’une part des espèces monocarpiques peuvent apparaître avant l’hiver et voir leurs croissances bloquée par le froid, et reprendre au printemps. Elles peuvent alors être considérées comme bisannuelles. Mais en tous cas il s’agit de thérophytes.
D’autres part certaines espèces comme le mouron des oiseaux voient plusieurs floraisons y compris durant l’hiver. Si ces espèces sont monocarpiques, il s’agit de thérophytes. Elles ont une phénologie qui ne nécessite pas nécessairement beaucoup de chaleur.
Therό fait référence à la saison chaude. Et beaucoup de thérophytes fleurissent en été. Comprendre cette saison par la chaleur, mais dans l’aspect phénologique de l’espèce considérée.
Noter que l’architecture végétale, est par principe inclue dans le concept (il existe des exceptions): sa morphogénèse est dite en Holttum. Soit un développement monocaule terminé par une inflorescence (laquelle sera plutôt souvent composée); la plante étant monocarpique.
Les thérophytes renvoient aux plantes monocarpiques, et plutôt aux espaces rudéraux et secondaires anthropiques.
Thyrse [descripteur. Botanique. Typologie des inflorescences]
Trachéophyte [concept botanique systématique]
Grand super groupe de plantes comportant des vaisseaux conducteurs de sèves.
Transformatrice, ou impact [écologie de la plante, et des milieux]
Espèce capable de transformer la nature ou l’état d’un écosystème où elle est présente, cela sur une superficie importante (espèces envahissantes). Se dit d’espèces végétales.
Triquêtre [descripteur. Botanique]
De section triangulaire, à faces concaves.
Trophie [écologie]:
Désigne la capacité nutritive d’un sol, d’un substrat pour les plantes. Dans d’autre domaines, comme l’archéologie, la distinction semble opérée par principe: la recherche de la trace phosphore peut permettre de repérer d’anciennes stations humaines. Car les sols de ces stations conservent une valeur eutrophe (avec une trophie marquée positivement), à travers le temps long. Cela renvoie à la notion d’hysteresis. Pour la trophie, voir échelle d’Ellenberg qui en donne les mesures.
U. Haut de page
Urba-
La ville va concerner 2 effets d’ampleurs, sans aucun rapports et dont aucun n’est forcément défini de manière hyperarticulé. Le premier facteur concerne les plantes. Le second les humains.
Urbanophiles (plantes)Le premier concerne les plantes urbanophiles: il y a, et notamment dans les très grandes villes une plus grande variété de plantes, pour 2 raisons: elles sont transportés de toutes régions de France ou de tous points du monde. L’autre raison, sur des périmètres restreints, une variété (somme toute limitée mais) importante de milieux existe.
Les plantes strictement urbanophiles doivent pouvoir supporter la poussière (pollution) des taux d’azote important (pollution). Elles bénéficient également de degrés de chaleur plus important, et sur une temporalité plus importante (îlot de chaleur urbain). Par ailleurs, les sols sont imperméabilisés, avec couches de sables de btp sous-jacente.
Les communautés de plantes urbaines pourraient apparemment trouver un intérêt à être étudiées. Elles engagent de toute façon pour parties les friches s.l. des Chenopodietalia albi, du Chenopodietalia muralis, du Sysimbrietea, etc. Pas totalement convaincu pour l’instant … par cette idée, de communautés de friches spécifiques par l’apports de plantes exogènes. En général elles sont rattachées.
En ce qui concerne les humains:
Urbanisme (Merci à Omar, sociologue): l’effet de la ville sur la dissolution des structures sociales traditionnelles a déjà été observé par Simmel. Omar semble me renvoyer plutôt vers Louis Wirth. Tout d’abord, il s’agit des modes de vie, et cela ne s’arrête donc pas par principe aux frontières de la ville. Mais la ville est agentive sur les personnes qui y vont, et y demeurent. La grande densité mise en facteur de l’hétérogénéité des personnes qui s’y trouvent ( issues peut-être à un moment de sociétés traditionnelles) les mettent en contacts assez permanent. Lors du retour périodique de ces personnes dans leurs villages, évidemment … Ce en quoi ils ont été mis en contact reste quelque part, même de manière sous-jacente. Richard Florida, en 2004, a proposé des indicateurs de l’agentivité de la ville. Ces indicateurs sont positifs et concernent donc moins les populations traditionnelles qui abordent malheureusement un peu plus souvent la ville par la périphérie (bidonvilles, ou quartiers pauvres). Indices tel la tolérance à la diversité (gay, étrangers, etc.)
Du côté de l’anthropologie, Cela semble suivre les travaux de Bourdieu et Sayag en mettant en exergue le déracinement (et pour le coup s’appliquer plus proprement aux sociétés traditionnelles). Maintenant sur le terme de dissolution des structures sociales traditionnelles, il s’agit sans doute plutôt de recompositions, et cela va engager la topologie (désolé mais il y a un peu moins de place en ville, la manière dont s’effectuent des rencontres … Une possible plus grande variété de rencontres …) La situation économique des acteurs:
La perception supposable ou réelle de la propriété va pouvoir montrer une différence entre la campagne et la ville. Donc je vais montrer une chaine de pouvoir à la campagne, dans le contexte agricole.
Ce que ne veulent pas être les agriculteurs. C’est être ouvrier agricole. C’est mal payé mais on ne se suicide pas. Par contre, et c’est le point fort: les tâches sont à produire en tant que pur exécutant.
2 autres modalités existent: être fermier ou propriétaire « exploitant » si l’on veut. Dans ces 2 cas, le travail, c’est de la stratégie (cette année on va faire du blé, et mettre ces parcelles là avec des cultures très subventionnées). C’est beaucoup plus intéressant. On devient responsable de ce que l’on engage dans son activité. Quand on est fermier on est locataire. Les baux sont de 10 ans. Il y a des stratégies à plus de 10 ans. Par exemple certaines reconversions en bio peuvent être sur des délais importants. On s’expose là à l’accord ou au désaccord du propriétaire, éventuellement à des remarques. Quand on est proprio, on prends ses risques. La raison pour laquelle, il y a une part de cultures subventionnée qui sera mise en place, c’est qu’il faut diminuer le poids de l’investissement comptable (l’investissement comptable, c’est bien souvent dans le cas des agriculteurs fermiers ou propriétaires, de la dette reportée). Les fermiers comme les propriétaires se suicident. Parce que dans la chaine du pouvoir, il y a des choses qui dominent leur décisions: obtenir les bonnes semences et les bons produits, moissonner et vendre au meilleur moment. Cet effet peut renvoyer par exemple à certaines coopératives mais pas seulement. Quoiqu’il en soit une certaine autonomie est recherchée, pour pouvoir faire un travail intéressant. Mais le « patron », le vrai, économiquement, il est ailleurs. Il ne s’agit pas de capitaliser et d’exploiter mais de pouvoir vraiment travailler.
Quand on est employé en ville, on a un patron dans le sens où on l’entend habituellement, le droit du travail a été conçu en fonction de ce type d’emploi, on a le droit à un salaire, à des congés. Et possiblement on est locataire. Les perspectives sont différentes.
Urne [descripteur. Botanique]:
Partie renflée de la capsule des bryophytes où se forment les spores.
Pour les trachéophytes, organe en forme de coupelle, en principe renflé.
Utricule [descripteur. Botanique]
Se réfère à « outre ».
Chez les laîches, correspond aux parois des fleurs/fruits.
Chez les utriculaires: vésicules des feuilles.
V. Haut de page
Variété[Concept. Botanique] :
Rang taxonomique inférieur à l’espèce. Ce rang est souvent donné en partie en lien avec l’écologie du milieu concerné. la variété occupe la même aire que l’espèce, mais dans un habitat différent. Elle se distingue par des traits morphologiques ou génétiquement. La valeur statistique d’une variété est supérieure à celle d’une forme, et inférieure à celle d’une espèce. On pourrait dire d’une variété: « des fois ». A distinguer des écotypes d’une part, des cultivars (des variétés cultivées) d’autre part.
La chorologie (même aire mais niche différente) est indicative de modalité de spéciation.
Un ensemble de critères permet de distinguer les rangs d’espèce, sous-espèce, variété ainsi que forme
Végétation
Formation végétale. Synonyme de phytocénose
Vicariance [Concept. Taxonomie. Ecologie. Botanique]:
La vicariance qualifie deux taxons se substituant l’un a l’autre dans deux régions données. Cela peut impliquer une barrière écologique (apparition d’un fleuve, surrection d’une montagne, construction d’une autoroute, etc.) La vicariance et la sympatrie sont alors articulées. La vicariance favorise alors (sur le long terme) la spéciation par mutation en isolant une ou des espèces qui jusqu’alors ne connaissaient pas de barrières écologiques. L’endémovicariance concerne des espèces phylogénétiquement proches (ayant un ancêtre commun) mais réparties de manières distinctes.
X. Haut de page
Xéro-
Sec
Z. Haut de page
Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique, floristique.
Espaces remarqués pour leurs intérêts particuliers en matière d’homogénéité naturelle comprenant le patrimoine (oui, le patrimoine … ce terme dans ce domaine … bon) … donc le matrimoine des habitats, de la faune, de la flore (mais aussi géologique).
Les habitats, espèces sont attendus d’être rares, remarquables et de correspondre au patrimoine naturel de telle ou telle région. Mais qu’est ce que le matrimoine naturel. Pour être grossier: A Paris, c’est pas partout la Hêtraie et plutôt pas, çà va être plus souvent les érables: donc les formations végétales qui en découle, par exemple.
Donne lieu à 2 types de signalements: l’un très intégré, et très riche de type 1; le type 2 est à richesse élevée, mais notamment vis à vis des milieux alentours.
Les znieff permettent de protéger les ensembles naturels, notamment lors de programmes d’aménagements du territoire où elles peuvent être prises en compte.
C’est évidemment des endroits où faire d’excellentes ballades, pleines de découvertes!

